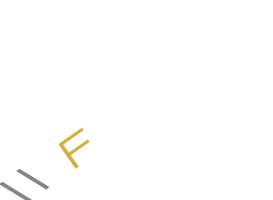LA SIGNIFICATION DES IDEES DE FRANCO BASAGLIA POUR LE MOUVEMENT PSYCHIATRIQUE ANTI-INSTITUTIONNEL EN ITALIE. UN TEMOIGNAGE (2004)May/17/2018
THE MEANING OF FRANCO BASAGLIA’S IDEAS FOR THE ANTI-INSTITUTIONAL PSYCHIATRIC MOVEMENT IN ITALY. FROM A PERSONAL EXPERIENCE.
LA SIGNIFICATION DES IDEES DE FRANCO BASAGLIA POUR LE MOUVEMENT PSYCHIATRIQUE ANTI-INSTITUTIONNEL EN ITALIE. UN TEMOIGNAGE.
Xth International Meeting, Paris - 21-24 juillet 2004
" Psychoanalysts and Psychiatrists. A long and complex History "
Sergio Benvenuto
1.
De tous les psychiatres italiens non vivants, Franco Basaglia (1924-1980) reste le plus connu par ses compatriotes. Tous ou presque dans notre pays savent que Basaglia a inspiré « la loi 180 », approuvée en 1978 – « loi qui a aboli les asiles » ; on l’appelle aussi « loi Basaglia ». Il jouit en Italie d’une renommée quasi mythique, comparable à celle dont jouit Philippe Pinel en France : il est évoqué comme le médecin éclairé qui a libéré les malades mentaux de leur fers.
Pourtant, en dépit de cette notoriété, sa pensée et le sens de son action – et de ceux de ses adeptes de l’association Psychiatrie Démocratique (P.D.), aujourd’hui encore active et puissante – restent souvent l’objet de méprises. Ainsi, les sympathies marxistes et radicales de Basaglia étant bien connues, on croit souvent qu’il a soutenu une théorie sociogénétique de la maladie mentale, qui pourrait se résumer par « les gens deviennent fous car notre société est mauvaise ». En réalité Basaglia n’a jamais affirmé de pareilles thèses – d’ailleurs il s’est toujours bien gardé de proposer lui-même des hypothèses explicatives sur la maladie mentale, et pour cause.
Une autre équivoque consiste dans l’assimilation erronée de l’œuvre de Basaglia aux thèses des antipsychiatres surtout anglo-américains, tels R. Laing, D. Cooper, T. Szasz, et d’autres. Pour ces antipsychiatres, comme on le sait, la maladie mentale n’existe pas en soi, et est plutôt une construction historico-culturelle, une interprétation sociale. Or, Basaglia a toujours refusé l’étiquette d’antipsychiatre, il a sans cesse répété « je suis un psychiatre, je dois voir la psychose – qui certes existe – comme un psychiatre de mon temps la voit ; mais moi je lutte contre les institutions psychiatriques ». Basaglia s’est proclamé psychiatre anti-institutionnel, et non antipsychiatre – une différence capitale.
Mais cela ne signifie pas pour autant que, en ne proposant aucune théorie originale sur la maladie, il n’ait été qu’un homme d’action aveugle et naïf. En effet, son action réformatrice se basait sur une conception sophistiquée du sens de la psychiatrie. Et sa conception continue d’influencer la pratique de beaucoup de psychiatres italiens.
2.
J’ai eu l’occasion de fréquenter personnellement Basaglia en 1971, quand il m’accepta comme stagiaire – je préparais une maîtrise en psychologie à l’Université de Paris VII – à l’Hôpital Psychiatrique (H.P.) de Trieste, dont il était alors, depuis peu, le directeur. Ces deux mois passés dans son hôpital furent l’occasion pour moi d’un nombre importants d’échanges (souvent passionnés) avec Basaglia où nous parlions de mes impressions sur la vie de l’H.P.
A cette époque, Basaglia sortait de l’expérience, somme toute négative, de directeur de l’H.P. de Colorno (Parme). A Trieste, alors, il avait l’intention de dépasser la méthode de la « communauté thérapeutique » qu’il avait appliquée, le premier en Italie, à l’H.P. de Gorizia (proche de la frontière avec la Yougoslavie). Ce, en reprenant l’expérience de communautés thérapeutiques de Maxwell Jones effectuée en Angleterre et aux USA, qu’il avait pu suivre personnellement. Très doué pour la promotion médiatique, Basaglia avait réussi à rendre célèbre son expérience à Gorizia (1961-1969), ce aussi bien en Italie qu’à l’étranger, notamment en France. Pourtant, à l’époque il ne songeait plus à appliquer la méthode, démocratique et tolérante, de la communauté thérapeutique : il songeait plutôt au démantèlement pur et simple de la structure asilaire. Par rapport à l’expérience de Gorizia, certes sous l’influence du climat post-1968, sa position s’était donc largement radicalisée.
Bien que quelque peu ébloui par la croissante célébrité de Basaglia, je n’adhérais pourtant pas à son système de valeurs. Je lui avais dit très clairement que je tendais à la psychanalyse et que j’appréciais des expériences comme celle de la Clinique de La Borde – Basaglia abhorrait la « psychothérapie institutionnelle » française, justement parce qu’ »institutionnelle ». Selon lui, cela n’avait en effet aucun sens de remplacer les institutions psychiatriques traditionnelles par des plus ouvertes et modernistes : puisqu’une institution curative était selon lui une contradiction dans les termes mêmes. Bien que ne partageant pas ses conceptions politiques et culturelles, sa fréquentation presque quotidienne pendant deux mois me marqua profondément. J’appréciais également ses capacités de psychiatre traditionnel à entrer en contact avec les malades et d’interagir avec eux de manière fraîche et séduisante.
3.
Basaglia s’était longuement nourri de la phénoménologie philosophique et psychiatrique – des auteurs comme Husserl, Jaspers, Binswanger et Minkowski furent ses points de référence, comme ils le furent d’ailleurs pour la plupart des leaders de P.D. Cette formation, combinée à une inspiration marxiste au sens large (de rigueur à cette époque en Italie), explique essentiellement le choix de son ennemi principal : la technique.
Basaglia disait souvent qu’il avait dû surpasser une grande Tentation : celle de mettre au point une nouvelle technique thérapeutique pour les psychoses – au cas échéant basée sur une nouvelle hypothèse sur la maladie mentale. En effet, disait-il souvent, même si l’on invente une technique plus humanitaire, plus relationnelle, plus démocratique, plus interactive, etc., « cela reste de la technique ». Il considérait même la psychanalyse – dont il appréciait la signification de tournant historique – comme n’étant qu’une technique. Le véritable ennemi contre lequel Basaglia s’est battu pendant toute sa vie n’était pas tellement l’H.P., la psychiatrie académique, la société ségrégative ou les psychothérapies, mais plutôt la technique elle-même.
Un jour m’a-t-il dit « je suis convaincu que l’électrochoc dans beaucoup de cas est efficace, par exemple dans les crises de mélancolie. Mais ici nous n’y avons pas recours à cause de sa connotation violente et répressive. » Ce n’était donc pas l’efficacité technique qui était en jeu. Pourtant à Trieste on donnait beaucoup de médicaments psychotropes, et, de façon un impertinente, un jour je lui demandai : « vous êtes contre toute technique ? mais non pas contre celle pharmaceutique ». Il me répondit que les psychomédicaments étaient une aide pour aller au-delà de la ségrégation asilaire. A l’époque je n’ai pas eu la présence d’esprit de lui rétorquer « mais peut-être que d’autres techniques, psychanalyse incluse, peuvent aider à aller au-delà de la ségrégation asilaire ! » A Trieste je me suis rendu compte du rôle incontournable de la psychopharmacologie ; je me demande en effet si l’élimination progressive des H.P. – en Italie et ailleurs – aurait été possible s’il n’y avait pas eu à disposition des psychomédicaments quelque peu efficaces.
4.
On pouvait certes objecter que l’asile arriéré était une chose – comme l’était le « San Giovanni » de Trieste que j’ai connu en 1971 – et que l’hôpital ou clinique « de type suisse » (à cette époque les cliniques psychiatriques privées suisses jouissaient d’un prestige particulier), efficient, propre, conçu pour des thérapies brèves et efficaces, était tout autre chose. Pour autant, Basaglia et ses adeptes voyaient en toutes ces institutions pourtant bien différentes un continuum : celui de la domination technique. Mais qu’y avait-il de si maléfique dans des cures à la dimension technique ?
Ce qui fait horreur dans la technique – et dans la science - au phénoménologue révolutionnaire est son pouvoir de séparation. La technique est essentiellement séparation – en général, séparation de l’agent du produit de son action. Or, cette dénonciation de la technique remonte au moins à Platon : Socrate ne laisse pas de livres derrière lui justement parce que le livre survit à son auteur, il est le produit inerte d’un sujet vivant, « si l’on pose une question à un livre, il ne répondra pas ». L’important, de Platon à Husserl jusqu’à certains auteurs post-modernes, est de penser l’évènement de productions ne se séparant pas de leur producteur ou auteur. Or, si le monde-de-la-vie est pensé phénoménologiquement comme tension, mouvement, dynamique, la technique au contraire est conçue comme l’opération qui partage, capsule dans une stase, isole un produit lui-même aliéné. Et Basaglia pensait l’asile à la fois comme un produit de la technique et comme une machine à séparer.
Cette séparation se fait d’ailleurs à plusieurs niveaux. En effet l’asile ne sépare pas seulement le malade de la congrégation sociale extérieure, il sépare aussi ses habitants entre eux. Il sépare le médecin psychiatre des malades ; le monde des soignants en son intérieur est organisé de façon hiérarchique, et la hiérarchie est une forme de séparation. De plus, les services de l’H.P. sont séparés entre eux. Le monde hospitalier était radicalement interprété comme l’application de la forme de vie technocratique à ce qui, en tant que vital et excentrique, lui échappe.
La pratique de l’équipe de Basaglia se basait donc sur la promotion d’une agitation libératoire : « créer le mouvement ». On ouvrait peu à peu les portes de l’H.P., on faisait communiquer les services entre eux, on favorisait une osmose croissante entre l’H.P., le quartier et la ville. On « ouvrait des espaces » : non seulement physiques, mais aussi des « espaces » d’initiatives sociales et d’animations. On « faisait circuler les gens ». En somme, on opposait au vieil H.P. la « libre circulation » du monde-de-la-vie, Lebenswelt: on introduisait la dimension de la temporalité dans un univers intemporel (à l’époque les horloges des H.P. étaient très souvent arrêtées).
Basaglia niait en effet que l’institution hospitalière – toute institution – puisse avoir une histoire : l’H.P., en tant que produit de la science-technique psychiatrique, rendant les gens mutuellement étrangers, expropriait l’histoire de ses victimes et il était lui-même sans histoire. L’H.P. est une institution exemplaire de l’univers technique : les patients, ces débris humains, étaient la folie que la société avait séparé d’elle, mis hors d’elle, dans un lieu spécialisé refoulé de la vue ; l’asile était un produit que la société technique se refusait donc de reconnaître comme son propre produit.
D’un côté, donc, Basaglia dénonçait l’H.P. et la vieille psychiatrie asilaire comme « non curatifs ». A l’époque, il a convaincu les italiens qu’un malade dans les H.P. n’était pas soigné, plutôt il y était déposé comme un colis, contrôlé et réprimé dans des conditions lamentables. De là, l’appui massif que sa campagne a rencontré aussi bien de la part des media et de l’opinion publique, que chez les psychiatres. Mais la plupart pensaient que par sa dénonciation Basaglia proposait par contre une véritable cure. Or, d’un autre côté, comme nous l’avons vu, il contestait également les différents traitements – des thérapies de choc jusqu’aux psychothérapies les plus intersubjectivistes – comme des figures plus ou moins camouflées de la monstrueuse Technique. Et pourtant, dans le même temps Basaglia pensait que les malades mentaux devaient être réellement soignés. Comment sortir alors de cette contradiction ?
Basaglia pensait en effet que soigner les malades de la maladie asilaire – en détruisant ainsi l’asile, et toute institution qui voudrait en prendre la place – était aussi ipso facto un traitement des psychoses. Cela n’impliquait pas du tout une théorie absurde du type « les gens sont rendus fous par l’asile » - naturellement Basaglia admettait qu’on devient fous même en dehors de l’H.P. Pour autant, il pensait que, justement dans la mesure où il renonçait à toute technique de cure (hormis celle psychomédicamenteuse), il pouvait arriver au noyau de la cure, à savoir : soigner le sujet de cette séparation constituante, car, du moins en partie, il pensait que la maladie consistait dans cette séparation. Il pensait en somme que les maladies mentales étaient doubles : d’une part il y a la maladie véritable – sur l’origine de laquelle il évitait de se prononcer – et de l’autre son « double ». Le thème du double lui venant certes d’Artaud, poète et psychotique. Basaglia voyait donc la maladie mentale comme d’une part un produit de la division technique de la subjectivité, et de l’autre comme le double que la technique a fait d’elle. La folie à laquelle il était confronté était donc ce double d’elle-même que la société technocratique avait fait de la folie, dans une ségrégation non pas seulement physique en H.P., mais également scientifique (aujourd’hui dans les DSM par exemple) en la séparant conceptuellement du flux de la vie. Pour lui, la priorité était la cure du double de la maladie, avant la cure de la maladie elle-même.
5.
Déjà à cette époque, j’étais perplexe sur l’application systématique du principe triestin qui consistait à faire partir les patients de l’H.P. le plus tôt possible. Ayant pu parfois voir le lieu d’origine d’où beaucoup de ces patients venaient, il me semblait que finalement ils pouvaient être mieux à l’hôpital – où ils avaient un contact continu avec des personnes sensibles et tolérantes – que dans le « territorio » souvent insensible et intolérant. Territorio : un terme ubiquiste, obligatoire dans le langage politique et sanitaire de l’Italie des années 70 et 80. Le « territoire » était pensé à l’époque comme le lieu de la vie authentique, de la natura naturans qui n’a été encore ni séparée, ni divisée, ni hiérarchisée par les institutions. Mais souvent ce « territoire » - conçu comme « terroir » de la vie - où il fallait renvoyer le patient était de fait un enfer pire que l’asile, voire même le véritable asile d’où le sujet s’était échappé.
Le fait de vouloir renvoyer tout malaise subjectif au lieu social originaire était pour moi une façon de refuser une demande individuelle irréductible : celle par un sujet qui veut s’isoler et même être pris en charge pendant un temps, juste pour échapper à l’enfer du « territoire ». En fait, l’équipe basaglienne ne voulait absolument pas se soucier du besoin d’éloignement de son propre lieu originaire (famille, foyer, quartier, etc.) : cette séparation individualiste, agie (acted out) dans la crise psychotique, était au fond condamnée de manière moralisante par le « psychiatre démocratique » de l’époque. Ainsi naquit mon soupçon, que l’approche basaglienne était sous-tendue par une éthique secrètement autoritaire.
A Trieste, en outre, je n’appréciais guère une certaine réticence pudique des soignants, surtout de ceux qui avaient été appelés par le directeur pour mener jusqu’au bout l’entreprise, à analyser leurs conflits, les dynamiques interpersonnelles entre eux, bref, tout « l’irrationnel » même chez les réformateurs. Lorsque je faisais remarquer cette exigence de réfléchir sur soi-même comme « sujets en souffrance » dans le travail quotidien, on me raillait un peu comme quelqu’un de dévoyé par la mentalité psychanalytique. En effet, à l’intérieur de l’équipe soignante triestine on ne pouvait parler que des besoins des malades, du travail à accomplir. L’action et la réflexion allaient toujours dans un seul sens, du soignant au soigné, elles ne se reflétaient jamais à l’intérieur du champ des « techniciens » (comme les soignants s’appelaient eux-mêmes à Trieste, en marquant ainsi auto-ironiquement l’impossibilité de sortir des techniques....) en forme d’action réflexive sur eux-mêmes en tant que techniciens. Paradoxalement pour une équipe qui se voulait anti-technocratique, je trouvais assez technocratique cette division par laquelle réflexion et action étaient à sens unique.
Ce refus de vouloir réfléchir sur soi – au-delà de la tâche missionnaire à accomplir - était cohérent avec une métaphysique de la réappropriation qui imprégnait l’équipe de Trieste. En effet, si les psychiatres-militants avaient réfléchi sur eux en tant que sujets pathétiques au-delà de leur projet, cette démarche semblait entrer déjà dans le champ de la psychothérapie.
D’un côté toute approche psychothérapique était exclue, de l’autre Basaglia critiquait ce qu’il appelait esthétisme.
Selon lui, l’esthétisme était dans l’attitude qui tend à voir une valeur propre à la pauvreté et à la souffrance, en les respectant comme des « cultures » en tant que telles, qui tend en somme à sympathiser avec la pauvreté et la souffrance non pour les éliminer mais pour les contempler et s’en attendrir. Il voyait cette sympathie participative pour le monde des déshérités et des malades comme un piège dangereux. Il devait probablement penser à des psychiatres-écrivains comme Mario Tobino (1910-1991)[1], qui avait écrit des pages émouvantes sur ses patients, et qui avait donc su illustrer le côté tragique, et par là même sublime, de l’asile. Basaglia citait comme mauvais exemple le « spécialiste en pauvreté » Oscar Lewis, mais il devait également penser à Pasolini, qui parvint à rendre émouvantes les bidonvilles louches et dégradées de la Rome de l’époque. Il proposait plutôt comme bon exemple le vieux philanthrope anglo-saxon – du genre de ce Maxwell Jones, inspirateur de ses démarches du début – qui ne nourrissait aucune sympathie, même pas esthétique, pour la misère, qui était plutôt pressé de l’éliminer. Or, l’image que je conserve de Basaglia est justement celle d’un homme pressé : hyperactif, dont même les célèbres tics oculaires semblaient connoter une sorte de hâte, d’irritation à bout de peau pour les résistances des psychiatres à son projet de changement.
6.
Mais puisque l’action politique au sens large de l’équipe de Basaglia produisait aussi des effets que tout le monde pouvait appeler curatifs, pourquoi ne pas penser que cette action était pour autant une technique ? la « technique Basaglia » de cure des psychotiques ? Bien entendu, Basaglia se serait sans doute indigné si je lui avais dit que sa praxis était une technique. Comme un missionnaire chez les indigènes refuserait qu’on le loue pour sa « technique pastorale ». En effet, Basaglia autocritiquait son expérience de « communauté thérapeutique » à Gorizia qui lui avait pourtant apporté la célébrité, pour la raison que cette communauté thérapeutique était elle-même une technique de cure. Pour lui, soigner les malades signifiait les émanciper, socialement et individuellement. Certes, Basaglia admettait que dans sa stratégie la séduction jouait : « je dois séduire un héroïnomane si je veux lui parler au lieu de lui faire un électrochoc »[2] Mais selon lui la séduction n’était pas une technique, elle constituait plutôt une partie de la dynamique de la vie, et non une séparation de celle-ci.
Basaglia et ses disciples n’avaient donc aucune intention de construire une nouvelle science psychiatrique, fusse-t-elle basée sur la libre dynamique intersubjective (du genre radical therapy par exemple) ; l’idée de « science libératoire » leur apparaissait comme une contradiction dans les termes mêmes. Pour eux, la seule science psychiatrique était finalement celle qu’on apprend à la faculté. Il s’agissait plutôt de subvertir le produit de la science : la séparation sociale que celle-ci produit. Leur action se voulait donc tout à fait éthico-politique, et absolument pas scientifique : ce qu’il fallait changer, avant même de soigner la maladie, était la réponse sociale à la maladie. Ce qui impliquait, en perspective, le changement de la société toute entière : le sous-entendu de cette action émancipatrice était qu’une société aurait pu accueillir et tolérer les malades mentaux seulement en changeant radicalement. Dans le fond, les basagliens pensaient de déclencher par leur activité un processus foncièrement révolutionnaire. Ce point échappait et il échappe encore aujourd’hui à beaucoup d’intellectuels de gauche qui croient connaître le basaglisme. Des touristes-militants de la Révolution qui venaient souvent en visite à l’H.P. de Trieste avaient pour leit motiv : « contre la vieille psychiatrie, ici à Trieste on fait de la vraie science psychiatrique, la nouvelle ! » Ceux-ci étaient vite désavoués par l’équipe de Trieste, qui se moquait carrément d’eux.
Or, pour Basaglia, bien que toute praxis puisse être interprétée comme (réduite à) technique, il ne devait pas se produire de décalage ou de détachement du sujet par rapport à son acte. En attaquant les techniques et les hiérarchies professionnelles, Basaglia dénonçait justement ce décalage ou détachement, matrices de toute fragmentation. Puisque justement les techniques elles-mêmes sont séparées entre elles. En effet les technosciences se présentent comme réciproquement émancipées, autonomes, fragmentées : elles sont des spécialismes. Contre le monde fragmenté et spécialisé des techniques – qui mettent en acte la volonté de contrôler et manipuler les choses et les hommes – Basaglia opposait ce que la phénoménologie appelle Lebenswelt, le monde de la vie : les besoins, l’histoire, l’enthousiasme, le sens.
Or, ce projet romantique de totalité non divisée de la Vie ne pouvait guère me séduire, puisque déjà à l’époque je n’aimais pas la Totalité. Le pluralisme, au sens d’une vie sociale multiple et éparpillée, me plaisait déjà : la séparation et la fragmentation ne me faisaient pas peur, bien au contraire, je les voyais comme un corollaire de la vie multicolore. Les techniques ne sont pas ce qui aliène ou nie la vie, elles sont une partie de la vie.
7.
Nous avons dit que la pluralité et la fragmentation étaient pour Basaglia le double – le double pour un phénoménologue révolutionnaire est la réalité vécue, l’expérience de la vie comme Erlebniss. Cette doublure technocratique qui sépare la vie d’elle-même – qui enlève son sens à la vie et à la souffrance - produit quelque chose que nous ne pouvons vivre que comme de la merde. Dans le discours de Basaglia les métaphores scatologiques proliféraient. Il se référait souvent aux internés de l’H.P. comme à des déchets sociaux. En effet, le savoir-pouvoir technocratique, au fur et à mesure qu’il crée des formes fragmentées, inévitablement exclut, rejette, isole quelque chose qui déchoit, et qui peut être assimilé à un réel excrémentiel. La technoscience est appelée sans cesse à gérer ce qu’elle a refoulé et donc par là même produit, tel l’H.P. S’il y avait eu une doctrine basaglienne de l’inconscient psychanalytique, elle serait de ce genre : ce n’est qu’en apparence que le refoulé, l’inconscient, sont ce que l’analyse fait émerger ; c’est plutôt la psychanalyse elle-même qui, en tant que technique, est refoulante et crée donc l’inconscient.
Mais la question est alors : pour autant que tout acte dé-séparant et dé-technique se « réalise », ne devient-il pas à son tour un acte qui produit des effets-déchets, ne tend-il pas lui-même à retomber lui-même comme son propre double, en une forme inerte ? Atteindre le sens plein – le flux de la vie non divisée – est en effet une perspective au mieux asymptotique : tout acte tend à retomber en-deçà de la vraie vie. La Révolution est toujours au-delà, par la suite, à venir, eschatologique en somme. Au présent, nous ne nous confrontons, toujours, qu’avec la merde du double... C’est ceci qui mine ou ronge tout vitalisme phénoménologique (même chez les psychanalystes) : tu as beau détruire les institutions, elles se reconstituent toujours spontanément, comme si la vie même avait une prédisposition particulière à s’aliéner, à se fragmenter en séparations. Et cela est vrai même dans le cas des asiles : ils tendent diaboliquement à se reconstituer, dès l’instant que l’enthousiasme et la fièvre libertaires des libérateurs s’avachissent. La libération des malades – à la fois de l’asile et de leur maladie – n’a de sens que si elle reste un procès, elle ne peut jamais être un état achevé.
8.
Mais comment considérer la vie dans son unité non divisée ? C’est-à-dire, à travers quelle forme la vie se présente-t-elle de manière authentique, non séparée d’elle-même ? Pour les basagliens, ce mode originaire de manifestation de la vie se trouve dans les besoins. C’est à ceux-ci qu’il faut finalement répondre et correspondre. Le fou, disait Basaglia, « est une personne qui a des besoins particuliers qui pourtant pourraient trouver des réponses adéquates avant de s’exprimer dans la forme codifiée de la maladie »[3]. La maladie psychiatrique est un double – un artefact social – à travers quoi des besoins fondamentaux s’expriment.
A remarquer : des besoins non pas des désirs. Cette terminologie à l’époque créait des problèmes avec les psychiatres français, pétris de pensée poststructuraliste et de machines désirantes deleuziennes, qui venaient en pèlerinage en Italie quelque peu envieux des succès, médiatiques et politiques, des réformateurs italiens : les français n’aimaient pas que les italiens parlent de besoins, ils préféraient parler de désir. En effet, les intellectuels italiens étaient imprégnés de marxisme lukacsien – la lukacsienne Agnès Heller parlera de « besoins radicaux » à la même époque - c’est ainsi qu’ils trouvaient trop romantique le fait de parler de désirs[4].
De fait, le terme besoin connotait pour ces « psychiatres démocratiques » ce que j’appellerais un désir socialement légitime. Un moralisme gauchiste les amenait à refuser les désirs, perçus comme des caprices petits-bourgeois, comme quelque chose de redondant. Les besoins, bien au contraire, sont des choses sérieuses, dont on ne peut pas se passer. Mais qui décide si un certain désir est un véritable besoin ou s’il est seulement... du désir ? Le « psychiatre démocratique » évidemment, qui est en possession du rasoir discriminatoire. Ainsi, Basaglia me dit une fois qu’ »un véritable besoin » des malades est d’avoir du papier hygiénique, et non celui d’avoir du papier de toilette patiné ou rosé ; ce dernier était un « besoin idéologique », et donc pas un véritable besoin. Bien que le désir de papier hygiénique raffiné puisse provoquer une diarrhée, disait-il, « même une diarrhée peut être idéologique ». Cette boutade de la diarrhée idéologique m’avait impressionné à l’époque : après tout, pensais-je, tout symptôme névrotique, pour un lukacsien phénoménologue, relève du « besoin idéologique ». Mais pourquoi le besoin de papier hygiénique basic serait au contraire un besoin vrai ? Après tout, on pourrait renoncer même au papier hygiénique et se nettoyer avec de l’eau. D’ailleurs, pour les sages taoïstes ou pour les philosophes cyniques grecs, tous les besoins pour n’importe quel objet étaient inessentiels (« idéologiques ») - sauf pour un seul, l’écuelle. Bref, à partir de quel moment un produit manufacturé satisfait un vrai besoin ou crée des désirs, à savoir des besoins idéologiques ? De fait, la limite entre le besoin – en tant que désir qu’il est légitime de satisfaire – et les désirs n’est jamais absolue, mais historiquement flottante : elle dépend de ce qu’une société, dans une phase particulière de développement des biens de consommation, considère comme étant un bien indispensable ou pas.
En somme, la référence aux besoins à satisfaire signifiait, de fait, que le technicien psychiatre décidait ce qui était besoin légitime. Pourtant, les désirs sont aussi ce qui fait la différence entre un sujet et un autre. Certes Basaglia se battait contre les inégalités, mais la solution ne me semblait pas, à l’époque comme aujourd’hui, résider dans une égalité forcée, dans l’élimination des différences entre les désirs et des désirs comme différences. La solution ne me semblait pas consister pas dans la dissolution et fusion des « je » différents, nécessairement séparés, dans le bouillon d’une Totalité sociale.
9.
Mais au final, une fois que l’institution aura été tout à fait éliminée, comment donc articuler ce soupiré « travail dans le territoire » ? Basaglia est mort avant d’avoir pu voir l’application extensive de la loi 180. Il faut dire que la désinstitutionalisation de la maladie mentale a été une tendance largement partagée dans tout l’Occident à l’époque. De fait, l’Italie n’a fait que participer au trend général – puisque même dans les pays anglophones le community care a pris largement la place des institutions hospitalières. Ainsi, l’élimination des H.P. publiques avait déjà commencé en Californie, quand Ronald Reagan était son gouverneur (1967-1975). Dans la pratique, sans la loi 180, d’autres pays ont des-asylé mieux et davantage que l’Italie, sans mettre la charrue d’une loi devant les bœufs de la désinstitutionalisation de facto. Mais il est à remarquer que, hormis les stars pittoresques de l’antipsychiatrie anglo-américaine, cette ligne gagnante en Occident ait eu une formulation culturellement séductrice surtout en Italie : Basaglia est connu même à l’étranger grâce à sa promotion brillante, intelligente et provocatrice de ses idées.
Mais que reste-t-il du basaglisme une fois son projet politique réalisé ? En effet, les héritiers de Basaglia ont dû se recycler dans des techniques – des psychothérapies à la psychopharmacologie – que leur maître avait exclues éthiquement. Si l’on veut éviter que le vieil asile se reconstitue, un bon usage des techniques plus efficaces devient une condition indispensable. Avec le temps, P.D. a perdu presque complètement sa charge anarchique, éversive, visionnaire : ses membres gèrent de manière souvent efficiente les soins psychiatriques dans le territoire, les temps romantiques sont donc révolus. Mais comment Basaglia lui-même aurait considéré cet assagissement technocratique de son mouvement ?
Il s’était en partie déjà posé ce problème lorsque, en 1979, il fut appelé à Rome pour gérer l’application de « sa » loi dans la région de la capitale. Il fallait alors penser à des soins sans des institutions fortes de genre hospitalier – mais comment les penser au-delà des techniques ? En pratique, après Basaglia, dans la plupart des cas l’asile a été substitué par des lieux « maison-famille », où un petit nombre de malades sont hébergés dans des appartements privés et où il sont suivis par une équipe soignante qui vient les visiter.
Basaglia et ses amis abhorraient l’idée même de psychiatrie privée. Toutes les cliniques psychiatriques privées, surtout celle qui jouissaient d’une vaste clientèle et de hauts profits, étaient l’objet d’un mépris total : « des industriels de la folie » , on les nommait ainsi. Mais ce profond rejet éthique visait tacitement la médecine toute entière : un ophtalmologiste célèbre qui opère des milliers de patients, par exemple, n’est-il pas lui aussi un « industriel de la cataracte » ? C’est un fait, un médecin privé vit grâce aux infirmités des gens. Tout thérapeute même très humanitaire doit au fond de lui souhaiter que beaucoup de monde tombe malade, autrement comment pourrait-il gagner sa vie ? Basaglia et les basagliens avait pris cette contradiction très au sérieux : pour eux, la médecine privée était fondamentalement immorale.
Mais alors, comment peut-on empêcher que le psychiatre payé par l’état devienne quelqu’un qui vive lui aussi de la souffrance d’autrui ? Basaglia[5] évoquait la norme qui était en vigueur en Chine pendant un temps, où le médecin était payé quand les gens qui était à sa charge étaient sains : pour chaque malade en plus, son salaire diminuait. En somme, le véritable travail psychiatrique aurait dû être préventif : une sorte de bonification écologique pour prévenir la maladie psychiatrique. Mais par quels instruments, quelles techniques ? Basaglia lui-même n’en avait pas une idée précise.
10.
Il est facile d’entendre aujourd’hui, en Italie, que le basaglisme est des gesta du passé. Pourtant, malgré toutes les réserves que j’ai émises dans cet article, je crois que Basaglia n’est pas seulement une relique d’un passé plein de rêves et d’illusions soixante-huitardes. Malgré tout, son défi à la suprématie des techniques a une actualité particulière aujourd’hui : à la différence de l’époque de Basaglia, la technique psychiatrique triomphe vraiment actuellement ! De nos jours, la psychiatrie du DSM se propose comme la science rigoureuse du malaise humain et elle promet la solution technique de nos problèmes spirituels. Bien que la répudiation de la science et de la technique de la part de Basaglia ne soit certes pas la bonne réponse, une méfiance à la fois éthique et philosophique croit dans nos sociétés[6]. Cette méfiance à l’égard des prétentions croissantes de la science de résoudre technologiquement nos problèmes et souffrances spirituels montre bien que Basaglia avait senti un véritable problème.
Bibliographie
Franco Basaglia:
- L’istituzione negata, Torino, Einaudi, 1968 ; L’institution en négation, Paris, Seuil, 1970.
- Scritti, vol. 1, Dalla psichiatria fenomenologica all’esperienza di Gorizia, Einaudi, Torino 1981.
- Scritti, vol. 2, Dall’apertura del manicomio alla nuova legge sull’assistenza psichiatrica, Einaudi, Torino 1984.
- Conferenze brasiliane, Centro Documentazione, Pistoia 1984.
Franco Basaglia & Franca Basaglia Ongaro, La maggioranza deviante, Einaudi, Torino 1971.
Sergio Benvenuto, "Psichiatria e rivoluzione”, MondOperaio, luglio-agosto 1982, pp. 127-130.
Sergio Benvenuto, "Il crampo ideologico della psichiatria italiana", MondOperaio, marzo 1984, pp. 130?34.
Frank Chaumon et alii, “Psychiatrie”, Encyclopaedia Universalis, 1981, pp. 327-333 ; et « Franco Basaglia (1924-1980) », ibid., pp. 527-8.
Umberto Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 1999.
Elisabeth Roudinesco & Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard,
1997, pp. 92-3.
Mario Tobino, Le libere donne di Magliano, Mondadori, Milano 1953.
Mario Tobino, Gli ultimi giorni di Magliano, Mondadori, Milano 1982.
[1] Directeur de l’H.P. de Lucques, il était un écrivain célèbre en Italie. Il s’est opposé par ses écrits à l’application de la « loi Basaglia », en revendiquant la fonction humaine des asiles.
[2] Interview à Il manifesto, 7 septembre 1979.
[3] Interview à Le Voci, magazine psychiatrique, 1979, n. 3.
[4] L’intelligentsia italienne des années 60 et 70 influencée par le marxisme s’était formée sur Gramsci, bien sûr, mais aussi sur le marxisme mitteleuropéen (Lukacs surtout) et sur l’école de Francfort (Horkheimer, Adorno, Marcuse). L’influence du poststructuralisme français (Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, etc.) dans la culture italienne a été tardive et assez éphémère (aucune commune mesure avec la profonde influence que la culture française des années 70 et 80 a eu dans la culture américaine, par exemple).
[5] Interview à Le Voci, op. cit.
[6] L’attaque à la fois éthique, philosophique et politique à la primauté des technosciences est aujourd’hui menée par le philosophe-analyste-psychologue-écrivain à la mode Umberto Galimberti, dont les livres ont un grand succès dans l’opinion de la gauche italienne.
Flussi © 2016 • Privacy Policy
 IT
IT EN
EN