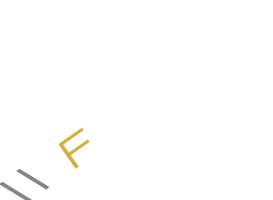Le regard de l'aveugle. Remarques sur Cézanne et le cubismeJun/28/2016
“Quel était, donc, le sens menteur: le tact ou la vue?” William Cheselden[1]
Les historiens de l'art ont l'habitude de distinguer deux courants divergents du modernisme pictural: un courant “expressionniste”, qui s'est propagé surtout dans les pays germaniques et protestants, et un courant que l'on pourrait appeler “chosiste”, qui a eu ses champions dans le monde latin et catholique (de Cézanne au cubisme de Picasso et Braque, du cubo-futurisme italien à Léger, et au-delà). Cette différence mérite néanmoins d'être interrogée en profondeur. Cézanne d'un côté, Van Gogh et Munch de l'autre, ouvrent deux voies que l'on perçoit comme alternatives dans la recherche moderne. Mais cette opposition alternative est-elle nécessaire? Est-ce qu'elle s'inscrit véritablement dans la structure la plus constitutive du projet moderniste dans l'art?
J'ai déjà écrit sur ce sujet[2]. Je liais alors ces deux courants à deux modes de perception dans la relation qui s'établit entre le sujet et la réalité: dans le courant qui naît avec Cézanne prévaut une vision qui cherche à évacuer le regard tandis que dans celui qui naît avec Van Gogh, c'est avant tout le regard du peintre sur les choses vues qui est l'objet de la représentation. Je formulais cette distinction en utilisant certaines réflexions de la psychanalyse (surtout lacanienne) sur la dynamique du regard[3]. C'était ma façon de renouveler une conception déjà établie selon laquelle la peinture de Cézanne pointait la pure visualité. Ma distinction avait paru à certains par trop tranchée ou par trop vague. Aussi quelle ne fut pas ma surprise quand, pour la suite, j'eus connaissance de récentes recherches neurologiques qui confortaient cette idée. Tel est le sujet de cet article. Mais il ne faut pas d'abord expliquer ici pourquoi cette distinction entre une “peinture de la vision” et une “peinture du regard”.
1.
Que fait l'expressionnisme? Arrêtons-nous un instant sur un tableau très célèbre, aujourd’hui un symbole national de la Norvège: Le Cri (1893) d'Edward Munch. On considère ce tableau comme une sorte de manifeste de l'expressionnisme. Au centre en bas, nous y voyons une silhouette humaine stylisée et sexuellement indéfinissable, une espèce d'ectoplasme ondulé qui crie avec la bouche entrouverte et avec un geste d'horreur. Cette silhouette assez effrayante se trouve debout sur un pont de bois avec, dans le fond camp, un paysage maritime où l'on voit des collines et un port avec des bateaux (il s'agit de la baie de Christiania, aujourd’hui Oslo). L'ensemble se découpe sur un coucher de soleil jaune et rouge sang. Une partie de l'effet inquiétant du tableau repose sur un contraste de lignes: les droites rigides du pont et des deux silhouettes qui le traversent s'opposent aux formes courbes, ondoyantes, du reste du paysage et du personnage qui crie au premier plan. On a l'impression que le choc sonore d'un cri traverse la nature en déformant les sinuosités du paysage et en donnant aux couleurs incertaines du coucher du soleil une tonalité ténébreuse et angoissante.
D'habitude, l'historien d'art face à un tel tableau parlera – comme Savinio – de “réalisme de l'âme” car le tableau exhiberait les sentiments subjectifs très intenses. Et la question surgit aussitôt : les sentiments subjectifs de qui? En quoi consiste cette subjectivité évoquée par l'expressionnisme? Cherchons alors à aller outre le schématisme des définitions courantes, lesquelles se limitent à traduire nos réactions émotionnelles face à ce genre de peinture, sans l'analyser.
Ici la nature nous apparaît hurlante - comme secouée par une onde sonore intense - parce que le “fantôme” central de l'image évidemment hurle. Il regarde dans notre direction mais il semble ne pas nous voir: il paraît plutôt voir quelque chose d'horrible ou de menaçant, voire les deux, que nous ne pouvons pas voir étant donné que nous sommes du côté de cette chose horrible ou menaçante. Pourtant, nous aussi nous sommes confrontés à quelque chose d'horrible: ce personnage qui hurle. Instinctivement, nous pensons que ce personnage ne crie pas parce qu'il voit quelque chose en dehors de lui-même, mais simplement parce qu'il se voit ou se “réalise” lui-même, comme dans un miroir extérieur ou intérieur. Munch renonce à nous montrer - au contraire de ce qui se produirait dans la peinture classique - quelque chose d'horrible ou de menaçant pour créer en nous mêmes, les spectateurs, une sensation angoissante: plutôt en soustrayant à notre regard l'objet inquiétant, il nous oblige à nous concentrer sur la façon dont le protagoniste du tableau (à la fois projection de nous mêmes, spectateurs, que du peintre devenu spectateur) regarde quelque chose d'angoissant. Le peintre cherche en somme à nous montrer non pas la chose effrayante mais le regard effrayé.
Mais comment représenter un regard en tant que tel? Il est évident que le peintre peut représenter dans un tableau, ou l'oeil ou l'objet vu par l'oeil, alors que ce qui réunit l'oeil à l'objet, c'est-à-dire le regard que le sujet voyant porte sur l'objet, est de l'ordre de l'invisible, du non représentable. C'est précisément cet objet invisible que l'expressionnisme cherche désespérément à représenter. Dans Le Cri de Munch, nous constatons un premier résultat, devenu paradigmatique, de cette tentative. Pour le spectateur, l'angoisse provoquant ce cri représenté est évoquée chez le spectateur en montrant ce regard angoissé dans la nature même, dans ce paysage que le personnage central ne voit pas puisqu'il lui tourne le dos. Le port, le ciel taché de sang, les collines qui sombrent dans l'obscurité, tout cela “rend sensible” le regard angoissé. En déformant la nature représentée, y compris le corps humain, le peintre expressionniste évoque son propre regard, et en plus vise à le représenter dans la nature qu'il peint. Ainsi, le peintre expressionniste ne se limite plus à proposer à notre regard des objets qu'il regarde de façon picturale, il propose plutôt à notre regard son propre regard comme digne d'être regardé.
Certes, la peinture de n'importe quelle époque et de n'importe quel genre vise toujours à capter notre regard: comme sous le pont de bois de Munch, le monde coule devant nos yeux tel un film paresseux, tel une bande continue de formes et de couleurs qui normalement ne nous intéressent pas, que nous voyons sans les regarder. Puis, soudain, un tableau ou une autre image percent cette barrière de la vision qui coule devant nos yeux, captent notre regard, fixant notre oeil qui jusqu'ici errait, inquiet, à la chasse de choses intéressantes et plaisantes. De quelqu'un qui provoque une grande impression lorsqu'il passe à la télévision ou dans un film, on dit de lui qu'il “crève l'écran”. Ce qui soudain nous attire, fige notre regard et polarise notre attention, n'est pas perçu en termes de forme saillante, comme quelque chose qui se découpe ou qui se tend vers nous, mais dans les termes d'une trouée, d'une fissure, comme dans les tableaux perforés de Fontana.
Le monde de la vision est une passerelle blafarde où les choses visibles défilent devant nos yeux, notre oeil ne faisant que les enregistrer, puis tout à coup, un trou: comme la bouche entrouverte du hurleur de Munch, centre virtuel du tableau, entonnoir du maelström visuel que l'artiste suscite dans les eaux stagnantes de la vision. D'où la tendance expressionniste à privilégier des lignes courbes ou serpentines: il s'agit non seulement de conférer à la nature inorganique les formes rondes et enveloppantes des animaux, mais de circonscrire une zone centrale virtuelle du tableau, laquelle est exactement un point aveugle, un vide autour duquel tournent les tourbillons évoqués par le regard. Un objet troue l'écran de la vision parce que nous nous reconnaissons en lui, c'est-à-dire nous reconnaissons que cet objet suscite notre désir et notre crainte, qu'il révèle ou dévoile notre désir/angoisse[4] jusqu'ici brouillé par le voile du visible.
On peut néanmoins objecter que toute la peinture, même la plus classique, capte notre regard à travers le regard sur la chose représentée que le peintre nous offre. Une belle femme nue se fait toujours regarder, mais il est évident que la Danaé de Titien nous attire non seulement par ses formes anatomiques, mais aussi et surtout par le regard que le Titien a su porter sur elle, ce regard qu'il nous rend manifeste à travers les dégradés, les tons, l'éclairage choisi, les contrastes chromatiques entre la peau et le fond, etc. Certes, mais la peinture pré-expressionniste ne tend jamais à nous représenter directement ce regard pictural en tant que séparé de la chose représentée et regardable. Dans l'art classique, le peintre qui regarde demeure une présence implicite, située en deçà de la fenêtre de tableau. Là le peintre est un pur corrélat de l'objet pictural, qui nous intéresse en tant que regardé et non pas en tant que cet objet représente le regard qui rend cet objet digne d'être regardé. Dans la peinture classique, le regard est toujours présent, mais il n'est jamais révélé, il reste voilé dans le visible. Le peintre classique séduit notre regard en montrant de quelle façon il regard l'objet, mais il ne montre jamais le fait qu'il nous le montre en le regardant d'une certain façon. L'utopie expressionniste réside dans la tentative de dévoiler le regard, toujours intéressé et tendancieux, du peintre. Ce cri de Munch qui déchire la nature est l'allégorie même du déchirement expressionniste. Il s'agit d'arracher le voile constitué par les objets visibles, lequel cache le regard pictural.
L'expérience expressionniste peut néanmoins se produire dans l'expérience réelle. Elle arrive lorsqu'un sujet se trouve dans certains états hallucinatoires produits par des substances psychotropes, comme la mescaline, L.S.D., etc., voire aussi dans certains états hallucinatoires spontanés lors de la schizophrénie. Pendant le trip psychédélique, s'il se développe un sentiment de méfiance ou d'hostilité vis-à-vis d'une des personnes qui est là, ce sentiment se manifestera visuellement dans le visage et les formes de cette personne: elle apparaîtra tout d'un coup monstrueuse, horrible, comme dans une caricature grotesque. Si, à un moment donné, le sujet halluciné éprouve des pensées pessimistes ou tristes, le monde autour de lui “exprimera” ces mêmes pensées: un sombre brouillard enveloppera les choses et la réalité toute entière apparaîtra comme sale, livide. Dans ces états hallucinatoires, le sujet est emporté dans un monde “expressionniste” où sa propre façon de voir les choses - et donc la coloration émotionnelle qui l'accompagne - les déforme et les contamine. L'hallucination “voit” donc sa subjectivité projetée sur le monde extérieur qu'il perçoit. Le regard est l'instance subjective dans l’acte de la vision.
On peut objecter: toute vision est vision pour un sujet, elle implique un sujet. Mais le sujet qui regarde est différent du sujet qui voit. C'est un sujet pulsionnel, désirant, qui veut, qui choisit ce qu'il faut fixer et qui ignore ce qui va être englouti dans le désert de l'oubli. Les psychanalystes se sont intéressés au regard, précisément parce que celui-ci n'est pas la vision, en tant que c'est un rapport neutre, désintéressé, dépassionné avec l'objet. L'on regarde quelque chose parce que cela nous attire ou nous menace. Le regard est la façon dont nous rendons subjectif le monde visible en le hiérarchisant par rapport à nos intérêts, faisant de ce monde-ci notre maison, notre habitat. Ou mieux encore, le regard capte quelque chose qui le mettrait en danger ou qui le protégerait, quelque chose qu'il faut par conséquent intégrer ou expulser. A travers le regard, le visible se clive entre ce qui est à nous et ce qui est autre que nous. Le regard installe la chose au centre de notre monde visible, dans la macula, réorganisant notre vision autour de ce scintillement attirant qui vient de se fixer au centre de notre oeil.
2.
Si je viens de faire un si long détour concernant l'expressionnisme, c'est pour mieux faire apparaître, par contraste, l'autre courant que j'appellerai “chosiste”, lequel va de Cézanne au cubo-futurisme.
En tant que tableaux, les oeuvres de Cézanne captent elles aussi notre regard, mais elles cherchent - sur un mode toujours plus radical au fur et à mesure que Cézanne développe son projet - d'effacer du tableau le regard du peintre. L'ambition proprement métaphysique de Cézanne consiste dans le fait de vouloir restituer non pas un monde regardé par l'artiste, mais un monde situé avant tout regard, un monde auroral avant que l'homme l'intègre à ses désirs et besoins. Ce monde se fait regarder comme la surface d'une planète inconnue: la beauté unheimlich (inquiétante) de ce qui n'a jamais été regardé.
Dans le monde naturel ou humain des tableaux de la maturité de Cézanne ne se trouve aucune subjectivité, il n'y a que des choses. Comme l'écrit Merleau-Ponty, Cézanne “révèle le fond de nature inhumaine sur lequel l'homme s'installe. C'est pourquoi ces personnages sont étranges et comme vus par un être d'une autre espèce [...] Le paysage est sans vent, l'eau du lac d'Annecy sans mouvement, les objets gelés hésitants comme à l'origine de la terre; c'est un monde sans familiarité où l'on est pas bien, qui interdit toute effusion humaine”[5]. C'est une peinture inhumaine même lorsqu'elle représente un visage humain: pour Cézanne, un visage devait être peint à la manière d'un objet. Lorsqu'il choisissait le paysage qu'il fallait représenter “il commençait par découvrir les assises géologiques puis il ne bougeait plus et regardait, l'oeil dilaté [...]. Il 'germinait' avec le paysage. [...] Pour ce peintre-là, une seule émotion est possible: le sentiment d'étrangeté, un seul lyrisme: celui de l'existence toujours recommencée”[6].
Cézanne se consacrait à l'étude précise des apparences. Il dilatait les yeux: en renonçant à son interprétation optique du monde, il laissait les choses pénétrer en lui, l'envahir. Mais ce qui résulte ensuite de sa toile est un monde d'où la subjectivité - à savoir, les habitudes visuelles, les ajustements perceptifs et la tradition picturale européenne - semble exclue (ou plutôt, comme dirait Merleau-Ponty, mise entre parenthèses). Il fait épochè de l'histoire subjective de la vision: “[Cézanne] veut peindre la matière en train de se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontanée. [...] C'est ce monde primordial que Cézanne a voulu peindre, et voilà pourquoi ces tableaux donnent l'impression de la nature à son origine, tandis que les photographies des mêmes paysages suggèrent les travaux des hommes, leurs commodités, leur présence imminente. [...] Le génie de Cézanne est de faire que les déformations perspectives [...] contribuent seulement, comme elles font dans la vision naturelle, à donner l'impression d'un ordre naissant, d'un objet en train de s'agglomérer sous nos yeux”[7].
Mais cet effort (sinon inhumain, du moins a-humain) accompli par Cézanne - afin de revenir à une perception originaire, vierge, non contaminée par des regards qui jugent et qui accueillent, qui définissent et qui rejettent - n'était réellement issu que d'un projet artistique grandiose. On sait que Cézanne lui-même, vieillard, se demandait si toute sa peinture ne dérivait pas d'un désordre de ses yeux. Les historiens qui ont suivi, mais aussi ses contemporains, ont suggéré plutôt qu'il y avait à la base de la vision cézannienne un déséquilibre mental. Certains font remarquer la symptomatologie clairement obsessionnelle du peintre, lequel expliquait à Émile Bernard qu'il souffrait de troubles cérébraux qui l’empêchaient d’agir librement[8]. Merleau-Ponty rappelle également la phobie de Cézanne, lequel ne tolérait pas d'être touché, et finit par suggérer de façon implicite que le peintre était schizoïde[9]. Un mois avant sa mort, Cézanne lui-même constatait qu'il se trouvait dans un état de désordre cérébral et de grande agitation, craignant même que sa raison lui fasse défaut[10].
Schizophrénie, troubles oculaires, syndromes obsessionnels: tous ces soupçons de pathologie portés sur l'homme Cézanne cherchent à rendre compte de l'oeuvre de Cézanne. Mais s'il y a vraiment eu quelque chose de psychiatrique chez Cézanne, ou si l'on veut vraiment donner un nom psychopathologique à ce qui est évoqué par son oeuvre (car il ne s'agit pas de l'homme ici), il faut plutôt parler d'agnosie. Il s'agit dans ce cas non pas d'un trouble des organes du sens - notamment de la rétine - mais d'une incapacité du sujet à identifier ce qu'il voit. Le sujet agnosique connaît à travers la vue le monde qui l'entoure mais il ne le reconnaît pas.
Oliver Sacks a décrit cette pathologie dans L'Homme qui prenait sa femme pour un chapeau[11], en parlant du docteur P., un musicien qui souffrait d'une forme de cécité assez singulière: il voyait les choses et les personnes, mais plutôt que de les reconnaître grâce à la vue, il les identifiait uniquement grâce aux autres sens. Ainsi, ses élèves devaient parler afin qu'il soit à même de les reconnaître.
Un jour, Sacks lui tendit une rose rouge: “Il la prit non comme quelqu'un à qui l'on offre une fleur, mais comme un botaniste ou un morphologue auquel l'on apporte un exemplaire. 'Quinze centimètres environs de longueur', commenta-t-il, 'une forme rouge convolutée avec une appendice linéaire verte'. Je lui répondais en l'encourageant: 'Oui. Que pensez-vous qu'elle soit?' Il semblait perplexe: 'Difficile à dire. Cela n'a pas la symétrie simple des solides platoniciens tout en pouvant peut-être avoir une symétrie supérieure qui lui est propre... Cela pourrait être une inflorescence, ou une fleur, je crois'“. Le docteur P. arrive ainsi par inférence, avec peine, très près de la solution, qu'il trouve ensuite d'un coup lorsqu'il hume la rose – parce que, à la différence de la vue, son odorat n`est pas aveugle. Un processus semblable se vérifie lorsque le neurologue lui tend son propre gant. Pour lui, il s'agit uniquement d'une “surface continue enveloppée sur elle-même, pourvue [il hésite] de cinq extensions creuses. S'agit-il d'un container?” Ensuite il enfile par hasard son gant et s'exclame aussitôt: “Mon dieu, c'est un gant!”. Dans l'usage pratique il peut facilement donner un nom à ce que l'approche visuelle ne lui permet pas de nommer. Le docteur P. voit et pense le monde comme le fait un ordinateur, non comme l'habite un animal.
Ce cas est précieux en raison de la haute sélectivité du déficit. Personne intelligente, musicien excellent, le docteur P. est dépourvu de quelque chose que la réflexion philosophique et psychologique elles-mêmes isolent difficilement: l'efficience d'une faculté que Sacks appelle “jugement”. Mais il ne s'agit ni du jugement d'existence (“Socrate est” ou bien “Socrate existe”) ni du jugement d'attribution (“Socrate est un homme”). La pathologie du docteur P. nous indique que dans la vie courante nous utilisons un autre jugement: celui de reconnaissance (“cet homme-là est Socrate”). Ce dernier est un jugement auquel nous sommes aveugles car il se trouve englouti par les prédications d'existence et d'appartenance. C'est un jugement moins intellectuel que les autres étant donné que très souvent certains animaux sont pourvus de cette faculté plus que nous mêmes: le seul être vivant à reconnaître tout de suite Ulysse n'est-il pas le chien Argus? Il s'agit en somme d'une capacité perceptive qui est en partie émoussée par l’accès au langage. Et c'est précisément sur le caractère concret, pré-rationnel, de ce jugement qu'insiste Sacks. En effet, comme l'avait déjà relevé en partie l'analyse phénoménologique, la perception n'est pas une simple sensation: elle comporte des opérations que nous considérons par ailleurs intellectuelles, comme par exemple le fait de juger qu'une chose est “la chose d'avant”. Cette capacité à reconnaître est comme la colle fondamentale avec laquelle on construit ensuite tous les organismes interprétants tels que le sont les êtres humains eux-mêmes.
Pourtant ce monsieur P., qui a un rapport purement inférentiel avec ce qu'il ne reconnaît pas, nous apparaît comme immergé dans le réel. Sacks écrit: “Rien de ce qu'il voyait ne lui était familier”. Le monde était pour lui, visuellement, unheimlich, étranger, méconnaissable (comme l’est le réel objet de toute enquête scientifique). Le cas du docteur P. témoigne ainsi d'un monde d'avant toute interprétation, réduit à un réel pur que le sujet et son regard n'ont jamais colonisé. Mais ne s'agit-il pas exactement de ce qui a été tenté par Cézanne? On ne sait pas si Cézanne était cliniquement agnosique. Il suffit d'affirmer qu'il peignait comme un agnosique, c'est-à-dire qu'à travers une espèce d'ascèse, il était arrivé à se poser les mêmes problèmes de reconnaissance et de reconstruction du réel auquel se confronte un agnosique: comment rendre reconnaissable le réel “martien” des choses visibles? Comment récupérer à travers une réflexion (picturale) ce qui ne peut pas se donner dans l'immédiateté d'une reconnaissance?[12]
3.
Une métaphore de cette exclusion du regard est la façon dont Cézanne traite la lumière. Il l'assume dans ces tableaux, mais dans ces lettres et conversations il témoigne vis-à-vis d'elle d'une grande méfiance. Il en vient même à dire que pour lui elle “n'existe pas”. Et de se plaindre ensuite: “Or, vieux, soixante-dix ans environ, les sensations colorantes qui donnent la lumière sont cause d'abstractions qui ne permettent pas de couvrir ma toile, ni de poursuivre la délimitation des objets, quand des points de contacts sont ténus, délicats; d'où il ressort que mon image ou tableau est incomplet". En effet il est dérangé par la lumière parce qu'elle provient d'une source à l'extérieur des choses. Il ne tolère pas l'éclairage “caravagesque” où le rayon de lumière découvre et isole l'objet de la même façon que l'oeil fixe et regarde la scène qu'il capte. Cette lumière exogène ressemble trop au regard, elle est allégorie et instrument de la révélation picturale, elle subjective l'objet ainsi révélé dans l'obscurité virtuelle de notre voir. La lumière cézannienne est au contraire une lumière qui a cessé d'être le supplément et le symbole du regard sélectif et révélateur: c'est une lumière qui émane des choses elles-mêmes, puisque dans le monde de Cézanne les choses vont vers le peintre, et non l'inverse. Les choses s'imposent au sujet en tant qu'énigme qu'il faut penser et résoudre. Pour Cézanne, “l'obstination” est nécessaire afin que cette partie de nature qui est tombée sous ses yeux puisse lui “donner” le tableau. C'est la nature qui donne le tableau à celui qui sait renoncer à son propre regard captivant sur elle. Cézanne aurait pu dire (en paraphrasant ce que dira ensuite Picasso): “Je ne cherche pas, je me fais trouver par la nature”. Ce n'est pas à nous de faire la lumière sur les choses naturelles, mais ce sont les choses naturelles qui devront se faire lumière en nous.
Mais ce “se faire lumière” des choses en nous-mêmes est une tâche infinie, peut-être impossible: il faut tout de même que notre regard force les choses à se donner avec grâce, qu'il les maîtrise en tant qu'objets pour les éclairer. Le gant n'accorde pas au docteur P. son identité de gant tant que celui-ci l'observe de l'extérieur. Il est nécessaire qu'il l’enfile, qu'il l'articule à son propre corps pour que son identité d'objet lui soit révélée. Mais Cézanne renonce à ce raccourci: il veut que la chose elle-même dicte son propre nom sans être interrogée.
C’est ce qu'il montre dans sa série de tableaux sur la cave de pierre à Biblémus, un lieu disgracieux qui le fascinait. On n'y voit jamais d'êtres humains, seulement des blocs de pierres, déjà coupés en parallélépipèdes par les mineurs. Très peu de couleurs - ocre, vert et bleu - nous restituent ce paysage rêche. Les pierres de cette cave servaient à construire les maisons d'Aix et se situent à mi-chemin entre l'informe et la forme, entre la nature et la culture, entre la matière et l'objet. Comme le fait apparaître la version aujourd'hui au musée d'Orsay: on ne comprend pas quelle est “la chose” (les pierres) et quel est le fond (les arbres et les buissons), la hiérarchie entre choses vides et choses pleines n'a pas encore été établie. La Cave à Biblémus présente des objets à la fois massifs et évanescents qui n'ont pas encore leur nom, dont l'identité tarde. Enigmatiques dans leur présence ébahie, ils semblent juste sortir du chaos d'une perception aurorale pour se diriger vers une reconnaissance qui fait péniblement son chemin à travers leur épaisseur géométrique.
Ainsi, tant l'expressionnisme que le “chosisme”, tendent à représenter ce que l'on ne peut pas représenter: le premier, le regard - le second, le réel qui se trouve au-delà de la vision. La modernité dans son ensemble tend en somme à reproduire l'invisible, ce qui la dispose à l'échec: elle ne peut jamais se reposer sur les lauriers de la représentation. La modernité fleurit tant que l'artiste ne se laisse pas décourager par l'échec, tant qu'il ne cesse pas de viser ce qui ne peut pas être atteint.
Ce labeur gnosique expliquerait entre autres l'extrême lenteur de Cézanne dans son travail: il lui fallait cent séances de pause pour un portrait, ainsi que de longues études préliminaires du sujet, des temps fort lents d'exécution. Cette lenteur est probablement inhérente au fait que Cézanne se méfiait de la fonction synthétique et captante de son propre regard (à moins qu'il ne souffrait d'une carence de cette fonction), de l'intuition compréhensive: il lui fallait reconstruire l'objet. En l'absence d'une reconnaissance globale et immédiate, il lui fallait inférer visuellement l'objet un peu comme le fait le docteur P. avec la fleur.
Ce n'est pas un hasard si Cézanne insiste tellement dans ses lettres et ses conversations sur la logique et l'intelligence. “Il faut se faire une optique”, dit-il, “mais j'entend pour optique une vision logique, c’est-à-dire sans rien d'absurde”. Le tourbillon des apparences constitue l'absurde, mais le peintre doit (re)construire l'objet d'une façon logique, à travers une sorte d'argumentation perceptive. Il doit déduire l'être de l’objet à partir de son paraître. Merleau-Ponty observe: “Cézanne n'a jamais voulu 'peindre comme une brute' mais remettre l'intelligence, les idées, les sciences, la perspective, la tradition, au contact du monde naturel qu'elles sont destinées à comprendre”. Quand Cézanne dit que le peintre doit peindre le visage comme un objet, il précise: “J'entends que le peintre l'interprète, le peintre n'est pas un imbécile”. Il n'intègre pas immédiatement le visage à ses modèles, il l'“interprète”. Son entreprise cognitive austère prend la place du regard d'ensemble, engendré par nos habitudes visuelles et nos tensions émotionnelles, qu'il avait d'emblée décidé de suspendre (à supposer qu'il s'agisse d'un choix). Cézanne ne cesse d'invoquer le contact direct avec la nature, afin d'éliminer le plus possible à la fois l'imitation académique des maîtres classiques et nos traditions visuelles et représentatives, surtout celles qui s'affirment de manière inconsciente. Mais il affirme en même temps: “Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience”. Peindre ne tient pas de la reconnaissance, mais de la connaissance consciente qui reconstruit le visible pour y trouver le sens et l'identité.
4.
Le projet de Cézanne demeure toujours reconstructeur: en renonçant au regard et au désir-angoisse subjectif qu'il implique, il tend à reconstruire un réel reconnaissable, qui montre cohérence et unité. L'aventure cubiste, en revanche, surtout dans sa première phase analytique, procède à une sorte de déconstruction. Peu à peu l'objet - il suffit de voir les différentes et successives versions d'un même sujet que Picasso et Braque ont choisi d'“analyser” - se désagrège, s'effrite en de multiples petits volumes jusqu'à la limite du non reconnaissable ou de la pure abstraction. Qu'est-il arrivé alors dans le passage entre d'une part le monde reconstruit de Cézanne et d'autre part le démontage cubiste? Et pourquoi le cubisme qui marque ce passage nous fascine-t-il encore autant?
Le cubisme en effet évoque une agnosie particulière que l'on constate chez les anciens aveugles (tant de naissance que chez ceux qui le sont devenus au cours de leur enfance) une fois qu'ils ont, à la suite d'une opération chirurgicale, retrouvé la vue[13]. Tous les patients auxquels on a rendu chirurgicalement la vue ont dû en effet affronter d'énormes problèmes de perception de l'espace ou des distances, pendant des mois, voire des années après l'intervention[14]. Beaucoup d'entre eux demeurent déçus par la vue, certains préfèrent redevenir aveugles, et se replient sur le syndrome d'Anton: ils voient dans le sens physiologique, mais leurs esprits ne voient pas, ils oublient leur propre capacité à voir. Parce que leur représentation du monde s'était auparavant construite à partir du toucher et de l'ouïe. Ils se sentent étrangers dans un monde visuel qu'ils n'ont jamais investi de façon subjective. Ils voient le monde objectivement, comme s'ils étaient des machines cognitives sans histoire et sans préjugés, mais ils ne le regardent pas, ils ne l'interprètent pas subjectivement. Or, il faut qu'un sujet interprète le contexte visuel pour s'y retrouver, pour l'habiter. Chaque acte d'interprétation est dans le fond un acte qui domestique et familiarise le monde, qui l'intègre dans notre domus.
Oliver Sacks examine le cas de Virgil, un homme devenu aveugle au cours de son enfance, et qui a retrouvé la vue à l'âge de cinquante ans. Sacks décrit ainsi son comportement: “Ses yeux erraient, accomplissant des mouvements de balayage, et lorsque Amy [sa femme] nous présenta Bob et moi, il ne semblait pas nous voir de façon directe: il regardait vers nous, mais il ne nous regardait pas. J'eus l'impression [...] qu'en réalité il ne regardait pas nos visages, bien qu'il souriait, riait et écoutait avec attention. [...] Le comportement de Virgil n'était certes pas celui d'un voyant, et pourtant il n'était pas non plus celui d'un aveugle. Il était celui d'un sujet mentalement aveugle ou agnosique, à même de voir mais non de déchiffrer ce qu'il voyait. Il me faisait penser à l'un de mes patients agnosiques, le Dr. P., lequel au lieu de me regarder, de m'appréhender de façon normale, fixait soudain, et de façon étrange, tantôt mon nez, tantôt mon oreille droite, en déplaçant le regard vers le bas pour le menton, puis vers le haut pour mon oeil droit, mais sans jamais voir, ‘saisir’ mon visage comme un tout unique”[15].
Autrement dit, chez ce patient, manquait la capacité ou l'impulsion à regarder, c'est à dire le comportement visuel. Virgil n'arrivait pas à utiliser la macula, la partie centrale de la rétine qui nous permet de fixer les objets, donc de les regarder: “Il était dépourvu d'un champ visuel cohérent. Pour son oeil, il était presque impossible de fixer avec précision les objets. Il continuait à les perdre en accomplissant des mouvements de recherche au hasard, pour ensuite les retrouver et les perdre à nouveau”[16]. En outre, il percevait uniquement les couleurs et les formes, et il ne reconnaissait pas ces amas de couleurs et de formes comme des “choses”. Sa vision ressemblait en somme à celle que nous rend un peintre abstrait ou sur la voie de l'abstraction. Il avait des problèmes même pour reconnaître son chat qu'il connaissait tactilement depuis des années: “Il voyait une patte, le nez, la queue, une oreille, mais il ne réussissait pas à voir toutes les parties ensemble, à voir l'animal comme un tout”. On ne sait pas ce qu'il aurait pensé des portraits de Picasso où les différentes parties du visage se juxtaposent de façon non-naturaliste.
Les objets solides sont particulièrement difficiles à reconnaître pour un ancien aveugle, parce qu'ils peuvent être observés depuis plusieurs angles de vue, distances, éclairages, positions, etc. Un autre aveugle qui avait retrouvé la vue, S.B., avait été suivi par Gregory qui dit de lui: “Il n'arrêta jamais d'être surpris par la façon dont les objets changeaient de forme lorsqu'il tournait autour d'eux. Il regardait un lampadaire, il l'étudiait sous différentes perspectives et se demandait enfin pourquoi il semblait tout à la fois si différent et pourtant toujours le même”[17]. Il est très significatif que Sacks cite précisément à ce sujet Cézanne, lequel affirmait que le même sujet, vu d'un angle de vue différent, lui fournissait une matière d'étude du plus grand intérêt et tellement variée qu'elle pouvait le tenir occupé pendant des mois, sans même qu'il doive changer de position, mais seulement se déplacer un peu plus à droite ou à gauche.
Du reste, un ancien aveugle est toujours à même de “voir” une chose lorsqu'il l'a d'abord connue tactilement. On suppose donc qu'il ne peut reconnaître visuellement une chose qu'après l'avoir “caressée” mentalement. Pour lui, le monde ne varie pas vraiment, l'apparence n'existe pas, il n'y a que de la réalité, alors qu'apprendre à voir signifie précisément apprendre à identifier le noyau stable des choses à travers le changement continu de leurs apparences visuelles. L'ancien aveugle doit s'initier à capter la réalité de façon synchronique - alors que la reconnaissance tactile est au contraire diachronique puisqu'il n'existe pas, dans le toucher, l'équivalent du “regard d'ensemble”. Pour Sacks: “Ceux qui ont retrouvé la vue [...] sont déconcertés par le concept même d'“apparence”, précisément parce que celle-ci, étant optique, n'a pas d'équivalent dans les autres modalités sensorielles. Nous qui sommes nés dans le monde des apparences (et des illusions, des mirages et des tromperies qui en résultent), nous avons appris à les dominer, à nous sentir sûrs et à l'aise en leur compagnie. Mais l'entreprise est terriblement difficile pour celui qui a acquis la vue depuis peu”[18].
Or, n'est-ce pas ce dualisme - si métaphysique et pourtant si visuel - entre réalité et apparence que le cubisme analytique a cherché précisément à éliminer? Les problèmes d'un ancien aveugle rappellent la décomposition cubiste de l'objet, celui-ci étant appréhendé simultanément depuis plusieurs points de vue, pour ainsi dire “touché” à tâtons dans une succession continue. La réalité, dans le cubisme, se délite dans la multiplicité irréductible et proliférante des apparences. La peinture futuriste poursuit cette même évacuation du dualisme métaphysique par excellence, entre paraître et être, qui est aussi notre façon d'habiter visuellement le monde. Elle le fait en penchant surtout vers un approche héraclitéenne: tout passe, tout change. Ce triomphe de l'apparence sur la réalité est réalisé par le cubisme en multipliant de façon synchronique les angles de vue alors que le futurisme cherche à le faire en projetant sur une surface synchronique les moments successifs d'un processus objectif.
Naturellement, ni les cubistes ni les futuristes n'ont jamais été aveugles. C'est plutôt grâce à une réflexion picturale sur la visibilité, dont ils ont soustrait le regard[19], qu'ils ont réussi à nous donner une version, ou une projection, visible de la relation qu'un aveugle a avec le monde. C’est pourquoi leurs tableaux rappellent la vision d'un ancien aveugle qui serait resté tel d'un point de vue psychique. C’est une vision qui, par l'absence de regard, garde en effet un caractère éminemment photographique. L'ancien aveugle n'est pas capable d'opérer ces réajustements gestaltistes qui séparent justement notre perception du monde de celle qu'opère un appareil photographique. Lorsqu'une main se rapproche de l'appareil photographique, elle devient monstrueusement immense. Virgil voyait de la même façon, n'ayant même pas une perception des distances. Par exemple, il percevait les oiseaux qui s'approchaient comme devenant gigantesques.
Le patient de Gregory, S.B., subit les tests des illusions optiques. L'un de ceux-ci est basé sur deux lignes parallèles qui, pour un oeil normal, semblent diverger sous l'effet d'autres lignes superposées et entrecroisées. S.B. voit les deux lignes comme parallèles, c'est-à-dire exactement comme elles le sont dans la réalité géométrique. D'autres figures, surtout des cubes et des échelles, sont dessinées en perspective de manière qu'un sujet normal puisse les percevoir comme tridimensionnelles, et ces figures invertissent régulièrement leur configuration apparente. Une fois de plus, S.B. ne les perçoit pas comme tridimensionnelles. Il se montre également incapable de saisir leurs inversions. Autrement dit, le monde visuel de cet ancien aveugle est un monde sans illusion. En effet, la correction gestaltiste dérive du fait qu'inconsciemment nous manipulons les données perceptives afin de réussir à percevoir le monde qui nous entoure comme notre foyer habitable. Si dans un fatras de lignes, sur un papier, nous percevons tout de suite la forme d'un cube, cela provient du fait que, comme nous l'a appris la psychologie de la Gestalt, nous tendons à percevoir la forme la plus simple. Mais en quel sens un cube serait-il une forme plus simple qu'un amas de lignes? Le problème prête à controverse, mais l'important est que dans le cube nous retrouvons notre résidence habituelle, ou possible, c'est-à-dire une forme spatiale capable de nous accueillir. Pour l'ancien aveugle en revanche les formes visuelles ne font pas partie de sa façon d'habiter le monde, car son monde n'est pas un espace visuel. Lorsqu'il voit, il ne retrouve jamais sa propre maison, ses espaces familiers.
Le cubisme est connu surtout pour ses natures mortes, avec ou sans guitare. Les objets familiers, humbles, se prêtent étrangement mieux à être traités à la manière non familière du cubisme. Exactement comme, pour un ancien aveugle, les objets quotidiens de sa propre maison, une fois qu'il est en mesure de les voir, sont surprenants, non familiers, énigmatiques. Virgile observe longuement “les fruits, les bouteilles, les boîtes à métal, les couteaux, les fleurs, les bibelots sur la cheminée...”. Mais un autre aspect suggère une connexion, certainement non casuelle, entre le cubisme d'une part, et le monde visuel de l'ancien aveugle agnosique de l'autre. On connaît les lettres imprimées et les titres de journaux isolés qui se trouvent dans nombreuses natures mortes cubistes. La cohésion de ces lettres d'imprimerie contraste de façon ironique avec la fragmentation des autres objets. Or, les anciens aveugles ont une certaine facilité pour appréhender les lettres et les chiffres. Virgil, qui n'était pas capable de reconnaître un visage, une forme, une dimension ou une distance, reconnaissait en revanche sans aucun problème les lettres, même s'il ne savait pas aligner, ne réussissait pas à lire, ni même à voir, des mots en entier.
Pourquoi donc un ancien aveugle n'arrive-t-il pas à “lire” les êtres vivants et les mots en entier, alors qu'il n'a aucun problème avec les lettres et chiffres indépendants? Cela est probablement dû au caractère symbolique et non agrégatif des lettres et des chiffres. En un certain sens, l'ancien aveugle voit le monde entier comme des “lettres”: les apparences sont pour lui des symboles et non pas des aspects ou des parties de la chose tactile (qui est la seule réalité pour l'aveugle). Les apparences sont des symboles vides, des lettres isolées. Nous ne regardons pas les lettres, nous ne nous arrêtons pas sur elles - autrement elles nous apparaîtraient comme des choses et non pas comme des signes - nous les interprétons rapidement. C'est peut-être pour cette raison que Virgil pouvait affirmer: “Le arbres ne ressemblent à rien de naturel”. Dans la mesure où il en saisissait l'unité, il devait les assimiler à des lettres plutôt qu’à des objets naturels. De façon analogue, le cubisme respecte la totalité visuelle des lettres pour insinuer que le monde visible est, comme les lettres, une série d'éléments déconnectés, que le visible est réinterprétable comme écriture, c'est-à-dire déconstructible. La décomposition par l'instance intelligible prévaut sur la recomposition des choses opérée par le regard qui saisit la totalité de l'objet.
5.
Pourquoi, à propos du cubisme, évoquons-nous les anciens aveugles et non les nouveaux nés qui doivent eux aussi apprendre à voir? Sacks affirme: “Virgil, qui explorait les pièces de sa propre maison en s'interrogeant [...] sur la construction visuelle du monde, me faisait penser à un enfant de quelques mois qui bouge ses propres mains devant ses yeux en dodelinant de la tête, la tournant de ci et de là, dans ses premières tentatives de construction du monde”. Cézanne et ses héritiers entendaient probablement revivre cette expérience des enfants. Mais cette expérience nous est interdite car nous ne pouvons pas nous souvenir de notre première enfance. L'aveugle qui retrouve d'un coup la vue est ainsi le témoin le plus apte de cette initiation première non pas à une façon spécifique de regarder les choses (chaque style pictural propose en dernière instance sa propre façon de regarder les choses), mais aux choses elles-mêmes en tant qu'elles peuvent être dignes d'être regardées.
C'est cette fascination de l'originaire qui conduisit Merleau-Ponty sur le chemin de la phénoménologie, laquelle prétend toujours “recommencer à zéro”. Mais nous ne pouvons pas le suivre sur ce chemin, car en fait on recommence toujours au moins “à trois”. En effet, aucun recommencement ne pourra se passer de ces actes préalables: (1) de notre faculté innée de reconnaître et d'interpréter, (2) de l'héritage perceptif issu de notre histoire et de notre culture, (3) de notre travail d'appropriation visuelle du monde effectué dès notre naissance.
Il est impossible de revenir à un état originaire de la relation de la conscience au monde, simplement parce que cet état originaire est une invention philosophique. En réalité, depuis le début, nous nous sommes trouvés en situation, et nous avons déjà “choisi”. Par ailleurs, l’étude clinique des anciens aveugles s’accomplit au sein d’une controverse philosophique, vieille de trois siècles. Ceux qui, comme Sacks, insistent sur l’échec du passage à la vue de sujets comme Virgil, visent à démontrer une thèse rendue célèbre par Diderot[20]: le monde tactile et auditif de l’aveugle ne coïncide pas avec le monde des voyants. Il nous faut en somme un certain relativisme ontique quant aux possibles façons d’être au monde.
Les hommes du XVIIIe siècle étaient fascinés par le problème des relations entre la vue et le toucher. On se demandait: si un aveugle de naissance retrouve soudain la vue, est-ce qu'il sera capable de reconnaître aussitôt un objet familier sans le toucher? Berkeley[21] répondait par la négative: notre relation au monde basée sur le toucher n'a aucune connexion avec notre relation au monde basée sur la vue. La vérification expérimentale de cette conclusion philosophique parut avoir eu lieu en 1728, lorsque le chirurgien anglais William Cheselden opéra de la cataracte un garçon de treize ans aveugle depuis la naissance. Celui-ci ne réussit que peu à peu à comprendre ce qu'il voyait progressivement, reliant l'expérience visuelle et l'expérience tactile.
Pour Diderot, un aveugle qui apprend à voir n'est pas comme celui qui apprend une nouvelle langue, plutôt il est comme celui qui apprend une langue pour la première fois. L'aveugle se trouve ainsi dans la posture de l'enfant qui, apprenant la langue maternelle, s'initie au langage même. La plus récente littérature clinique tend à donner raison à Berkeley et à Diderot: ayant d'abord construit un monde tactile plutôt autosuffisant (qu'il ne perçoit pas comme déficitaire), l'aveugle n'arrive pas à “traduire” ce dernier dans un monde visuel lorsqu'il retrouve la vue. La tradition de la pensée empiriste mise sur une pluralité irréductible des modalités relationnelles au monde: nos sens ne convergent pas vers la chose, mais, dans la mesure où l'un d'eux prévaut sur les autres, une hiérarchie se met en place. Par conséquent, le sujet concevra le monde sur la base de la syntaxe perceptive à laquelle il a été éduqué.
Cette déconnexion entre les différents sens peut présenter une difficulté pour la psychologie de la Gestalt, voire pour la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, lesquelles insistent au contraire sur le caractère unitaire et total de notre relation au monde: ce ne serait pas l'intelligence inférentielle à réorganiser l'objet à partir d'une série de sensations atomiques, mais c'est l'objet dans son ensemble qui nous serait donné d'emblée dans la perception. Merleau-Ponty s'intéresse à Cézanne dans la mesure où celui-ci réaliserait en peinture le même geste que Husserl effectua en philosophie: la mise entre parenthèses de tout ce qui nous a été transmis, de tout ce que nous avons appris ou hérité, pour revenir à un état originaire, pur, élémentaire et surtout immédiat dans la relation de la conscience intentionnelle au monde.
Merleau-Ponty ne s'intéresse donc pas au cubisme, au sein duquel cette prétention à l'immédiateté s'évanouit dans la déconstruction de l'unité perceptive de l'objet. Or, ce faisant, le cubisme dévoile jusqu'où la relation de Cézanne au monde visible était elle aussi une relation de construction. Lorsque Cézanne dit: “Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet d'un plan se dirige vers un point central”, il se prescrit une méthode pour retrouver l'objet non pas comme intuition immédiate de la conscience perceptive, mais comme point d'arrivée d'une reconstruction ascétique effectuée à partir de certains a priori géométriques. Rapprochant le travail de Cézanne de celui d'un agnosique, qui ne peut reconnaître le monde environnant qu'à travers des inférences logiques, nous ne voulons pas dire par là que Cézanne serait plus proche que n’importe quel autre de la vérité du réel, de même que l'agnosique n'est pas plus proche de quelqu'un de normal de la réalité perceptive. Autant Cézanne que l’agnosique, tous deux étant dépourvus (par choix ou par maladie) d’une faculté de synthèse a priori, nous révèlent une possibilité d’être dans le monde qui demeure ignorée par la connaissance normale.
Émile Bernard et Zola avaient peut-être raison d'affirmer que l'entreprise de Cézanne avait échoué. Pour Zola, le maître d'Aix était presque un suicidaire: il visait la réalité, et il s'interdisait les instruments pour l'atteindre. En fait, cet échec constitue sa réussite dans l'entreprise de nous rendre sensible une orientation métaphysique: un réel en soi et pour soi qui s'éclairerait au-delà de tout réalisme académique des objets. Cette métaphysique devient compréhensible uniquement si l'on saisit qu'à son origine se trouve un immense travail engendré par un renoncement (ou par un handicap dans le cas d'une agnosie). C'est en ce sens que Cézanne, différemment de ce qu'en pensait Merleau-Ponty, nous attire. Non pas parce qu'il nous révélerait une relation plus originaire avec les choses (une relation que nous aurions perdue au cours du processus de domestication de la nature et de la perception), mais parce qu'il nous révèle une relation avec le monde qui aurait pu être aussi la nôtre. Sur un mode analogue, le cubisme, lui non plus, ne nous dévoile pas un rapport plus authentique ou plus immédiat avec les objets extérieurs. Il nous pousse plutôt à reparcourir une relation au monde dans laquelle se dissipe la différence entre apparence et réalité, c'est-à-dire une relation qui n'est pas la nôtre, mais qui est néanmoins possible (qui se réalise dans la relation tactile qu'a l'aveugle avec les choses). Autrement dit, le cubisme épouse les thèses de Berkeley et de Diderot sur la déconnexion entre monde tactile et monde visuel.
Lorsque les artistes reprennent (même inconsciemment) le chemin de ceux qui sont affectés par une pathologie neurologique, ils font quelque chose qui va dans la même direction que lorsqu'ils s'inspirent (consciemment) des formes d'art exotiques. On connaît l’importance qu’a eu le monde de l'enfance ou la vie polynésienne pour Gauguin, les masques Dogon pour Picasso, l'Orient et l'Égypte pour Matisse, l'art des Cyclades pour Brancusi, etc. Les formes esthétiques des cultures archaïques ou sauvages, autant que les expériences d'aveugles, de sourds-muets, d'enfants, de psychotiques, d'autistiques, d'handicapés sensoriels ou mentaux, etc., nous dévoilent, à nous “normaux, occidentaux, adultes et modernes”, d'autres modes possibles, voire réalisés, d'être au monde. Nous découvrons qu'il y a bien d'autres façons d'être des humains, des façons qui ne sont ni inférieures ni plus pauvres que les nôtres. Au fond, chaque modernisme artistique mise sur la pluralité, au moins hypothétique, des modalités humaines de se rapporter aux choses. Autrement l'artiste moderne ne nous proposerait pas des reconstructions de la réalité qui apparaissent à première vue totalement arbitraires et non-naturelles. En pointant ces modalités si différentes des nôtres, l'artiste modifie l'horizon de ce que nous reconnaissons comme humanité.
C'est ainsi que nous nous sommes éloignés de la phénoménologie: nous ne visons plus l’originaire, mais la différence, ou plutôt la pluralité des différents. Faire épochè de ce que nous avons appris demeure toujours un acte philosophiquement et picturalement valable, et indispensable pour comprendre l'aventure moderniste. Mais il faut aussi être capable d'une approche “relativisante” qui soit de quelque façon contraire: jouir de la variété des apprentissages, des croyances et des formes de vie. Aujourd'hui plus que jamais, cette variété devient l'antidote à la tendance du monde actuel, lequel semble aspirer à homologuer les différences, voire à réduire tout un chacun à un dénominateur commun minimal de la computation rationnelle.
Traduit de l'italien par Jean-Luc André A. D'Asciano
[1]Chirurgien anglais qui, en 1728, opéra de la cataracte un enfant de treize ans, lui rendant ainsi la vue.
[2]Cf. Sergio Benvenuto, “Réflexions de la modernité”, in Ligeia, no 3-4, octobre 1988, Paris, pp. 89-105; “Riflessioni della modernità”, in Rivista di estetica, 8, 2/12, anno XXXI, Rome, pp. 27-46.
[3]Cf. Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, ch. VI-IX, Seuil, Paris 1973. Durant ces dernières années, les études esthétiques basées sur l'analyse du regard et de la vision se sont multipliées. Cf., par exemple, Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Éditions de Minuit, Paris 1992.
[4]Cette identité de fond entre désir et angoisse - l’angoisse est un désir dont le moi n’en veut pas - est un principe de base de la doctrine freudienne.
[5]Maurice Merleau-Ponty, “Le doute de Cézanne”, Sens et non sens, Nagel, Paris 1958, p. 28.
[6]Ibid., pp. 29-30.
[7]Ibid., pp.23 et 25.
[8]Dans une lettre du 26 mai 1904, in Paul Cézanne, Correspondance, Grasset, Paris 1937.
[9]“Il y a un rapport entre la constitution schizoïde et l'oeuvre de Cézanne parce que l'oeuvre révèle un sens métaphysique de la maladie (...) que la maladie cesse alors d'être un fait absurde et un destin pour devenir une possibilité générale de l'existence humaine (...) et qu'enfin c'est la même chose en ce sens-là d'être Cézanne et d'être schizoïde” (Merleau-Ponty, op. cit. p. 35)
[10]Dans une lettre à Paul Bernard du 21 septembre 1906.
[11]Je cite ici d'après la traduction italienne, paru chez Adelphi, Milan 1986.
[12]Un sentiment d'extranéité et de non-reconnaisssance des choses semble se retrouver dans une grande partie de l'art moderne. La sensation d'une “chose vue pour la première fois” est par exemple perceptible dans les tableaux de De Chirico, Magritte ou Max Ernst. Mais, dans ces cas-là, l'effet d'extranéité ne naît pas d'une élimination du regard sur l'objet lui-même. A la différence de ce qui se passe chez Cézanne, ces peintres produisent cet effet par des procédés syntaxiques qui produisent de véritables absurdités sémantiques. Ainsi, la peinture surréaliste re-élabore l'art classique, mais n’instaure pas une nouvelle relation avec les objets naturels. Ses effets sont d'ordre logique (dans la mesure où la peinture est semblable à un discours articulé) et non d'ordre perceptif. Lorsqu'un peintre surréaliste poursuit la mise en scène d'une rencontre entre un parapluie et une machine à coudre sur une table d’opération (l’exemple est donné par Dali), les objets en question sont ceux-là mêmes de la tradition picturale académique. Il s'agit en somme d'objets parfaitement reconnaissables et c'est uniquement leur juxtaposition inhabituelle qui provoque l'absurde surréaliste. Il ne s'agit certes pas d'agnosie, car le surréalisme opère sur l'effet sémantique global (évoquant un univers dont les lois semblent être différentes de celles de notre monde réel) et non sur les objets.
[13]Les connexions entre cécité et peinture ont été en partie interrogées par J. Derrida, Mémoires d'aveugle, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris 1990.
[14]Voir par exemple A. Valvo, “Sight Restoration after Long-Term Blindness: The Problems and Behavior Patterns of Visual Rehabilitation” in American Foundation for the Blind, New York 1971; R.L. Gregory & J.G. Wallace, “Recovery from Early Blindness: A Case Study” in Quarterly Journal of Psychology, 1963; republié in R.L. Gregory ed., Concepts and Mechanism of Perception, Duckworth, London 1974.
[15]Oliver Sacks, “Vedere e non vedere”, in Un antropologo su Marte, Adelphi, Milan 1995.
[16]Ibid., p. 168.
[17]R.L. Gregory & J.G. Wallace, “Recovery from Blindness: A Case Study”, op. cit.
[18]Ibid., pp. 184-5 note.
[19]D'ailleurs l'art abstrait est le résultat de cette soustraction du regard.
[20]Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749).
[21]An Essay towards a New Theory of Vision (1709).
Flussi © 2016 • Privacy Policy
 IT
IT EN
EN