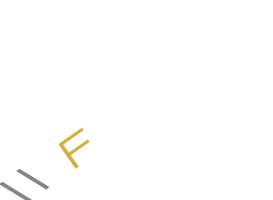La jouissance tragique. Entre Aristote et FreudMar/10/2017
Sergio Benvenuto
“No, not happiness! Certainly not happiness! Pleasure. One must always set one’s heart upon the most tragic.”[i]
Oscar Wilde (The picture of Dorian Gray)
Depuis quelques siècles, à maintes reprises, des penseurs s’interrogent sur ce qui nous pousse à assister à des représentations tragiques, pour en tirer du plaisir. [Nous, les citoyens des démocraties occidentales ; après les polîtai de la cité grecque et, à l’âge classique, les sujets des monarchies absolues]
J’appelle tragique toute oeuvre - pas seulement de théâtre, mais aussi bien cinématographique, littéraire ou qui relève du mélo - qui mette en scène des deuils, des malheurs ou des défaites, et dont le dénouement est généralement triste. Ainsi, nous nous demandons pourquoi des catastrophes, qui lorsqu’elles sont vécues dans la réalité nous accablent par une immense douleur, nous donnent au contraire du plaisir, d’une qualité très spéciale, lorsque nous les voyons se dérouler sur une scène ou lorsque nous les lisons dans une œuvre de fiction. D’où naît, et en quoi consiste-t-il, ce besoin ou, si on veut, ce désir/plaisir de pleurer?
Notre civilisation est très fière de sa jouissance tragique, qui sépare le public cultivé de ceux qui ne sont pas capables de tirer du plaisir du Trauerspiel, de la représentation qui mène au deuil. Le « menu peuple » et les enfants n’aiment pas les dénouements tragiques. Pendant plus d’un siècle, les metteurs en scène anglais, se refusant à représenter la mort de Cordelia, se sont plus à changer le dénouement de King Lear qui à leurs yeux manquait d’humanitas. Aujourd’hui, lorsqu’on refait à Hollywood un film produit auparavant en Europe et qui souvent obtient un succès beaucoup plus large que son modèle européen, si le premier s’achevait par une fin triste on le modifie avec un happy end. Le grand public exige que la Justice l’emporte.
Contrairement au public populaire, envoûté par ce qui est Kitsch, le spectateur qui sait goûter du plaisir tragique y éprouve sa maturité, sa force, sa maîtrise. Nous sommes des admirateurs de la tragédie antique parce que nous y voyons l’expression d’une civilisation que nous élevons au sommet de la noblesse.[ii]
Nous jugeons la jouissance qui nous donne le tragique comme un plaisir sublime, au sens qu’avait ce mot au XVIIIème siècle et notamment chez Kant, qui a soigneusement distingué le sublime du beau. Dans sa Critique de la faculté de juger, Kant classe comme “sublimes” des oeuvres préromantiques, comme les représentations de mers en tempête ou des montagnes solennelles, ce qui rompait avec les critères classiques en vigueur dans les beaux-arts. Selon la Critique kantienne, le “sublime” provoque un « plaisir désagréable » autant qu’un « déplaisir agréable ». Kant fait, partant, une distinction entre le “sublime mathématique”, qui nous excite par un plaisir qui déplaît (le paradigme est la contemplation du ciel étoilé), et le “sublime dynamique” (le paradigme est la vision d’une tempête), qui nous émeut par un déplaisir qui plaît.[iii] Il semblerait que l’œuvre tragique tombe du côté du sublime dynamique: elle nous cause un déplaisir qui plaît. Nous y reviendrons.
Mais la question demeure : quelle jouissance, qu’elle soit sublime ou non, tirons-nous d’une œuvre lorsque nous assistons aux souffrances et à la ruine/destruction de notre héros ? Les réponses les plus importantes qu’on a tenté de donner à cette énigme ont été celles d’Aristote d’abord et celle de Freud ensuite.
- 1. Aristote : le plaisir de la fiction
Le déclanchement des émotions, avec le cortège de plaisirs équivoques qu’elles entraînent, est placé par Aristote au cœur de son analyse de la poésie tragique. La tragédie est une poïesis, à savoir une production qui implique un savoir-faire, et plus précisément elle est «l’imitation ou simulation d’une action» (mimesis praxeos[iv]), qui pourtant produit chez le spectateur un effet qui est le contraire d’une action (praxis, pragma), c’est-à-dire des pathemata, des émotions - des affects dirions-nous -, et donc une passivité. Les tragédies n’avaient pas toutes un dénouement (lysis) catastrophique, mais en tout cas le spectateur était affecté par deux émotions: la pitié (eleos) et l’angoisse (phobos) - autrement dit compassion et terreur – vis-à-vis des malheurs dont le héros était frappé. Justement parce qu’il assistait aux errements du héros et qu’il pressentait le destin pénible auquel il était voué, il pouvait s’en apitoyer et en même temps en être angoissé. Comme le dit Thomas d’Aquin[v] à propos de celui qui souffre pour un mal dont est frappé quelqu’un d’autre, nous pourrions dire que le spectateur de la tragédie est miséricordieux, c’est-à-dire le contraire d’un homme envieux. Mais la miséricorde est une passion autant que son contraire, l’envie.
Aristote écrit que si l’on veut produire chez le public du plaisir, moyennant l’angoisse et la pitié, on ne doit pas le rebuter « en lui montrant des hommes excellents qui tombent soudainement d’une condition de bonheur dans le malheur ». Un auteur tragique n’aurait jamais dû représenter la mort de Socrate, ou, à notre époque, celle du Mahatma Gandhi par exemple. Mais Aristote n’admettait pas non plus la représentation « d’un homme intégralement méchant, qui du bonheur se rue dans le malheur[vi] ». Dans le premier cas nous aurions à faire avec un destin par trop injuste, dans le second avec un destin trop juste, qui ne saurait émouvoir le spectateur. C’est miarón, maudit ou rebutant, le revirement auquel tò philanthropon, l’« amitié pour l’être humain »[vii], fait défaut. Selon Aristote, n’est recevable pour nous que ce qui s’accorde à nos goûts moraux. La tragédie ne peut pas représenter des événements tout à fait injustes ou trop justes. L’esthétique tragique se fraye sa voie dans un espace d’incertitude des valeurs éthico-politiques. Le héros tragique, c’est quelqu’un qui balance entre l’infamie et la gloire, le blâme et la louange : il s’agit d’un homme ou d’une femme à mi-chemin (metaxú)[viii] entre vertu et justice d’une part et méchanceté et ineptie de l’autre.
Il faut quand même se demander pourquoi et comment la pitié et l’angoisse peuvent donner du plaisir lorsqu’elles sont provoquées par une simulation. Aristote associe volontiers la fonction mimétique de l’art à la jouissance, au chairein. Il écrit: «Tout le monde se réjouit des imitations (tò kaìrein tois mimémasi pàntas)» et d’ajouter: «En est la preuve ce qui se déroule devant les oeuvres [tragiques]: les mêmes faits auxquels nous assistons avec douleur [dans la réalité], nous donnent du plaisir lorsque nous voyons leurs images (tas eikonas) les plus fidèles possible»[ix]. C’est ainsi que la pitié et l’angoisse, désagréables en elles-mêmes, lorsqu’elles sont suscitées par la mimésis, nous donnent du plaisir. La jouissance qu’on peut tirer de la représentation d’événements tristes ou effroyables nous est donnée justement par son caractère de représentation. En fait la Verfremdung, la distanciation, que Brecht déjà opposait à l’identification classique avec le héros, est à l’oeuvre depuis toujours dans le théâtre, comme la condition même du plaisir qu’on y prend: ce n’est pas l’événement pénible qui produit notre jouissance, mais son caractère de fiction et donc son inactualité. Néanmoins, si la vicissitude (peripéteia) se montre à nous comme une possibilité propre à nous et quasi-actuelle (que ce soit dans le passé ou dans l’avenir) sa représentation même peut nous rebuter ou nous effrayer. C’est ainsi qu’Hamlet tente de faire avouer à son oncle, le roi Claudius, le meurtre du roi, par la mise en scène d’un spectacle où l’histoire est, en hypothèse, tout à fait semblable à la réalité tenue cachée.
Il est évident que les spectacles qui nous donnent du plaisir ne sont pas tous tragiques. Écrit Aristote: «de la tragédie on ne doit pas tirer un plaisir quelconque, mais le plaisir qui lui est propre» et encore «le poète [tragique] doit procurer le plaisir en le tirant par la simulation de la pitié et de l’angoisse»[x]. Parmi tous les produits de la poïesis, dont se réjouissent les humains, la tragédie se caractérise par ce fait qu’elle, par les procédés de l’imitation-simulation (mimésis), nous offre un plaisir paradoxalement lié à la pitié et à l’angoisse.
Et Aristote d’ajouter que le spectateur tire de la tragédie un plaisir qui va bien au-delà du simple plaisir d’assister à une simulation réussie. Il met au jour le trait spécifique du plaisir tragique : le spectateur en assistant au dénouement du drame expulse ces affects - la pitié et l’angoisse -, se délivre de la miséricorde. Aristote nomme katharsis cette délivrance.
- 2. Aristote : la katharsis
Depuis la Renaissance on s’efforce en vain de comprendre ce qu’Aristote entendait vraiment par katharsis et le débat se poursuit de nos jours. Tous les sens possibles de ce terme grec ont étés évoqués pour comprendre la katharsis au sens aristotélicien : katharsis comme lustration ou comme nettoyage, comme purge, comme menstruation ou comme défécation[xi]. Et comme la katharsis est un concept médical, elle gagnerait à être comprise dans le cadre des théories médicales de l’époque, qui concevaient la cure comme l’élimination d’un excès d’humeurs. Dans ce sens, la katharsis aurait, au plan psychique, la fonction d’une saignée, serait l’élimination d’un excès d’émotions. Essayons cependant de comprendre la thèse aristotélicienne de la katharsis dans les termes de la psychologie moderne.
Nous pourrions dire aujourd’hui que pour Aristote la katharsis était certainement un plaisir[xii], plaisir qui gardait pourtant la marque de la douleur dont elle délivrait le spectateur. C’est comme quand on massage un point névralgique : la stimulation du point endolori nous cause un plaisir aigre-doux qui délivre, douleur exquise et finalement agréable, parce qu’on défait un nœud et relâche quelque chose de raide. Une raideur – il faut le souligner - qui n’est pas physique ici, mais psychique et qui est à la source de l’ennui au sens fort: ennui qui nous pousse à voir des spectacles pitoyables ou angoissants.[xiii] Dans cet ennui, il y a une potentialité de pitié et d’angoisse qui, ne pouvant pas s’actualiser par manque d’événements, se retourne contre nous comme un boomerang : pur désir de jouissance qui ne rencontre aucune souffrance dont le sujet pourrait jouir. On voit bien l’ennui qui déjà énerve le petit enfant en quête de stimuli pour être détourné de son vide. Nous nous ennuyons parce que nous vivons dans l’attente de quelque chose de plaisant ou d’angoissant qui nous arrive. Tout compte fait les divertissements, au nombre desquels il faut ranger les spectacles tragiques, nous détournent de l’ennui, nous protègent de la dépression.
La clinique psychiatrique et psychanalytique a souvent décrit des dépressions “vides” et le “Soi vide” : le sujet y éprouve un sentiment de détresse à cause d’un vide qui ôte à son existence ses couleurs et son sens. La vie devient terne et grise. Ce blank self se plaint de sa sécheresse, il n’a presque plus le sentiment d’exister. Chacun de nous peut s’apercevoir de cette dépression in statu nascendi, par ses tout premiers symptômes, comme cet ennui vague, mais envahissant, qui nous pousse à rechercher de représentations émouvantes pour raviver la vie. Ce même désir qui nous conduit au cinéma ou au théâtre, ou bien qui nous colle devant un écran de télévision, en excite d’autres à des mises en scène perverses. Mais finalement personne ne peut se passer d’art si l’on veut jouir d’un coup de vie.
Le spectacle dont le dénouement est triste nous procure tout de même ce plaisir paradoxal qu’on nomme katharsis : vrai shiatsu de l’âme, plaisir tout à fait différent de celui que nous donnent par exemple les récits d’aventure. Au reste, même ceux-ci provoquent en nous pitié et angoisse, car le héros est souvent en danger ; la différence tient dans le dénouement, heureux ici, mais qui empêche alors la katharsis d’opérer. Dans la tragédie, au contraire, l’évacuation de nos affects de miséricorde confirme les raisons de notre pitié et de notre angoisse. De cette confirmation naît la jouissance tragique dans sa spécificité.
Pour que le plaisir cathartique se produise, il faut donc que l’action (praxis) représentée mobilise d’abord ces passions dont nous sommes affectés sans pouvoir véritablement réagir. La tragédie nous rend d’abord malades pour nous guérir ensuite.
De toute façon le plaisir tragique se révèle être une cure temporaire : je peux jouir plusieurs fois, ma vie durant, des spectacles tragiques, sans guérir - par bonheur ! - de ce qui me permet d’en jouir. La katharsis ne m’apporte pas la guérison définitive. De temps en temps, je me rends au théâtre, au cinéma, parce que j’ai envie de ce “massage”. Quelle est la blessure ou le noeud douloureux que le tragique masse en nous, nous procurant ainsi ce plaisir qui nous délivre de nos affects ? Aristote ne le dit pas, mais aujourd’hui nous pouvons risquer quelques hypothèses.
L’ennui dépressif qui gît au fond de l’attitude du spectateur répond peut-être à une injustice originaire qui frappe la condition humaine, à la déception que l’enfant a ressentie très tôt à l’égard d’une promesse que les tout premiers soins de ses parents semblaient renfermer : qu’il méritait des gratifications constantes et pour toujours. Cette promesse d’un amour secourable, gratuit et gracieux, s’est trouvée bientôt désavouée par la réalité - et d’abord par ses parents eux-mêmes. Il n’est pas vrai que nous méritons toujours nos propres jouissances ou nos propres souffrances. L’expérience de la douleur, dans la mesure où celle-ci apparaît injuste et insensée, forme ce nœud parfois bien trop serré que l’art sans cesse vient masser afin de le dénouer. En fin de compte, dans la plupart des cas, les arts nous permettent de nous arranger avec l’injustice, qui ne manque jamais dans le monde, en nous donnant comme prix de consolation le frisson d’une jouissance esthétique.
3. Freud : le Prince du plaisir
Lisons Freud à présent.
Heidegger disait qu’il faut chercher dans tout grand penseur l’unique pensée autour de laquelle s’est bâtie la structure tout entière de son discours[xiv]. Quelle est donc la pensée majeure de Freud, d’après laquelle on peut rendre compte de l’élaboration de sa théorie, des difficultés qu’il a rencontrées, et en même temps de son intérêt pour le tragique ?
Je crois que sa grande pensée est die Lust, terme qui a été traduit le plus souvent par “plaisir” - plaisir comme cause dernière (à la fois efficiente et finale)[xv] de l’activité psychique. En fait la puissance explicative de la doctrine freudienne découle de l’ambiguïté fondamentale du terme Lust, qui a un emploi double, puisque en Allemand Lust veut dire aussi bien plaisir que son contraire, soit désir, convoitise, l’avoir envie de... sous lequel Freud subsume toutes les tensions désagréables. Der Lustprinzip freudien - le principe de plaisir - pourrait aussi être entendu comme “le principe du désir” et donc du déplaisir !
Selon Freud, la vérité de l’être humain est à chercher dans die Lust : l’homme est un étant fondamentalement poussé par des désirs ou par des pulsions qui tendent au plaisir, ou bien au moindre déplaisir possible. L’essence de l’être humain, et plus généralement du vivant, est de désirer obtenir du plaisir[xvi]. On peut définir ce principe dans les termes, que nous empruntons aux Anciens, d’archè et de télos. Archè, parce qu’il est au commencement de l’agir humain - ce qui autorise la psychanalyse à se constituer comme une généalogie des activités psychiques et pas seulement comme une théorie psychiatrique parmi d’autres ; mais archè renvoie aussitôt à un télos (la “fin” dans le double sens de “terme” et de “but” et donc de “cause finale”) de l’action qui commande cet agir. Si on veut bien excuser le jeu de mots : die Lust est en même temps le principe et le Prince du monde vivant.
Ce principe, Freud le trouve dans le legs de l’empirisme et de l’utilitarisme britanniques[xvii], auquel il a emprunté certaines prémisses de sa recherche. « La nature - a écrit Bentham - a placé l’homme sous la domination (governance) de deux suzerains: la douleur et le plaisir. »[xviii] L’utilitarisme considère l’homme à l’instar de l’Arlequin de Goldoni, serviteur de deux maîtres, qui pour Freud sont en réalité les deux profils du même visage, celui du Prince Lust. Puisque le plaisir est envisagé par Freud comme le résultat d’une diminution du désir, avec ses tensions douloureuses, le plus grand plaisir qu’on peut attendre c’est une diminution du déplaisir.
Le pari théorique freudien est donc le suivant : die Lust nomme l’essence de l’homme ; Lust comme désir pousse l’homme à l’action, et Lust comme plaisir prend la forme du but pulsionnel. Dans le cadre de ce pari le tragique fait problème. Le présupposé freudien nous incite à poser cette question : « Mais alors pourquoi l’homme ne se contente-t-il pas de spectacles tout en rose, au lieu d’aller chercher une exaltation artistique dans l’échec que la tragédie lui présente? Si la pitié et l’angoisse déclenchées par certains spectacles nous procurent un plaisir spécifique, à quelle espèce de plaisir avons-nous affaire, qui requiert comme conditions de sa possibilité la pitié et l’angoisse ? »
4. « Le drame psychopathologique »
Dans un article de 1905[xix], Freud s’essaya à définir les conditions du plaisir propre à la tragédie. Il pensait que les adultes tirent du spectacle tragique un plaisir analogue à celui que l’enfant tire du jeu : tandis que l’enfant joue à faire l’adulte, le spectateur adulte joue à faire le héros. «Le spectateur vit trop peu de choses, il se sent comme ‘Misero’ qui vit à un très bas degré d’intensité, ressent la misère de son existence, où rien de grand ne peut lui arriver.»[xx] Le drame alors lui donne le plaisir de se sentir “grand”. Pourtant, le héros tragique atteint sa grandeur dans l’affrontement à une situation conflictuelle qu’on peut dire grande parce qu’elle le dépasse. Lorsqu’il entre en lutte avec la divinité, nous avons une tragédie essentiellement religieuse ; s’il se retourne contre l’ordre social, nous avons la tragédie bourgeoise ; si le conflit se passe essentiellement entre le héros et son antagoniste, nous avons la tragédie de caractères ; tandis que dans le drame psychologique le conflit se déroule au niveau du psychisme entre les différentes impulsions du personnage.
Mais le drame passe de psychologique au psychopathologique lorsque le conflit n’a lieu qu’entre une impulsion consciente et une autre inconsciente. Nous avons ici le type de la tragédie moderne, dont le premier exemple est Hamlet. En fait, selon Freud, les deux exemples de tragédie les plus probants pour sa théorie sont l’Oedipe tyran de Sophocle et Hamlet. Dans toutes les deux il a reconnu une mise en scène de désirs primordiaux : tuer son père et coucher avec sa mère. Mais comment le drame nous permet de reconnaître nos désirs refoulés ? Dans le cas d’Hamlet, comment se fait-il que le drame nous intéresse justement parce que nous y reconnaissons nos désirs d’inceste et de parricide ? Freud, dans la tentative de rendre compte du comment on puisse tirer du plaisir de cette reconnaissance, hésite entre deux explications.
En fait, pour apprécier des drames psychopathologiques comme Hamlet, il faut le public névrotique de la modernité - nous sommes tous de quelque façon “hamlétiques”, au sens que le refoulement dont nous les modernes nous sommes capables est fragile. Mais le retour du refoulé induit d’habitude du déplaisir, de l’angoisse, plutôt que du plaisir. D’où vient alors ce plaisir de voir représentés sur scène nos conflits primordiaux ?
De ces conflits où le héros succombe, dit Freud, jaillit pour nous du plaisir grâce à (1) la satisfaction masochiste du spectateur (que nous allons bientôt analyser) et (2) « à la jouissance inhérente à la personnalité dont l’héroïque grandeur se trouve exaltée dans la tragédie »[xxi]. Il faut quand même que le spectacle n’attriste pas trop le spectateur et que l’auteur sache « compenser, par les satisfactions qu’il rend possibles, la pitié qu’il a d’abord suscitée ».
L’essentiel de la représentation tragique est qu’elle rend possible la reconnaissance, par le spectateur, de sa pulsion refoulée. Mais cette reconnaissance, qui pourrait expliquer l’intérêt du drame pour nous, doit être partielle, même plutôt manquée : si le désir refoulé se dévoilait clairement, il s’en suivrait de la répugnance plutôt que du plaisir. En fait, d’un autre point de vue, Freud est forcé d’admettre que la tragédie n’entraîne aucune prise de conscience. Et il conclut : « Dans Hamlet le secret était si bien caché que j’ai été le premier à le deviner. »[xxii]
[pour que la tragédie soit réussie] au fur et à mesure que l’impulsion qui est en train d’émerger dans la conscience va être de plus en plus reconnue de façon certaine, il faut que d’autant moins cette impulsion soit nommée par son nom de façon claire, afin que chez le public le processus puisse s’accomplir à nouveau tandis que son attention est distraite....
Le processus auquel Freud se réfère est de toute évidence le travail que le désir doit accomplir pour se faire reconnaître. Le spectacle remplit cette tâche par ce qu’il cache et dévoile en même temps : il n’y aurait pas d’œuvre d’art, ni plaisir du spectateur, si on lui montrât la vérité toute entière. L’art se prévaut d’une vérité qu’il fait apparaître dans la pénombre, mais en nous détournant de la vision de cette vérité qu’il fait émerger.
On voit bien qu’ici le drame tragique est décrit par Freud comme un symptôme névrotique ; mais il serait aussi semblable au mot d’esprit qui, tout autrement que le symptôme, au lieu de nous faire souffrir, nous donne du plaisir. Donc, la jouissance tragique n’est pas ego-dystonique, mais ego-syntonique. De même que le symptôme ou le rêve, le drame fait paraître le refoulé, sans jamais le dire. Dans ce non-dit ou mi-dit, se montre la résistance que l’auteur doit garantir au spectateur pour que le processus tragique lui procure du plaisir plutôt que de la répulsion. Mais nous avons vu que cette jouissance tragique est possible pour Freud parce qu’il considère le spectateur moderne plus névrotique que l’ancien. Dans Oedipe tyran, les désirs refoulés - le parricide et l’inceste - pouvaient être montrés plus ouvertement, bien que projetés dans le réel : il n’y était pas dit qu’Oedipe désirait tuer son père et coucher avec sa mère ; on disait plutôt qu’il avait commis ces crimes parce que tel était son destin. Dans Hamlet, qui est l’équivalent moderne de l’ancienne tragédie d’Oedipe, ces désirs primordiaux se montrent d’une manière beaucoup plus indirecte. Le théâtre et le cinéma qui séduisent l’homme moderne poussent au plus haut degré la reconnaissance de la vérité subjective en même temps que sa méconnaissance.
En fin de compte, quelle différence y a-t-il entre cette reconnaissance par l’art et celle que l’interprétation de l’analyste rend possible à l’analysant ? Si l’interprétation d’Hamlet, par exemple, en termes d’« oedipe » est correcte, elle devrait nous amener à perdre tout intérêt pour le drame de Shakespeare, de même que le sujet névrotique perd tout intérêt pour son symptôme, et donc il en guérit lorsqu’il est mis en condition de l’interpréter correctement. En d’autres termes, l’interprétation psychanalytique ne devrait-elle pas nous guérir du charme tragique ? Et bien, par bonheur elle ne nous guérit pas du tout. Freud, toutefois, n’a pas pris cette dernière objection à son compte.
Généralement parlant, la thèse de Freud sur le drame tragique - ainsi que ses principales théories - pivote autour de ce que Lacan a compris comme une dialectique de la reconnaissance. Le refoulé presse pour se faire reconnaître et trouve à s’exprimer dans les formations les plus diverses - rêves, symptômes névrotiques, mots d’esprit, actes manqués, oeuvres d’art - qui, toutes, tandis que lui confèrent une expression, le déguisent et le cachent. Dans le spectacle dramatique se montrent nos vrais désirs, mais l’art, sous ses formes propres, « re-masque » pour nous cette vérité. Le problème reste, alors, de comment “reconnaître” la reconnaissance vraie. Le débat entre les différentes écoles de psychanalyse est axé sur la difficulté qu’il y a à rendre compte des effets thérapeutiques (mais aussi bien cognitifs, affectifs etc.) des diverses interprétations en tant que prétendues reconnaissances de la vérité de nos désirs. En fait, chaque dévoilement, qui arrive grâce à une certaine interprétation, peut être compris comme une re-mythisation, comme un récit qui, une fois de plus, dissimule la vérité en la dévoilant.
Platon prônait la reconnaissance philosophique du fait que le monde sensible n’est rien qu’une apparence et que la vraie réalité est ailleurs. Mais celui qui arrive à sortir de la caverne platonicienne ne voit pas seulement les choses vraies en pleine lumière ; il lui faut ensuite rentrer dans l’obscurité de la caverne pour y développer sa paideia, pour enseigner aux autres prisonniers enchaînés à reconnaître que ce qu’ils voient sur le fond de la caverne ce sont des ombres et nullement quelque chose de réel. Cette paideia est devenue dans les Temps Modernes la Bildung des Allemands, où la reconnaissance se résume dans la formation. Ainsi, à cette paideia ou Bildung qu’est la cure, Freud applique le modèle platonisant de la reconnaissance du désir refoulé. Mous l’avons dit : pour Freud, à première vue, nous sommes soumis à la loi du Prince du désir/plaisir. L’être humain est donc appelé à reconnaître cette domination du Lustprinzip comme sa vérité la plus propre. C’est dans cette reconnaissance de sa propre “passion”, dans cette soumission à la Lust, que l’homme freudien s’affranchit de l’aliénation qui, enracinée dans la méconnaissance de ses propres conflits, constitue sa névrose. Le sujet qui reconnaît ses vrais désirs, refoulés par ses propres Idéaux, retrouve son calme intérieur et s’achemine vers la guérison. De Platon jusqu’à Freud, nombre de thérapies de l’âme se sont développées avec pour fin cette reconnaissance de la vérité. Pourtant, si cette reconnaissance devenait totale, elle ferait surgir des résistances indépassables. Ainsi est-on en bute à des difficultés qui n’ont pas encore étés résolues.
Est-il possible, donc, une analyse de l’effet tragique capable de contourner le présupposé platonisant de la reconnaissance ou de la révélation de la vérité de l’éros, de l’âme, ou du sujet ? C’est justement la tentative dans laquelle s’est lancé Freud dans Au-delà du principe du désir-plaisir. C’est un texte qui peut aussi être lu comme une théorie du tragique.
5. L’enfant tragédien
Dans Au-delà du principe du désir-plaisir, Freud s’interroge sur certains cas qui mettent à l’épreuve la suzeraineté du principe du désir/plaisir, paraissant en démentir le caractère absolu. En fait, il interroge les rêves traumatiques, les jeux d’enfants qui mettent en scène des situations désagréables, et la répétition dans le transfert ou dans les névroses de destinée.
Les rêves traumatiques sont des cauchemars où le sujet revit à plusieurs reprises une scène dramatique qu’il a réellement vécue, sans qu’aucun travail de déplacement et de condensation n’ait lieu. Par exemple, le sujet rêve toujours la même scène dans laquelle il va être presque écrasé par un camion, e qui correspond à peu près à ce qui s’est passé dans la réalité. Les névroses de destinée sont celles où le sujet se trouve constamment confronté à des situations pénibles de frustration et échoue dans la vie en répétant sans cesse les mêmes erreurs. Le transfert lui-même est une répétition : l’analysant renouvelle dans son rapport avec l’analyste des attitudes et des affects éprouvés à l’égard de personnes qui ont le plus comptées pour lui dans son enfance. Tous ces exemples de répétition semblent contredire le Lustprinz(ip) : on dirait qu’ici le sujet recherche le déplaisir plutôt que le plaisir, qu’enfin il se révolte contre le Prince du plaisir.
Dans ce texte, Freud analyse notamment le jeu d’un enfant âgé de deux ans, qui était son petit-fils. Cet enfant « avait l’habitude d’envoyer tous les petits objets qui tombaient sous sa main dans les coins d’une pièce, ou sous un lit, etc. »[xxiii] « En jetant loin de lui ces objets, il prononçait [...] le son prolongé o-o-o qui, d’après les jugements concordants de la mère et de l’observateur, n’était nullement une interjection, mais signifiait le mot “Fort !” (Loin !) » Freud arrive alors à la conclusion que les objets que l’enfant faisait disparaître étaient des symboles, quasi au sens étymologique du terme (d’après sumballein) comme ce qu’on jette, qu’on lance-avec. Avec ces objets, l’enfant jetait au loin, symboliquement, sa mère. Par ce jeu répétitif, l’enfant mettait en scène l’éloignement de l’être aimé, sa mère - puisque même la mère la plus attentionnée parfois s’éloigne -, c’est-à-dire qu’il représentait ce qu’il craignait le plus. Le plaisir énigmatique tiré de ce jeu nous paraît être le prototype du plaisir tragique : le jeu centrifuge du Fort ! consiste en effet à se représenter ce que pour l’enfant est par-dessus tout désagréable : la séparation d’avec sa mère.
Mais comment se fait-il qu’on puisse éprouver du plaisir grâce à une activité ludique qui répète la représentation d’un événement pénible?[xxiv] Tel est aussi le problème que nous pose la jouissance tragique.
Freud avance dans son écrit des réponses provisoires aux problèmes qu’il pose. Dans le cas de son petit-fils, il interprète un de ses tout premiers jeux. L’enfant s’amusait avec une bobine de bois attachée à une ficelle : « Tout en maintenant le fil, il lançait la bobine par-dessus le bord de son lit entouré d’un rideau, où elle disparaissait. Il prononçait alors son invariable o-o-o-o, retirait la bobine du lit et la saluait cette fois par un joyeux « Da ! » (Voilà !) »[xxv]. C’est ce jeu, ce théâtre de marionnettes rudimentaire, où la bobine disparaît et réapparaît, qui fournit à Freud la clef du jeu successif inlassablement répété (« bien qu’il fût évident que c’était le second qui procurait à l’enfant le plus de plaisir »), où on ne voit plus que le moment « tragique » du pendule de la représentation. Par ce jeu de la bobine, l’enfant mettait en scène la disparition de la mère : c’était comme si lui-même la re-jetait, pour la faire ensuite re-venir. La séquence avait alors un dénouement heureux.
Ce sont des jeux comme celui de la bobine qui sont à l’origine de toute fiction qui se termine par une happy end : le héros auquel nous nous identifions rencontre toute une série de dangers - fort ! - mais il réussit à se tirer d’affaire et à gagner enfin - da. Il y a un cependant autre, jeu plus tardif, où l’enfant jette les objets sans les faire réapparaître, et cela nous paraît alors une tragédie rudimentaire : cette fois, l’histoire ne se termine pas bien, le héros finit par succomber. La phase tragique, le fort ! de la déjection au loin sans le da !, pourrait être interprétée comme une comédie inachevée. Pouvons-nous dire alors que le tragique n’est rien d’autre qu’une comédie ? Le tragique ne serait que la synecdoque (la partie prise pour le tout) d’une comédie, à savoir une comédie incomplète ? N’y a-t-il pas là la présupposition d’un dénouement heureux, dénouement qui tombe simplement hors de la représentation ? Au reste, les tragédies les plus anciennes, comme Les Euménides d’Eschyle, se terminaient généralement par une réconciliation[xxvi]. En la regardant à travers ces jeux d’enfants, il nous est possible de considérer la tragédie comme le jeu du fort !, où la phase du da !, celle de la réconciliation ou de la réunion, ne se déroule pas sur scène mais, si tel est bien le cas, dans l’âme du spectateur. Peut-être, en effet, le spectateur intègre-t-il un processus qui, sur la scène, reste inachevé.
Mais l’analyse que Freud poursuit dans Au-delà.... amène à des exemples bien plus inquiétants de tragédies tout à fait irréductibles à des comédies inachevées, et tels qu’ils se soustraient vraiment à la juridiction du Prince ! Ces cas limites, comme la réponse thérapeutique négative, jettent une ombre en retour sur les cas qu’on croyait avoir résolu, à l’image du jeu du fort !, et qui semblaient résolus pour la simple raison qu’on pouvait y reconnaître la dialectique du Lustprinzip. Sous ce nouveau jour, la question du plaisir tragique réapparaît... tragiquement.... à nouveau.
En fin de compte, l’essai freudien que nous sommes en train d’examiner est une palinodie, à savoir un chant de rétractation quant à la fidélité au Prince. Dans le tragique même, bien qu’il y ait du plaisir, il y a quelque chose d’irréductible au Lustprinz(ip), et qui se pose plutôt comme son au-delà. Cet au-delà ne signifie pas absence de plaisir, mais implique la possibilité que des activités, pourtant agréables, ne soient pas soumises au principe de plaisir, considéré à la fois comme archè et télos.
Nous avons déjà souligné que Freud avait hérité de l’éthique de l’empirisme anglais l’idée du plaisir comme cause première de l’agir humain. Ce courant de pensée avait fondé la morale sur la maximisation du plaisir ou, comme le dit plus précisément Freud, sur la tendance à réduire au minimum le déplaisir. Tandis que la perception extérieure est à la base des sciences, la sensation interne du plaisir est à la base des systèmes moraux, dont le but serait justement toujours la maximisation du bonheur de chacun. Aux sentiments autant qu’aux perceptions sensibles revient ce caractère de certitude, et ce qui est incertain (les sciences, l’éthique) se fonde sur cette certitude subjective.
Et pourtant, Freud a paradoxalement laissé planer bien des doutes quant à cette évidence première, cette certitude liée à l’impression de plaisir et de déplaisir. Dans sa réflexion sur l’angoisse (Angst) - qui est à ses yeux du désir non lié et non maîtrisé - Freud parle d’une ambiguïté radicale du fait que ce qui est perçu comme pénible par une certaine instance de l’âme (qu’il va appeler das Ich, le Moi) est ressenti au contraire comme agréable par une autre (qu’il va appeler das Es, le Ça). Ainsi, l’angoisse et l’horreur relèvent de la jouissance du sujet désirant.
En d’autres termes, même s’il part du plaisir comme fondement, Freud finit par l’effriter en y introduisant un doute qui le détruit comme certitude. Après Freud, on ne pourra plus donner aux termes de “plaisir” et de “désir” la même signification qu’ils avaient auparavant. L’opération de Freud a commencé en faisant de la Lust, avec toute son ambiguïté, le Prince qui donne de la valeur aux valeurs, mais en Le dérobant aux évidences affectives de la conscience. Mais au cours de cette opération il est forcé de reconnaître qu’il y a des plaisirs irréductibles au César du Plaisir autant qu’à l’Auguste du Désir.
6. De l’événement à la représentation
Pour Freud, depuis notre naissance nous sommes confrontés à toute une série d’événements traumatiques. On parvient toutefois à maîtriser le traumatisme par la répétition, par la transformation de l’effroi en angoisse.
Freud - nous l’avons dit - s’interroge sur les rêves traumatiques. En fait, la théorie freudienne du rêve, selon laquelle le rêve est toujours un accomplissement imaginaire de désir, rencontre la conception populaire des rêves, selon laquelle, par exemple, on dit: «Je rêve d’un monde plus juste», en entendant : «je souhaite un monde plus juste». Bref, le rêve lui-même est réglé par le principe de plaisir/désir : en imaginant que nos désirs soient satisfaits, il nous permet de prolonger notre sommeil. Mais les rêves où on revit un évènement traumatique qu’on a subi réellement semblent réfuter cette théorie du rêve comme accomplissement imaginaire d’un désir. Comment peut-on désirer un traumatisme, en le mettant en scène dans le rêve ?
Or, pour Freud, les cauchemars nocturnes remplissent cette fonction très précise qui est celle de lier l’événement en le transmuant en représentation. À présent, ce n’est plus le camion de l’accident qui nous investit, mais son image. Ce que notre appareil psychique avait subi passivement, devient, grâce à la répétition dans la représentation, une image menaçante, que le sujet peut maîtriser par son activité représentative. Si cette représentation est refoulée dans l’inconscient, alors l’effroi évolue en angoisse, en donnant lieu à ce qu’on appelle aujourd’hui “attaque de panique”. Mais même l’angoisse déclenchée par une représentation inconsciente - comme lorsque nous sommes en proie à une anxiété vivace, sans savoir le pourquoi - fait partie de ce travail progressif de Bindung, qui consiste à lier l’événement pénible dans le processus secondaire.
Le passage de l’effroi à l’angoisse est donc en même temps un passage de l’événement à sa représentation :
1) l’effroi (Schreck) est l’effet d’un évènement qui survient hors de toute représentation et partant hautement traumatique ;
2) la peur (Furcht) est la crainte d’un événement qu’on se représente comme possible dans l’avenir ;
3) l’angoisse (Angst) est la crainte d’une représentation qui désormais ne renvoie plus à aucun événement.
Tableau (+ signale la présence du trait, – son absence)
Événement Représentation
Présent Futur Consciente Inconsciente
|
Schreck |
+ |
+ |
– |
– |
|
Furcht |
– |
+ |
+ |
– |
|
Angst |
– |
– |
+ |
+ |
L’angoisse, comme on le voit d’après le tableau, est reliée à des représentations conscientes aussi bien qu’inconscientes, dont la différence est parfois mince. Le sujet agoraphobique, par exemple, est angoissé par une représentation consciente, celle liée à un espace public. Mais pour Freud la situation phobique est le remplaçant d’une représentation inconsciente : l’angoisse est une peur dont l’objet originaire s’est glissé dans l’inconscient.
Pour le sujet, donc, l’angoisse est un pis-aller : ce qui l’afflige devient représentable et donc prévisible ; tout cela, ainsi, peut être élaboré par le psychisme et peut-être conjuré.[xxvii] Si je ne puis faire comme si l’accident traumatique n’est jamais arrivé, du moins je peux désormais me débarrasser de ses représentations. L’angoisse est un travail autant que le deuil. Par le travail du deuil je me sépare lentement de l’objet d’amour perdu, par l’angoisse je me sépare, lentement, de ce qui m’effraie et enfin de l’angoisse elle-même. L’angoisse est comme une médecine bienfaisante, mais qui a tout de même un goût bien amer.
Or quel rapport y a-t-il entre l’angoisse (Angst) de Freud et l’angoisse (phobos) d’Aristote ? Si l’on voulait freudianiser Aristote, on pourrait dire que chez le Stagyrite le plaisir tragique est cathartique en tant qu’il guérit justement de l’Angst, de l’angoisse - mais aussi de la pitié (dirions-nous aujourd’hui : de l’identification au personnage) - parce qu’il accomplit une reconversion de la représentation en événement, en renversant le processus formalisé dans le tableau ci-dessus. Cette reconversion toutefois ne consiste pas en une simple régression vers l’effroi. Le spectacle tragique réactualise des représentations.
Selon Freud, la répétition et représentation de l’événement angoissant est déjà le début d’un dépassement de l’angoisse. La répétition ainsi, généralement parlant, sert à lier (binden) le processus primaire, la fuite incessante des représentations. Il s’agit maintenant de voir si cette Bindung servile se fait en accord - ou non - avec le Prince du plaisir. Freud hésite à ce propos dans le fait de distinguer la répétition qui lie de celle qui délie, la répétition qui sert le Prince, d’une autre répétition qui serait autonome, anarchique.
7. L’agréable échec de la maîtrise
Pourtant, la tragédie ne répète rien, donc elle ne peut pas servir à lier un événement délié, traumatique. Bien au contraire, la représentation tragique interrompt la répétition des récits mythiques ou des jeux d’enfants. Il est vrai que la tragédie ancienne ordinairement mettait en scène des mythes, c’est-à-dire des contes maintes fois repris[1], mais à l’instar d’événements actuels, foudroyants, qui arrivaient pour la première fois à ce moment-là sur la scène, devant les spectateurs. La catastrophe, tant de fois contée ou représentée, parvenait au public de la tragédie ancienne dans une étonnante fraîcheur. Quand nous allons voir pour la énième fois l’histoire de Médée ou du roi Lear, nous ne cherchons pas le plaisir du type Fort !, nous ne nous amusons pas à maîtriser, au moyen du symbole, l’erreur (amartia) de l’héroïne ou du héros, où nous aurions reconnu quelqu’un de nos erreurs. C’est exceptionnellement que nos erreurs soient comparables à celles de Médée ou du roi Lear. Ce qui nous émeut c’est plutôt la métabasis - le revirement de fortune - du héros, l’échec pathétique de sa maîtrise.
Nous nous identifions - au sens ordinaire du terme - au roi Lear, par exemple, parce qu’au fond, malgré toutes ses erreurs, c’est la fatalité de sa déchéance qui nous frappe. La tragédie comme évènement ne met pas en scène tant l’événement pénible, par sa répétition, que la non maîtrise du pénible. La tragédie ne re-présente pas la répétition-qui-lie, mais bien plutôt un événement qui nous délie de la répétition. Les représentations tragiques « marchent » bien justement parce qu’elles ne répètent rien, ne nous rendent pas davantage maîtres de quelque chose, bref, elles ne nous servent à rien ; et pourtant elles nous donnent de la jouissance.
Mais alors la représentation tragique, qui est un moment de sociabilité, de relations mondaines, à l’apparence assez peu démoniaque, est-elle irréductible, ou non, au principe (ou Prince) du plaisir ? Le plaisir tragique ne serait-il pas un phénomène analogue à ces processus évoqués par Freud comme étant irréductibles au principe du plaisir, comme la névrose de destinée ou la répétition dans le transfert ? Freud, à une certaine étape de son argumentation, présente cette solution au problème posé par ses exemples : tous les deux montrent une pulsion de mort à l’oeuvre dans la compulsion de répétition (Wiederholungszwang) qui délie, comme tendance innée au morcellement irréversible du vivant, quelque chose qu’aujourd’hui on appellerait un triomphe de l’entropie, du chaos.
Même dans le tragique, il faut reconnaître quelque chose d’irréductible au Lustprinzip, et pas seulement parce qu’à la fin de la représentation d’habitude restent sur la scène des cadavres ; le tragique va au-delà du principe du plaisir, parce que tout en donnant des frissons de plaisir à son public, il lui suggère en même temps la possibilité d’un plaisir qui n’ait pas Plaisir comme son principe et sa fin. Le tragique, autant que le transfert ou les névroses de destinée, jette son ombre sur le Prince.
Freud a classé comme masochiste - nous l’avons appelé ci-dessus sublime - le plaisir qu’on tire de la représentation de catastrophes. Mais en quel sens la représentation tragique satisfait-elle le masochisme de son public ? Tout simplement parce que le public tire du plaisir de son déplaisir : attitude qui est aussi le propre du tragique. En fin de compte dire qu’il y a du masochisme dans le tragique revient à dire que le tragique ... est tragique. Ce n’est pas une explication véritable, c’est une tautologie. Mais avant de la rejeter irrévocablement, il vaudrait mieux examiner le recours de Freud au masochisme, et à l’exigence d’autopunition qui s’y relie, pour voir en quel sens il serait le ressort du tragique.
8. Le pouvoir masochiste
Freud distingue trois types de masochisme : le masochisme érogène, féminin, et moral.[xxviii] Considérons ici seulement les pratiques masochistes érogènes. Prima facie le masochisme érogène ne pose pas de problèmes théoriques insurmontables: c’est une manière entre autres pour un sujet de se procurer du plaisir même de biais[xxix]. Il est vrai que pour jouir il lui faut se faire battre et humilier par une femme, mais ce qui compte en vérité c’est qu’il vise, comme tout le monde, la sacro-sainte jouissance. Le sujet masochiste ne se dérobe pas du tout - paraît-il - à la domination dialectique de la Lust : sa démarche lui permettrait de satisfaire un peu son « besoin d’autopunition » ou son sentiment de culpabilité. Son Surmoi jouit en le punissant, parce qu’il le considère coupable. Tout semble jouir dans ce sujet : le Surmoi sadique en tant qu’il inflige la punition, et le Moi masochiste en tant qu’il la subit. Plus tard, Freud a dépassé cette manière de voir par la considération que le masochisme, qu’il appelle primaire, n’est pas complètement sujet au principe du plaisir.
Certes, toute une lignée interprétative réintègre le masochisme au Lustprinzip en y détectant la stratégie d’une maîtrise. Le masochisme serait comme une preuve par l’absurde que l’enjeu des perversions est le pouvoir de/sur l’autre. Même si les souffrances désirées par le masochiste sont bien réelles, elles ne sont pas vraies au même titre que celles qu’on subit sans les avoir demandées. Le masochiste étalerait son impuissance comme un instrument de discipline qui lui permette d’exercer son pouvoir sur l’autre autant que sur soi-même. Comme dans le jeu du Fort ! (sans le Da !) l’enfant met en scène son effroi et son chagrin de se sentir esseulé, pour les dépasser en les maîtrisant, ainsi le masochiste avec son cérémoniel ne ferait que confirmer sa maîtrise sur son geôlier complaisant : en le nommant son maître par contrat, il l’assujettit à ses désirs.[xxx] Je vois ici une analogie avec la tragédie, comme représentation de l’impuissance du héros : la répétition d’un échec dans la visée de le maîtriser par l’esprit. Masochisme, pathos tragique, jeu de déjection enfantin (Fort !) : autant d’exemples de l’éblouissante dialectique par laquelle l’être humain jouit à signifier die Lust par la mise en scène de son contraire, Unlust, le déplaisir.
Le masochisme érogène serait donc un spectacle de maîtrise de/sur la douleur aussi bien que de/sur l’autre, maîtrise qui, pour se confirmer comme telle, doit se confronter à son antithèse. En effet, le spectacle pervers c’est un risque qui se met en scène par lui-même. Mais si la perversion est de toute façon une forme de la Volonté de puissance au sens nietzschéen, pourquoi cette volonté s’affirme-t-elle justement par la mise en scène de l’impuissance du sujet à l’égard de l’autre ?
Examinons alors la vie de Leopold von Sacher Masoch (1836-1895) qui a donné son nom à cette figure de la perversion[xxxi]. Il était le fils du chef de la police de Lemberg (Galicie). Il appartenait à la petite noblesse, donc à la classe aisée, et a été un écrivain à succès. Toutefois il se faisait fouetter et humilier par sa femme, la soi-disant Wanda Dounaieff[2], sur la base d’un « contrat » par lequel il s’engageait envers elle à devenir, pour un temps donné, son esclave et à se conduire comme tel. Mais il ne faut pas penser que son comportement ait été dicté par l’exigence d’obtenir, par antithèse, un plus grand pouvoir sur sa femme. Masoch était déjà maître de Wanda ; on peut être assuré que dans le cas contraire il se serait bien gardé de jouer à être son esclave.
Il est vrai que le masochiste joue parfois à la limite, où la représentation factice risque toujours de se rabattre sur la réalité, de glisser vers la vraie servitude. Mais il veille aussi à ce que cette limite, bien qu’approchée toujours davantage, ne soit jamais dépassée. Le masochiste est semblable à l’Achille du paradoxe de Zénon, qui se servirait de ce paradoxe pour ne pas rejoindre la tortue qui le précède. Il lui faut en dernière instance avoir le contrôle de cette limite. Comme le dit Theodor Reik, « le masochiste perd toutes ses batailles, sauf la dernière. »[xxxii] Le masochiste en fin de compte est quelqu’un qui se sert de son pouvoir pour mettre en scène ses phantasmes érotiques, plus qu’il ne se serve de ces mises en scène pour imposer son pouvoir sur l’autre.
Les écrivains ou les metteurs en scène qui ont peint les splendeurs et les misères de la vie libertine, nous proposent un portrait éloquent du masochiste qui fréquente les bordels : il est un homme “arrivé”, respectable, comme l’était Sacher Masoch. En se faisant fouetter par des pauvres prostituées, il montre l’autre visage de son aisance, il révèle une peu humble convoitise de son abjection. Son désir d’être humilié n’a pas grand-chose à voir avec la vraie soumission. Enfin, la mise en scène masochiste apporte une satisfaction érotique parce qu’elle est un acte de maîtrise bien différente de la maîtrise qui s’exerce dans les rapports de pouvoir sur les autres ou sur soi-même. Bien que cette satisfaction autre requière autant de maîtrise de la part du sujet, soit sur ses propres fantasmes, soit sur ses complices ou acolytes. Mais alors, si le but du masochiste n’est pas d’acquérir un pouvoir sur autrui ou sur soi-même, quel est-il donc ? À quelle exigence répond l’artifice masochiste ?
Prenons cet autre rake’s progress que nous conte l’Histoire d’O, où l’on célèbre le masochisme de la femme. La belle O poursuit diligemment sa carrière d’esclave, en se faisant traiter en pur objet du plaisir, jusqu’à se laisser donner en cadeau par son fiancé à un autre homme pour qu’il fasse d’elle ce qu’il voudra. Pourquoi dans ce récit O se soumet-elle comme une chienne... ou pire ? Pour obtenir ainsi un pouvoir, bien que purement “spirituel”, sur son aimé ? Pas du tout ! Il s’agit plutôt d’une élévation spirituelle, d’une ascèse qui va bien au-delà du plaisir sexuel stricto sensu. L’ascèse louche d’O consiste dans le renoncement à n’importe quel pouvoir sur son aimé : renoncement qui comporte à la limite de ne devoir plus aimer son homme aimé. Telle est la limite sublime - et en même temps l’aporie - de l’amour véritable. « Que ta volonté soit faite » dit l’amant qui aime véritablement, même si la volonté de l’aimé dusse le chagriner ; même si la volonté de l’aimé lui requiert de renoncer à l’aimer.
Jean Paulhan, à qui le livre était secrètement dédié[xxxiii], dans son introduction à l’Histoire d’O, qualifie de « lettre d’amour », bien qu’insolente et gênante, ce petit livre à sex-shop. L’amour, quand il est vrai, à savoir débarrassé de tout narcissisme (ce qui se vérifie, hélas, assez rarement), ne peut se déclarer à la limite que comme renoncement à soi-même. C’est ce qui arrive lorsque l’aimé paradoxalement exige de l’amant comme « preuve d’amour » l’abandon de son amour même : « si tu m’aimes, cesse de m’aimer. »
Le renoncement à exercer son pouvoir sur l’aimé signifie d’abord renoncer au pouvoir de pouvoir aimer. Le fait de démasquer l’enjeu du masochiste – une « lettre d’amour » - nous permet de répondre à la question que nous avions posée sur la nature de la jouissance qui y est en jeu. L’allégorie masochiste ne donne pas au sujet la satisfaction de maîtriser, de contrôler l’autre ou soi-même, et même pas la satisfaction de renoncer à la maîtrise, au contrôle, mais bien plutôt la satisfaction de signifier ce renoncement, car celui-ci est le sceau ou l’auréole de l’amour vrai. Le masochisme est la représentation de l’amour, d’un bonheur qui ne peut être vécu que comme mise en scène d’un oxymore : le pervers peut seulement rêver l’amour par l’intermédiaire d’une cérémonie affreuse : celle de son renoncement à son emprise sur l’autre. « L’amour vrai » se présente comme ressort de la mise en scène perverse et en même temps comme son utopie. Autrement dit, l’acte pervers met en scène le sujet dans son impuissance à aimer : par le truchement d’une rhétorique débridée, il signifie une puissance d’aimer qui fait défaut à ce sujet assujetti à la Lust.
Quelles sont alors les conséquences de cette explication du masochisme pour la théorie freudienne et d’abord pour le principe de désir/plaisir auquel elle s’ordonne ?
9. Éros extatique
C’est bien connu que Freud dans Au-delà... oppose les pulsions de vie aux pulsions de mort, qu’il nomme d’ailleurs Éros et Thanatos. En dernière analyse, la nouveauté de cet essai ne consiste pas vraiment, comme on le répète souvent, à faire état de la pulsion de mort, mais bien plutôt à introduire les pulsions de vie. En fait la pulsion de mort (Todestrieb) n’est qu’un autre nom pour désigner ce Lustprinzip qui a été un axiome dans sa théorie, dès ses débuts. Le principe du plaisir avait la fonction de régler toute pulsion, au sens de réduire à zéro le niveau énergétique de l’organisme ou, comme principe de constance, à garder à son minimum le niveau de la tension psychique. Le plaisir en effet tend à zéro, au Nirvana, dit aussi Freud, donc à la mort.[xxxiv] Ce qu’il y a de nouveau dans cet essai c’est donc, au contraire, l’hypothèse d’une pulsion de vie, dont la fin et la finalité ne sont pas de s’annuler, mais d’entrer dans des combinaisons toujours nouvelles et plus étendues, d’induire des écarts énergétiques, des différences de potentiel, donc du déplaisir. Bref, les hommes auraient une tendance irrépressible à se créer des ennuis...
Lisons Freud :
« Le processus vital de l’individu tend pour des raisons internes à l’égalisation des tensions chimiques, c’est-à-dire à la mort, alors que son union avec une autre substance vivante, individuellement différente, augmenterait ces tensions, introduirait, pour ainsi dire, des nouvelles différences vitales, qui se traduiraient pour la vie par une nouvelle durée. »[xxxv]
La pulsion de vie (Éros) exerce ainsi une action centrifuge, qui risque d’imposer au sujet le prix d’un déplaisir afin de le lier à des objets (au sens technique où est pris ce terme dans la théorie, comme corrélatif de la pulsion) c’est-à-dire aux autres êtres humains. On peut dire que, par l’intermédiaire d’Éros, l’autre[xxxvi] n’est plus un moyen, un objet de la pulsion qui de la sorte, en se satisfaisant, tend à zéro, mais cause finale - au sens téléologique du terme - de la pulsion même.
L’introduction d’Éros, au-delà du Lustprinzip, répond donc à l’exigence d’introduire un autre comme cause et comme but de la pulsion, comme ce qui la déclanche et ce qu’elle vise, en même temps. Cet autre est d’abord un autre organisme, avec lequel le premier désire de s’unir - désir quasi-politique, qui rassemble des éléments d’abord séparés. Je vois ici une circularité - essentielle pour la théorie de la psychanalyse - entre la cause efficiente et la cause finale, qui s’ »incarnent » tour à tour dans l’autre. Avant que ne parût Au-delà, le seul but de la pulsion en général était indiqué par Freud dans le plaisir (plutôt que dans l’union avec l’autre) avec le cortège des buts particuliers, de tous les actes partiels qu’il faut accomplir pour l’atteindre : sucer, mordre, évacuer, attaquer, frotter, pénétrer (et regarder, parler....). Dans cet essai on assiste à un renversement essentiel de sa position.
C’est Éros en effet qui par ses troubles entrave la voie au plaisir ; c’est Éros qui nous sort de la léthargie où nous avait plongés la stratégie de la réduction du plaisir au déplaisir minimum, de la minimisation de la gêne, et nous jette dans la mêlée des intrigues amoureux et sociaux. L’autre homme, investi par l’appel ek-statique (qui porte le sujet littéralement « hors de soi ») de la Vie, est aussi bien celui qui exalte et tout ensemble diffère le plaisir. La poussée centrifuge d’Éros se noue au mouvement centripète de Mort. La largesse de nos élans n’est jamais tout à fait pure, désintéressée ; elle est toujours souillée par l’égocentrisme de Thanatos.
La pulsion de mort, quant au fond, n’est rien d’autre que ce mouvement hâtif de la vie vers sa propre vérité que la vie voile en même temps ; et la vérité de chaque vie n’est que son fin et sa fin-alité à la fois, c’est-à-dire sa mort. Même si nous continuons d’aller vers la mort - vérité du vivant, son achèvement et son but -, grâce à l’entremise d’Éros nous ne nous ruons plus vers elle, nous nous attardons à gaspiller un peu de notre temps dans l’amour. Donc nous sommes à même de redéfinir la pulsion de mort comme une espèce de hâte excessive du vivant d’aller vers sa propre vérité, sans passer par les détours de l’érotisme et de l’amour pour l’autre.
10. Une victoire noble
Donc Éros est à la fois le ressort et l’utopie de la tragédie.
On peut voir, dans une certaine mesure, la représentation tragique dans la Grèce ancienne comme un acte ritualisé de renonciation à la maîtrise, une façon pour l’homme grec de prendre congé de l’autarcie (autarkeia) dont le principe régissait sa vie. Le public s’émouvait pour la péripétie d’Oedipe, l’enfant trouvé (Fils de la Chance) qui trouve le mot de l’énigme, couronné de puissance, champion illustre de la maîtrise humaine sur la vie, justement parce que cette péripétie re-présentait, répétait, l’échec le plus radical des pouvoirs humains. Oedipe décèle la cause de la peste et à cause de sa découverte il devient le bouc émissaire (pharmakos) – terme relié à phàrrmakon, à la fois médicament et poison - qui doit être sacrifié pour la purification de la ville : c’est ainsi qu’il se découvre être l’artisan ingénieux, autant qu’inconscient, de sa propre ruine. Il se croyait vainqueur, pendant qu’il allait à sa perte. Sa péripétie dévoile le paradoxe du pouvoir politique et intellectuel de l’homme : comblé par la chance, parvenu au sommet de sa puissance, l’homme tragique doit reconnaître son impuissance. Mais, comme déjà Nietzsche l’avait remarqué, la mise en scène de cette reconnaissance d’impuissance n’est qu’une autre manifestation de la volonté de puissance !
En un sens, par le renversement de la puissance en impuissance, la tragédie ancienne fournit à nos yeux un contrepoint à cette expérimentation historique dangereuse que fut la démocratie. La représentation tragique, par la re-présentation d’un échec du pouvoir, donnait aux citoyens d’Athènes, homme libres, dont l’assemblée démocratique était le vrai souverain, ce que j’aimerais appeler une « leçon d’amour ». Par amour j’entends ici le renoncement par le maître à sa domination, à sa maîtrise. Cet amour la tragédie ne le déclanche pas dans le spectateur, mais le lui signifie par la montée et la tombée de la pitié et de l’angoisse. Plusieurs auteurs, dont Freud, ont indiqué dans le sacrifice l’origine et le sens de la tragédie[xxxvii]. Or, sur la scène le sacrifié ce n’est plus l’animal, mais le héros, qui est fait bouc émissaire. Et pourtant la tragédie ancienne représente surtout le sacrifice imaginaire d’un idéal de maîtrise, son abandon de par le citoyen-spectateur : la jouissance tragique est le plaisir qu’on prend au sacrifice de soi comme maître.
Ces considérations nous amènent à croire que ce qu’Aristote a nommé katharsis n’est rien d’autre que l’effet de reconnaître la vanité du conflit dans lequel nous étions entrés en nous identifiant au héros tragique. Cette identification, ainsi que Freud le rappelle, nous avait fait partager sa lutte contre la divinité ou les autres hommes, ou contre la société ou contre soi-même comme un autre. Maintenant, dès que nous éprouvons pour notre héros les affects de la pitié et de l’angoisse, nous nous apercevons qu’un jeu très différent est en train de se dérouler, où le héros est joué à son tour. Pourtant, dans ce change de jeu où débouche la reconnaissance catastrophique, où le puissant se révèle impuissant, et l’homme heureux prépare à son insu son malheur, la fin de l’aveuglement ne nous apporte pas une nouvelle maîtrise des passions (de sa propre âme ou des autres), qu’elle soit politique, pédagogique ou thérapeutique, même pas à une maîtrise à un niveau plus haut. S’il en fût ainsi, le spectacle tragique n’aurait pas été rejeté par Platon au profit du dialogue philosophique, dans le souci que la ratio puisse exercer son emprise sur les apparences sensibles et sur les passions.
En fait le dénouement tragique nous force à nous exclamer, comme Qohélet : « Tout n’est que vanité ». On a pu penser par conséquent que le revirement final nous délivre de nos illusions, que la tragédie nous aiderait à sortir de la caverne de Platon, vers la pleine lumière du réel. Mais il n’en est rien. Le regard tragique nous permet en effet de saisir l’action des êtres humains comme du semblant, mais sans nous laisser entrevoir une action différente qui ne fût pas, à son tour, du semblant. C’est pour ça que les grands réformateurs et les révolutionnaires ont nourri le plus souvent une profonde méfiance à l’égard du tragique. La tragédie, bien qu’elle ne soit pas séparable de la vie publique de la polis, n’est pas pour elle-même un acte politique réformateur. Après la catastrophe, il semble qu’on ne puisse prendre plus rien au sérieux, tout paraît sombrer dans une triste vanité. La tragédie aurait comme issue de rendre vaines les valeurs des hommes et tout particulièrement les valeurs de la maîtrise (en termes freudiens : les valeurs qui relèvent du principe - ou du Prince - du plaisir). Nous avions déjà vu que le principe ou Prince du plaisir, pour nous soumettre à sa souveraineté, nous dresse à la maîtrise des événements déplaisants. À cause de sa dévalorisation des valeurs, la tragédie tombe pour nous sous le soupçon de nihilisme.
Or, si le tragique se présente à nous comme un nihilisme « inaccompli » - pour se servir au négatif d’une expression nietzschéenne -, c’est parce qu’il nous convainc de la vanité des valeurs (et surtout du pouvoir comme valeur). Mais alors d’où provient le plaisir de cette délivrance liée à la dévalorisation des valeurs ? En fait, le spectacle tragique met sous nos yeux l’échec d’une maîtrise, nous montre, exempli gratia, la chute d’un gouverneur qui voulait commander. Mais nous nous flattons ici d’une victoire plus profonde bien qu’illusoire, qu’on pourrait appeler justement noble: une victoire sur l’asservissement à la volonté de maîtrise qui animait le héros, le prince auquel nous en tant que spectateurs nous sommes identifiés. Ainsi, l’échec de la maîtrise, représenté sur la scène, nous signifie le renoncement à cette maîtrise, à ce vouloir commander auquel nous étions asservis. Y renoncer ne nous coûte pas cher et en même temps nous glorifie.
11. Maîtrise et noblesse
Aristote écrivait : «Les acteurs représentent des héros. Or, chez les anciens seuls les chefs étaient des héros. Les gens du peuple qui composaient le choeur étaient des simples mortels.»[xxxviii] On ne saurait être plus clair : la tragédie ancienne ne représentait pas des chefs d’état parce qu’elle visait les héros du mythe, mais bien plutôt représentait des héros de jadis parce qu’elle s’intéressait aux chefs et aux gouvernants du présent. Cet intérêt passionné pour les gouvernants, pour les détenteurs du kratos, du pouvoir, caractérise aussi le tragique moderne[xxxix]. La tragédie nous pousse à nous identifier avec les détenteurs du pouvoir. Et selon Aristote ceux qui détiennent le pouvoir politique sont en principe meilleurs que “nous” gens du commun (y compris les philosophes ?). Écrit Aristote dans sa Poétique :
«Comme ceux qui imitent représentent des hommes en action (prattontas), lesquels sont nécessairement gens de mérite, ou gens médiocres (toûtous è spoudaìous è phàulous) [...], ils les représentent ou meilleurs que nous sommes en général, ou pires, ou encore pareils à nous [...] C’est la même différence qui distingue la tragédie et la comédie : celle-ci veut représenter les hommes inférieurs, celle-là veut les représenter supérieurs aux hommes de la réalité. »[xl]
Donc les héros de la tragédie - les gouvernants - en tant que spoudaìous (plus sérieux, plus nobles) sont quand même meilleurs que nous, simples citoyens ou sujets. La comédie au contraire représente d’habitude des paysans, des bourgeois, des parvenus, des esclaves, des gens qui se situent aux degrés inférieurs de l’échelle sociale. Mais “nous les spectateurs” qui sommes-nous aujourd’hui ?
Aujourd’hui le spectateur, le vrai consommateur de spectacles tragiques, est le public bourgeois : il est le citoyen qui a pris le pouvoir avec les révolutions du XVIIIème siècle. Mais le bourgeois ne peut s’identifier au gouvernant, au héros de la tragédie : aussi bien pour Hegel que pour Nietzsche, le bourgeois, l’homme moderne, est en quelque sorte un valet[xli] qui, poussé par le désir de commander, est devenu ce sieur ou cette dame que nous sommes. Si dans notre société le peuple est souverain, ou bien sont souverains ces ensembles de sieurs et de dames, en quoi consiste-t-elle cette noble victoire, cette différente vanité, dont jouissent “tragiquement” cette bonne et ce valet, qui se font appeler “monsieur” et “madame” ?
Le bourgeois, ce valet qui aujourd’hui commande, nourrit secrètement l’arrière-pensée que la vraie noblesse est non pas seulement de plaider pour les faibles, mais surtout de se battre pour les causes perdues. Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui en italien on donne au mot signorilità (“noblesse”) un sens presque opposé à celui qu’on donne à signoria (“maîtrise”). On ne dit pas, pour souligner la noblesse d’un homme, qu’il est un seigneur de la guerre, ou de la politique, ou du pétrole, mais qu’il est tout simplement « un signore », un gentilhomme. Un vrai signore, en un certain sens, ne peut pas se poser en maître. Mais alors qui est-il ce “vrai seigneur” qui a accès à la jouissance tragique ? C’est quelqu’un qui aime à se battre pour les causes perdues. Ou, plus simplement, c’est quelqu’un qui, en renonçant à exercer sa maîtrise sur l’autre, se montre enfin capable de l’aimer. Le vrai seigneur est alors celui qui en se dérobant à la loi du Prince du plaisir, ne renonce pas à Éros, même au risque de sa vie. Il est ce que Sacher Masoch, avec ses jeux, n’aurait jamais pu être : un homme capable d’aimer vraiment sa femme.
Ainsi le tragique nous fait signe dans le sens d’une conversion de la volonté de maîtrise (Macht) à la simple noblesse (Herrschaft). Cette conversion en un sens nous permet de nous sentir des gentlemen ou des gentlewomen, ou enfin, de quelque façon, des ministres sans portefeuille.
Ici nous pouvons saisir une dernière analogie entre la jouissance tragique, où le spectateur intègre le désordre représenté par un ordre de rêve, et le plaisir masochiste, où se montre la scission catastrophique entre le courant de la sexualité et celui de la tendresse, entre l’“égoïsme naturel” de la première et le nomos “orienté vers l’autre” de la seconde, son hétéronomie, dirions-nous. En fait, si j’ai envie de coucher avec une femme, ça ne comporte pas que je l’aime, ni que j’aie à me soucier qu’elle y prenne son plaisir. Dans l’acte masochiste le sujet simule son renoncement à sa maîtrise sur l’autre - ce qui revient, dans son intention, à une « preuve d’amour ». Le sujet masochiste joue à se faire punir par la femme qu’il convoite, par la mise en scène de son hétéronomie amoureuse envers la femme, sans laquelle hétéronomie il ne pourrait arriver à la jouissance sexuelle, même sur le mode d’une satisfaction égoïste et solitaire. Le masochiste est donc quelqu’un qui fait une exploitation effrontée du châtiment moralisant dans le seul but de s’assurer de sa jouissance. Sa mise en scène hyperbolique du dévouement n’est qu’une mise-en-scène ironique de cette soumission à l’autre qui est la marque de l’amour. De façon analogue le spectateur de la tragédie représente hyperboliquement ce renoncement au pouvoir et à la justice qui lui donne accès, dans son esprit, à la condition du véritable Seigneur.
12. La noble blatte
La qualité tragique de La métamorphose de Kafka approche, on le sait, la limite du supportable. Le commis voyageur Gregor Samsa un matin, à son réveil, se découvre métamorphosé en blatte. Il est forcé à vivre cette nouvelle identité enfermé dans sa chambre dans la maison paternelle, avec ses parents et sa soeur, qui en sont dégoûtés et honteux, jusqu’à ce que son père le frappe à mort. En effet, après sa mort que sa famille se relève et recouvre son bonheur.
Il s’agit sans doute d’une histoire sublime, sublimis, au sens latin de ce terme, qui signifie en même temps ce qui est le plus en bas et ce qui est le plus en haut. Le sublime est ce qui est le plus éloigné du niveau normal, moyen, où se situe l’ego. Gregor, par sa métamorphose, sombre aux niveaux le plus bas de l’échelle biologique et sociale. Et tout de même ce récit nous soulage, nous soulève très haut : il nous fait sentir comme des seigneurs. Pourquoi ? Parce qu’à l’opposé de sa famille, qui injustement en est rebutée, nous partageons son point de vue, nous nous identifions à lui - à un cancrelat ! - et pour tout dire nous sommes aussi capables de l’aimer - et de nous aimer - dans et par cette identification. Comme nous ressentons l’injustice du malheur qui a fondu sur lui, nous nous gardons pathétiquement fidèles à la justice. Par l’intermédiaire de ce personnage “sublime”, nous atteignons le comble de l’impuissance. Mais cette identification avec l’impuissant Gregor, sans que nous le devenions pourtant, nous enrichit d’une nouvelle potentialité. Comme Orphée, Ulysse, Énée, Dante, ou Rimbaud, nous jouissons du privilège de descendre aux enfers (ici, le destin de Gregor), sans y rester. Le maître hégélien n’est tel que parce qu’il est à même d’affronter la mort ou l’enfer, comme des possibilités toujours présentes ; de même le maître tragique ne cesse d’envisager le fait d’être un cancrelat comme toujours sa propre possibilité.
L’histoire de Gregor Samsa peut être lue aussi comme une lettre d’amour « masochiste » adressée à ses parents qui le rejettent et tout particulièrement à sa soeur musicienne, qu’il aime et admire et qui le charme par sa musique. Dans Gregor nous vivons un comble d’impuissance - qu’est ce qu’il y a de plus impuissant d’un insecte ? - mais pendant que nous éprouvons, avec pitié et angoisse, cet échec radical de la maîtrise, quelque chose nous émeut et nous fait jouir : nous savourons cette étrange victoire de notre noblesse : nous nous ouvrons à l’Éros, à la vie au sens freudien.
La purgation de cette famille qui, par la mort de Gregor, se délivre de son dégoûtant est donc tout à fait différente de notre katharsis à nous, comme lecteurs. Gregor a été sacrifié - comme tout héros tragique -, mais nous de notre part avons sacrifié notre Bemächtigung, notre maîtrise. Ce sacrifice nous allège : nous n’en sommes rendus meilleurs - un homme méchant peut-il goûter le tragique? - mais bien sûr plus nobles. Ce renoncement au pouvoir - cette expérience de noblesse - nous donne le frisson déchirant de la jouissance.
Traduction de l’italien de Francesco Fanelli
[1] D’ailleurs, les mythes sont sériels, ils se prolongent selon des variantes sans limites. Cf. C. Lévi-Strauss, « La structure des mythes », Anthropologie structurale (Paris, Plon 1958). Un correspondant moderne des mythes anciens sont les serials, les feuilletons télévisés, les soap operas, les telenovelas, etc. Le mythe, comme le jeu, est illimité.
[2] Son vrai nom était Aurore Rümelin.
[i] « Non, non pas le bonheur! Certes pas le bonheur, mais bien plutôt le plaisir. Il faut toujours pousser son propre coeur vers le plus tragique. »
[ii] En réalité, les tragédies grecques étaient des spectacles populaires, aimés surtout par les jeunes, par les femmes, mais aussi par la majorité des citoyens. Elles étaient chantées et dansées, un peu comme les musicals d’aujourd’hui. Ce n’est pas un hasard si un aristocrate comme Platon repousse le spectacle tragique comme vulgaire et loue plutôt la poésie épique, parce qu’elle est aimée des vieillards (Lois, II, 658).
[iii] Immanuel Kant, Kritik der Urtheilskraft, 1790, I, sect. 1, livre 1er et 2ème.
[iv] Poétique, XXIV, 49b.
[v] Summa Theologica, Prima Secundae Partis.
[vi] Poétique, XIII, 2, 5-18.
[vii] Poét. XIII, 2, 12 (Bekker 1452b, 40); XIII, 2, 14 (Bekker 1453a 3); XVIII, 5, 36 (Bekker 1456a 23)
[viii] Poét. XIII, 13 (Bekker 1453a 8). Le héros tragique «ne se distinguant par sa vertu ou sa justice, ne tombe dans le malheur ni par sa méchanceté ni par ses vices, mais par une certaine erreur (amartia)».
[ix]Poét., IV, 5.
[x]Poét., XIV, 2, 10-14.
[xi] Sur la catharsis aristotélicienne, cf. J. Lear, Katharsis dans A. Oksenberg Rorty ed. Aristotle’s Poetics, Princeton University Press, Princeton, 1992, pp. 315-340; et R. Janko, From Catharsis to the Aristotelian Mean, in Rorty ed. Aristotle’s Poetics, cit. pp. 341-358.
[xii] Cf. S. Benvenuto et J.-P. Vernant, « Oedipus without Freud. A Conversation », Journal of European Psychoanalysis, 3-4, 1996-7, http://psychomedia.it/jep/mumber3-4/vernant.htm.
[xiii] Le rapport entre le tragique et l’ennui a été déjà mis en évidence par l’abbé Dubos et par David Hume (« Of tragedy », Essays, 1742). Il est préférable d’être chagrin qu’ennuyé. Selon Hume, nous tirons du plaisir de l’activité d’imagination en tant qu’elle réfléchit la vie et d’autant plus lorsqu’elle en réfléchit les côtés les plus bouleversants, comme les catastrophes. La puissance imaginative du drame nous saisit précisément à la mesure de l’effroi que son sujet suscite.
[xiv] Martin Heidegger, Nietzsche, Gallimard, Paris 1971, p. 370: „Par ‚penseurs’, nous désignons ces élus parmi les hommes, qui ont été prédestinés à ne penser jamais qu’une pensée unique – et cela toujours au sujet de ’l’être de l’étant’“.
[xv] Aristote dans sa Physique (II, 3, 194b 16 - 195b 30;II, 7, 198a 14- 198b 9) avait distingué quatre causes: matérielle, efficiente, formelle et finale.
[xvi] Ou plutôt s’agit-il du désir d’être heureux ? Est-ce que le bonheur se résout en effet en une forme plus complète, plus mentale, plus durable, de plaisir ? Les philosophes discutent de ces problèmes-là depuis des millénaires.
[xvii] En effet, Freud avait traduit en allemand un certain nombre d’écrits de John Stuart Mill (cf. Yamina Oudai Celso, Freud e la filosofia antica, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 41 sgg.)
[xviii] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, edited by J. H. Burns and H. L. A. Hart, Methuen, London-New York, 1982, cap. I. p. 1
[xix] « Personnages psychopathiques à la scène », SE, 7, pp. 305-310.
[xx] Ibid., p. 305.
[xxi] Ibid, p. 306.
[xxii] Ibid., p. 309
[xxiii] Au-delà du principe du plaisir, tr.S. Jankélévitch, révue et mise au point par le Dr. A. Hesnard, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1966, p. 16.
[xxiv] « Il est certain que le départ de la mère n’était pas pour l’enfant un fait agréable, ou même indifférent. Comment concilier alors avec le principe du plaisir le fait qu’en jouant il reproduisait cet événement pour lui pénible ? » (ibid.p. 17)
[xxv] ibid. p. 16
[xxvi] Il est évident que dans notre vie le dénouement, heureux ou triste, est toujours relatif : ce la dépend d’où nous décidons de mettre le point final. dans un certain sens, toute vie est une histoire décidemment tragique car elle finit par la mort du protagoniste.... Mais la vie est une éternelle Comédie aussi, car.... la vie de l’espèce humaine quand même continue.
[xxvii] Il faut remarquer que Freud en 1925, par Inhibition, symptôme, angoisse, a modifié sa théorie de l’angoisse en ce sens qu’elle lui apparaît maintenant comme un signal qui avertit le Moi d’un danger interne ou extérieur au sujet lui-même. L’angoisse est dans cette manière de voir un des moyens par lesquels le Moi se garde des traumatismes; elle accomplit une fonction, somme toute, positive pour l’organisme et le psychisme du sujet.
[xxviii] S. Freud, Le problème économique du masochisme 1924, Ed: Folio-Gallimard,Paris, 1989.
[xxix] C’est celle-ci la réponse rassurante donnée par exemple par T. Reik, Masochism and Modern Man, Farrar & Rinehart, New York-Toronto, 1941; tr,fr. Le Masochisme, Payot, Paris, 2000.
[xxx] Souvent les masochistes jouissent à rédiger des contrats avec la femme qui les torture, où ils établissent les limites et les modes de leur soumission à elle. Il s’agit d’un contrat où un sujet librement s’engage à sa propre servitude ! Un double bind, une provocation ironique à toute logique juridique.
[xxxi] Voir à ce propos de Gilles Deleuze, Présentation de Sacher Masoch, Minuit, Paris, 1967.
[xxxii] T. Reik op.cit.
[xxxiii] Par son auteur, Dominique Aury, secrétaire de Jean Paulhan.
[xxxiv] Le plaisir coïncide avec la suppression de la tension interne provoquée par les excitations de l’appareil sensoriel. « Cette conviction - dit Freud - constitue l’une des plus puissantes raisons qui nous font croire à l’existence de pulsions de mort. » (Au-delà, cit. p. 70)
[xxxv] Au-delà, tr. S. Jankélévitch, cit. p. 70
[xxxvi] Pour Freud l’autre est déjà une cellule pour l’autre cellule, un organisme pour un autre organisme ; en remontant vers des niveaux de complexité de plus en plus hauts, l’autre est « ton prochain ». L’autre pour Freud n’est pas seulement un étant doué d’une psyché, c’est n’importe quoi à qui un humain peut s’unir.
[xxxvii] Cette interprétation de la tragédie comme sacrifice a été consolidé par les travaux de W. Burkert, "Greek Tragedy and Sacrifical Ritual", Greek, Roman and Byzantinian Studies, 1966, pp. 87-121; Homo necans. Antropologia dei sacrifici cruentï nella Grecia antica, Boringhieri, Torino 1981; Mito e rituale in Grecia, Laterza, Bari-Roma 1987. Cette reconstruction voit la tragédie attique comme une “comédie de l’innocence”: la même communauté qui à l’origine sacrifiait un “bouc émissaire”, dans la forme tragique masque le meurtre sacrificiel. Cf. les travaux classiques de R. Girard, La violence et le sacré‚ Grasset, Paris 1972; Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris 1978.
[xxxviii] Aristote, Problèmes, Paris, Les Belles lettres, 1993, t. II, p. 115 = Bekker 922a 17-18
[xxxix] Cela jusqu’au moment où d’abord des bourgeois, et ensuite des gens du peuple et des prolétaires, ne deviendront les héros tragiques typiques. Mais cela est arrivé car le kratos dans le monde moderne appartient de plus en plus à ces derniers: les puissants diront qu’ils sont les serviteurs de leurs co-citoyens, les véritables seigneurs. Les princes d’aujourd’hui se vantent, de plus en plus, de « servir le peuple ».
[xl] Aristote, Poétique, cit., 1448a 1 sqq. e 1448a 16-18.
[xli] Je me réfère ici à la dialectique du maître et du valet, qu’Hegel a mis en place dans la Phénoménologie de l’esprit (1830; §§ 433-5). Le maître est celui qui, au risque de sa vie, déchaîne la lutte à mort pour se faire reconnaître. Le valet est l’homme qui, pour ne pas risquer sa vie, se soumet au maître. Mais, avec le temps, en s’appuyant sur le travail et la science le valet reprend sur un plan plus haut la lutte pour la reconnaissance.
Flussi © 2016 • Privacy Policy
 IT
IT EN
EN