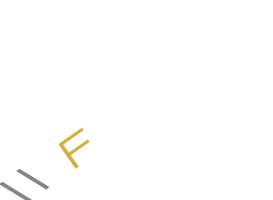Sublimation et compassionJun/24/2020
Sublimation et compassion[1]
Sergio Benvenuto
Dans le Vocabulaire de la psychanalyse, Laplanche et Pontalis terminent l’article “ Sublimation ” en écrivant : “L’absence d’une théorie cohérente de la sublimation reste une des lacunes de la pensée psychanalytique”[2] Aujourd’hui, après plus que 40 ans, ce même jugement pourrait être répété.
Mais est-ce que cette lacune est fortuite ? Ou n’est-elle pas une condition nécessaire de la psychanalyse elle-même ? D’une part la théorie de la sublimation manque, de l’autre la sublimation reste tout de même un présupposé constituant de la pratique psychanalytique. En effet, une grande partie des analystes aujourd’hui pensent que le but de l’analyse n’est pas quelque chose comme le Zuidersee hollandais, qu’il ne s’agit pas du tout d’assécher nos désirs et nos pulsions (l’inconscient) mais bien plutôt de les (le) sublimer. Pour sa part, Freud considérait la capacité de sublimer comme une qualité requise essentielle pour pouvoir mener un traitement analytique. En effet, si la sublimation est à la fois le présupposé, le but et la fin de l’analyse – au sens où chaque analyse conduirait à une forme spécifique de sublimation – jusqu’à quel point alors ce présupposé qui serait aussi une fin peut-il être quelque chose qui soit analysable, donc à déconstruire ? En somme, de quelle façon la psychanalyse peut-elle analyser ce qui apparaît être à la fois la condition et le but de l’analyse elle-même ?
- 1. Dom Juan versus Da Ponte
En apparence, le concept de Sublimierung fait partie des concepts les plus simples de la construction psychanalytique complexe. “ Nous appelons sublimation – écrit Freud– un certain type de modification du but (pulsionnel) et de changement d’objet où notre jugement social intervient ”[3].
La sublimation n’est donc pas seulement un processus économique et dynamique : elle est imprégnée d’une dimension que j’appellerai socio-syntonique (un jugement social positif). Pour Freud, les pulsions partielles sont rarement en accord avec les valeurs sociales : les pulsions, étant égoïstes et privées, suscitent la plupart du temps des jugements sociaux négatifs. La sexualité n’est approuvée que lorsqu’elle est encadrée, limitée, selon des modalités socialement admises ; bref, moins la sexualité est située dans le registre de l’amour-passion, plus elle est amour conjugal. La sublimation, bien au contraire, nous réconcilie avec nos semblables dans la Cité – elle crée des liens sociaux “ élevés ”[4].
Le concept de sublimation paraît donc indissociable de ce qu’on pourrait appeler le matérialisme généalogique de Freud. Il construit sa théorie sur cette énonciation : que les poussées et désirs qui ont leur source dans le corps – et qui visent le corps propre ou celui d’autrui – sont plus fondamentaux, plus explicatifs des poussées et des désirs qui ne sont pas directement embrayés dans le corps propre ou dans celui d’autrui. C’est ainsi que les phases du développement libidinal chez Freud reçoivent leur nom de zones précises du corps, dans la plupart des cas des muqueuses – bouche, anus, clitoris, pénis – et des fonctions en corrélation avec celles-ci. Même les pulsions agressives ont leur fondement, selon Freud dans les muscles et les tensions physiologiques[5] (De là vient la difficulté, pour la psychanalyse, de reconnaître le caractère radical, irréductible, de certaines impulsions non encrées dans le corps –par exemple de la pulsion agonistique, celle qui nous pousse à rivaliser avec les autres et à nous passionner pour les compétitions entre les êtres humains. Le plaisir du sport, qui fascine des milliards d’êtres, n’est certes pas réductible à l’expression de l’agressivité.)
Donc, l’arché de la vie humaine – selon la métaphysique de fond qui inspire la théorie de Freud – est dans le corps en tant que Leib, en tant que corps vécu. Arché, en grec, était tout ce qui commandait, ce qui venait en premier soit sur le plan généalogique que sur le plan hiérarchique, c’était le plus primitif et donc le plus essentiel – fondement et origine à la fois. La théorie de Freud est une théorie du lüsterner Leib (du corps lascif) comme arché des avatars humains. Les pulsions qui surgissent du corps vécu et de ses orifices sont originaires – ce qui reste est une dérivation, un succédané, un ajustement adaptatif, une déviation par rapport à la vérité ou à l’authenticité. Bref, pour Freud la vérité humaine ultime est dans die Lust – un terme ambigu, car il désigne soit le désir (que Freud appela libido) soit le plaisir. A savoir, dire la vérité ultime sur les êtres humains équivaut à mettre à nu la puissance du désir sensuel, qui a comme but la jouissance et le plaisir.
Cela veut dire que si moi, Dom Juan, passe tout mon temps à séduire des femmes, alors j’exprime la vérité propre (eigen), authentique, de mon être ; si par contre moi, Lorenzo da Ponte, j’écris le livret de Don Giovanni pour Mozart, alors je sublime. La conquête des femmes, pour autant qu’elle tende à satisfaire ma libido objectale, est plus fondamentale, plus originaire, que la conquête de la gloire dans l’opéra, car dans ce deuxième cas il s’agit de satisfactions purement mentales. Les livrets sont des mots, non pas des corps qui sentent et que l’on touche. Donc, le fait de séduire le public par un texte est une dérive de la séduction des femmes (pour certains, le public doit être séduit comme s’il était une femme). Ce n’est pas que le librettiste pâtisse des symptômes (comme le névrosé) ou qu’il divise sa subjectivité (comme le pervers), mais le plaisir de raconter les exploits du séducteur peut être expliqué à travers le plaisir du séducteur, et non vice versa. Le lüsterner Leib a une primauté épistémologique et herméneutique (mais non pas éthique). D’autant plus que le Dom Juan du mythe finit par sombrer dans l’enfer, tandis que le librettiste à succès devient riche et célèbre.
Il est certain que Freud – en énonçant la vérité essentielle de l’être humain comme die Lust – s’insère dans une lignée de la pensée occidentale moderne qui aspire à manifester l’essence et l’origine de l’être humain dans quelque chose de l’ordre de la vie brute, dans une source vitale. Schopenhauer avait écrit que chez l’être humain se manifeste une vérité essentielle du vivant : la Volonté -- cette impulsion aveugle et sans conscience, effrenée. Marx avait affirmé que la vérité essentielle de l’humanité est le travail, c’est-à-dire le processus de production et de reproduction. Pour Nietzsche, l’essentiel est la volonté de puissance, c’est-à-dire la pulsion humaine qui nous pousse à commander les autres et à nous faire obéir. Toutes celles-ci sont en somme des généalogies métaphysiques : la réalité humaine “ civilisée ” (les systèmes politiques, les codes moraux, les institutions sociales, les conceptions religieuses, les modes intégrés de vivre, etc.) provient toute entière de sources exprimant la vie nue[6], de sources qui dans la plupart des cas restent voilées aux yeux des êtres civilisés.
- 2. Un messianisme minimaliste
Si la métaphysique énonce le fondement et l’origine, au contraire, ce que Giorgio Agamben (2004) appelle le messianique , annonce l’achèvement. Tout de même, la tentation de faire déboucher la reconstruction généalogique des aménagements de la civilisation dans une dénonciation est très forte : ces aménagements, juste parce qu’ils masquent la force essentielle qui produit l’histoire humaine, apparaissent comme des illusions et des falsifications à des yeux “ généalogiques ”. Le penseur généalogique tend alors à se proposer comme un promoteur messianique d’une mutation historique : il faut accéder à une forme d’humanité qui coïncide avec sa propre essence, à une manière de vivre vraie et authentique. Et Freud a appelé inconscient – en tant que lieu des pulsions et des visées originaires – cette vérité à réactualiser. En effet, le monde inauthentique pour Freud est produit par le refoulement et le désaveu (Lacan y a ajouté la forclusion, Verwerfung, un troisième type de négation à la source des psychoses) : celles-ci produisent des illusions, bref, des névroses , des perversions et des psychoses. Et le traitement (Behandlung) consiste dans le rétablissement d’un régime où la vérité s’impose par une spontanéité retrouvée. C’est la cure par le retour à la vérité comme source. La psychanalyse proclame “ Je ne refoule pas, je ne désavoue pas, je n’opère pas de forclusion – je sublime ”.
La métaphysique remonte à l’arché, tandis que le messianisme promet le Salut. Pouvons-nous donc dire que pour Freud le lüsterner Leib est l’arché métaphysique, tandis que la sublimation est l’accomplissement qui nous sauve ? Il est vrai que la Bonne Nouvelle psychanalytique paraît être assez modeste si on la compare à celle judéo-chrétienne (qui promet la vie éternelle !) ou à celle, rousseauiste, (qui promet le retour à une vie naturelle heureuse !) : la psychanalyse ne promet même pas le bonheur[7], elle ne laisse entrevoir qu’un “ vivre selon la vérité ”. Le sien est certes un messianisme minimaliste – mais un messianisme tout de même.
La psychanalyse est-elle une pratique de conversion, au sens où l’apôtre Paul l’entendait? A savoir, promet-elle l’accomplissement grâce à une metanoia, à travers une mutation de l’esprit qui aille au-delà de l’esprit ? Il n’est pas facile de répondre à cette question, car sur ce point les analystes divergent. En psychanalyse, l’annonce messianique est transcrite comme la question qui touche la fin de l’analyse. En quel sens une analyse peut-elle se terminer ? Pour certains elle ne peut pas se terminer : l’analyse avec un analyste peut se terminer, mais elle se poursuit pour le reste de la propre vie de “ l’analysé ” comme auto-analyse – bref, l’analyse est interminable, elle ne s’achève jamais. Pour d’autres au contraire il y a une fin de l’analyse, on tourne la page dans sa propre existence : cette analyse-là est messianique. La sublimation – ou la créativité, pour parler comme Winnicott – est invoquée souvent comme un accomplissement. Pour d’autres, au contraire, l’analyse reconvertit, au sens où l’on dit, par exemple, qu’une région agricole se reconvertit à des activités industrielles. Alors, la sublimation est-elle une conversion (messianique) ou une simple reconversion (adaptative) ?
Il faut remarquer que la généalogie freudienne – à la fois herméneutique et métaphysique – diverge de l’image de l’être humain que la biologie et les neurosciences contemporaines nous offrent aujourd’hui : pour celles-ci le désir et le plaisir corporels n’ont aucune primauté ou préséance sur les désirs ou les plaisirs dits spirituels, pour la simple raison que le corps n’est subjectif que grâce au cerveau. Pour la biologie moderne, dans le fond, l’humanité n’est que de l’esprit (mind) : pour elle, la distinction entre les plaisirs corporels et mentaux perd son sens (le cerveau a des cartes [maps] du corps, et les désirs et plaisirs physiologiques concernent ces cartes du corps et non pas le corps lui-même). Nul besoin d’expliquer la passion pour les mathématiques ou pour la philosophie par des pulsions plus primaires, comme celle d’évacuer ou de sucer, chaque plaisir est originaire[8]. Aujourd’hui les sciences cognitives sont très en vogue : comme le nom l’indique, ce sont des sciences qui ramènent aux facultés mentales supérieures tout ce que la psychanalyse a ramené aux archés pré-rationnels (les pulsions et les zones érogènes, les premiers rapports affectifs mère-enfant, l’autoérotisme primaire, etc.). Si les cognitivistes étaient intéressés aussi à des élaborations déconstructives, ils pourraient dire que la théorie de Freud se fonde sur une métaphysique de type médiéval ancien, qui séparait hiérarchiquement les plaisirs spirituels des plaisirs charnels. En effet, quand Nietzsche et Freud disent que la chair précède l’esprit et le détermine, ils restent pourtant encore à l’intérieur de cette division esprit versus chair, c’est-à-dire à l’intérieur d’une métaphysique judéo-chrétienne.
- Le créateur et son public
Alors, faut-il abandonner la théorie de la sublimation ? Et avec elle abandonner toute la métaphysique qui inspire la théorie psychanalytique, dont la thèse de la sublimation est le volet messianique ? Devons-nous abandonner complètement cette idée de la primauté métaphysique du lüsterner Leib en tant qu’origine et source des créations et des réalisations humaines ? En suivant les cognitivistes, devons-nous abandonner le matérialisme métaphysique de Freud (autant que les matérialismes métaphysiques de Marx, Nietzsche, Deleuze, etc.) pour nous limiter au matérialisme scientifique d’aujourd’hui, pour lequel il n’y a aucune arché fondamentale de la vie humaine, à l’exception de notre génome ?
Pourtant, tout en admettant les limites scientifiques et historiques de la philosophie qui constitue la toile de fond de la pensée de Freud, il est vrai quand même que sa thèse de la sublimation poursuit un ancien débat non résolu, et que je peux formuler de cette façon : s’il est vrai, comme le matérialisme scientifique d’aujourd’hui le reconnaît, que l’être humain – tel que tout être vivant – est fondamentalement égoïste (il est réglé par le Lustprinzip, par le principe de désir-plaisir, disait Freud), d’où naissent alors les activités, les désirs et les plaisirs altruistes ou métaphysiques?[9] D’où vient toute cette envie de la part de tant d’êtres humains de se battre pour des causes idéales, d’atteindre des buts qui ne donnent aucune satisfaction personnelle immédiate, de se sacrifier pour un dieu, de laisser des œuvres ou des souvenirs de soi qui survivent à leur propre vie personnelle ? Qu’est-ce qui, en somme, pousse l’être humain hors de soi, vers des réalisations ex-tatiques qui le transcendent ? Freud, à travers la thèse de la sublimation, a cherché à répondre, dans le fond, à cette question.
Or, Freud ne parle de sublimation que dans le cas du créateur, artiste ou écrivain, et de l’investigateur intellectuel (savant, philosophe, psychanalyste). Il ne parle pas de sublimation à propos d’activités professionnelles non culturelles, même si elles sont conduites avec plaisir et satisfaction. Un charcutier qui s’amuse à faire son travail ne sublime pas – le fait d’affirmer qu’il sublime, franchement, risquerait de susciter de l’hilarité. Bref, la sublimation concerne des activités qui sont considérées créatives, intellectuellement prestigieuses, donc “ sublimes ”. Mais cette restriction justement nous autorise à examiner ici la sublimation d’un autre point de vue aussi : celui du spectateur et du lecteur. Le peintre sublime, tandis que le charcutier ne sublime pas, car le peintre produit des objets spécifiques qui à leur tour rendent possible, parmi ceux qui apprécient l’art, un plaisir “ sublimé ”, tandis que le plaisir de celui qui achète du jambon n’est pas sublime, quand bien même il s’agirait du jambon le plus exquis du monde. En somme, le spectateur ou lecteur semble en quelque façon contaminé par le processus de sublimation du créateur. Ici, donc, nous parlerons de la sublimation comme d’un processus unique, dont un côté est le créateur, et l’autre est le spectateur ou lecteur. En employant une terminologie kantienne, nous dirons que la sublimation concerne soit le génie (le créateur) soit le sujet du jugement de goût.
Cette approche n’est pas seulement la mienne. Hanna Segal (1952), analyste kleinienne, a écrit qu’à travers les œuvres d’art nous nous identifions certainement aux protagonistes, mais de plus nous nous identifions au créateur, à savoir à quelqu’un qui a réussi à extraire quelque chose de valable d’une expérience de perte. A son avis, par notre identification avec l’artiste nous réussissons – peut-être à travers une catharsis provisoire -- à porter à terme nos deuils. Donc, quelque chose du processus créateur va tout de même au spectateur ou au lecteur, grâce à son identification à l’auteur. Nous reviendrons sur ce point essentiel : à savoir que l’activité artistique “ traite ” d’une perte ou manque.
Ici, nous nous concentrerons sur une expérience “ sublime ” spécifique, celle des arts. D’ailleurs, le terme freudien de sublimation semble dériver de la réflexion esthétique sur le sublime, depuis le Pseudo Longin.
- 4. Le désintérêt sublime
Dès le moment où la pensée occidentale s’est confrontée à l’expérience artistique, elle a vite thématisé une ambiguïté affective profonde chez le spectateur. Cette ambiguïté est déjà pleinement articulée dans la Poétique d’Aristote. Son affirmation sur les effets psychiques de la tragédie est bien connue : que celle-ci engendre deux passions, eleos (pitié) et phobos (angoisse) ; mais ensuite, de façon bien étrange, elle les purge (catharsis). La tragédie nous affecte pour rien : elle agit comme un médecin qui nous inoculerait une maladie pour nous la guérir aussitôt après. Qu’est-ce qu’on gagne alors dans ce processus ? En effet, se purger de la pitié et de l’angoisse ne signifie pas ipso facto se priver d’affect. Cette purgation – suppose-t-on – nous donne un plaisir particulier. Un plaisir engendré par une sorte de déplaisir. Bref, Aristote, déjà, à propos de la littérature tragique, remarque qu’existe une implication essentielle entre le déplaisant et le plaisant.
Ensuite, l’esthétique de la fin du XVIIIe siècle a développé la notion de sublime, en tant que distinct du beau. Un effet sublime à l’époque était donné par des formes d’art qui excluaient la présence et l’intégrité humaines – telles que des cieux orageux, des océans dans la tempête, des glaciers inatteignables. Pour Kant (Critique de la capacité de juger) le sublime couvrait la surface du plaisir déplaisant, ou du déplaisir plaisant (Kant distinguait le “ sublime mathématique ”, qui provoque un plaisir qui déplaît, du “ sublime dynamique ”, qui provoque un déplaisir qui plaît). Comme Aristote, même si c’est de manière différente, Kant relie (de façon presque perverse) plaisir et déplaisir, qui se trouvent ici imbriqués. Comme dans la topologie de la bande de Möbius ou dans celle de la bouteille de Klein (des figures qui en mathématiques se disent non-orientables), dans le sublime, le plaisir et le déplaisir n’apparaissent pas opposés comme l’intérieur l’est à l’extérieur, le recto au verso, mais comme deux moments d’un continuum. Lust-Unlust, plaisir-déplaisir, constituent une figure non-orientable. Mais aujourd’hui que notre vision esthétique promeut le sublime au dépens du beau, nous pouvons dire – si Kant a bien vu – qu’une implication profonde entre plaisir et déplaisir caractérise la sublimation esthétique en général. La sublimation concerne en somme non pas l’art sublime (qu’ensuite on a appelé romantique) mais l’art tout court.
Freud, comme d’autres penseurs avant lui, se pose dans le fond le problème suivant : en quoi consiste vraiment le plaisir soit d’admirer l’art soit de le produire ? Et quel type de plaisir est-ce ? De façon plus générale, qu’est-ce qui conduit des êtres humains – ou une instance plus ou moins présente chez chaque être humain – à se consacrer à quelque chose de “ sublime ” ? à savoir, trop élevé ou trop bas pour qu’il puisse être réduit à une économie domestique des propres plaisirs et des propres satisfactions ?
Or, les produits artistiques nous donnent des types différents de plaisir, mais lequel d’entre eux est spécifiquement sublime ? Si je regarde le beau portrait de mon cher ami disparu, j’en tire un certain plaisir – c’est pour cela que je le tiens accroché au mur chez moi, pour nourrir ma nostalgie aigre-douce. Mais il est évident que ce plaisir me vient surtout du modèle représenté, et non pas tellement de l’art ; une autre personne, qui ne connaîtrait pas mon ami, ne tirerait aucun plaisir spécial en regardant ce tableau. Lorsque je contemple le portrait de mon ami, je n’en jouis pas comme d’un événement artistique. Un autre exemple : mettons que le David de Michel-Ange m’excite sexuellement. Dans ce cas-là il est évident que l’art de Michel-Ange aurait produit sur moi un effet non négligeable. Mais pourrions-nous dire que j’aie joui de l’œuvre en tant qu’événement artistique ?
Kant répondrait que non, parce qu’il définissait le goût esthétique comme “ la faculté de juger d’un objet ou d’une représentation par le moyen d’un plaisir, ou d’un déplaisir, sans aucun intérêt ”[10] Etant donné que l’attraction sexuelle constitue “ un intérêt ”, la statue de David est pour moi plaisante, dirait Kant, mais non pas belle ni sublime au sens esthétique pur[11]. Même chose pour le portrait de mon ami : ici l’intérêt consiste dans le fait de garder vif en moi le souvenir d’une personne qui fut réelle. L’art, au contraire, doit produire un plaisir “ désintéressé ” déterminé, c’est-à-dire non lié au plaisir pour l’existence de la chose représentée. Mais que voulait dire Kant en distinguant un plaisir intéressé d’un autre désintéressé ? Le concept même de “ plaisir désintéressé ” n’est-il pas une contradiction dans les termes ? Ne trouvons-nous intéressant, de façon automatique, tout ce qui est pour nous plaisant (bien que nous ne puissions dire le contraire) ? Kant dirait que la statue de David m’attire érotiquement parce qu’au-delà de la statue j’aspire à me satisfaire avec un David en chair ; dans ce cas-là, on parlera du beau David réel, et non pas de la belle statue.
La perspective freudienne (comme déjà jadis celle de Nietzsche) semble contredire l’analyse kantienne : la première tend à lier ensemble ce qui est tout simplement plaisant, avec le beau, le sublime, le bon. A savoir que Freud articule tous ces concepts généalogiquement, il ne se limite pas à les distinguer logiquement (mais la connexion généalogique n’équivaut pas à l’identité ou à l’absence de distinction). La théorie freudienne vise à indiquer la source même du plaisir artistique, et de toute façon cette source doit être – cela est l’axiome freudien – die Lust.
Ce plaisir dans l’art certes implique une dimension d’illusion : il suffit de penser aux effets de vraisemblance, qui sont indispensables pour que nous puissions nous laisser toucher par une œuvre (nous “ palpitons ” pour nos héros comme s’ils étaient réels), et aux affects que l’art provoque en nous en tant qu’ils sont le rejeton de ces illusions. Bref, le fait de susciter des illusions de vraisemblance ou des illusoires excitations érotiques n’est pas quelque chose qui est étranger à l’art. Il faut noter pourtant que ces effets d’illusion peuvent ou doivent être ressentis mais qu’ils doivent être aussi dépassés pour qu’une jouissance vraiment artistique puisse avoir lieu. En d’autres termes, le désintérêt kantien dans le jugement de goût est le point d’arrivée d’un processus à partir justement de l’intérêt. En termes hégéliens, nous pouvons dire que ce jugement est le résultat d’une Aufhebung, c’est-à-dire d’une annulation, conservation et élévation de l’intérêt comme Lust[12]. Etant donné que chez Kant l’intérêt non-artistique (le jugement esthétique empirique, comme l’appelait Kant) est lié à l’existence réelle de l’objet représenté, alors l’accès à la jouissance purement esthétique exige quelque chose de très semblable à une annihilation – à la destruction ? – de l’objet lui-même. L’œuvre d’une part présente des images ou des sons qui très souvent nous leurrent sur la présence des choses qu’elle imite, d’autre part elle met en évidence une absence ou une intangibilité dans le réel[13]. Et cela est vrai autant pour le producteur que pour le spectateur de l’art.
- 5. Le désarmement esthétique
Une fois que Modigliani était allé rendre visite à Renoir, il trouva le vieux peintre très occupé à peindre le derrière d’une femme nue. Renoir lui dit qu’il aurait continué à travailler à ce tableau… jusqu’à ce qu’il ait eu lui- même envie de pénétrer ces fesses. Une confidence de cette teneur semble désavouer toute théorie sur la fonction de sublimation ou de “ pacification ” de l’art. Tout de même, il faut noter que Renoir, au lieu de passer ses journées à rechercher des fesses de femmes réelles, s’est consacré à peindre un derrière qu’il n’aurait jamais pu pénétrer. Alors, l’art nous initie à jouir d’une frustration ? Bref, l’art est une forme de perversion ? Je ne dirais pas cela, en tout cas pas toujours.
Il est vrai que l’art engendre et parfois exaspère nos passions, y compris les passions érotiques. Mais il vrai aussi que ces passions évoquées ne nous poussent pas à passer à l’acte : l’art les garde a l’état passif, ce qui revient à dire qu’il les laisse être des “ passions ”. L’art figuratif, à travers les représentations, fait étinceler une jouissance, mais il nous la rend tout de même impossible, et il nous pousse ainsi à nous interroger, à faire du souci (Sorge) quant à ce dont nous ne pouvons pas jouir. L’art nous donne une jouissance sublimée pour autant qu’il nous fait jouir de ce dont nous ne pouvons pas jouir. Il exploite certes le désir, mais il le désarme. Ou mieux, d’un côté il aiguise nos armes (il provoque en nous des sentiments patriotiques, révolutionnaires, vertueux, vengeurs, érotiques, etc.), mais d’un autre côté, pendant le moment où nous admirons l’œuvre, nos armes restent oisives, comme celles du dieu Arès dans le lit d’Aphrodite.
Une certaine tradition spiritualiste exploite ce paradoxe affectif de l’art – à partir de la catharsis aristotélicienne jusqu’à la sublimation freudienne, en passant par le “ plaisir désintéressé ” kantien – et elle insiste donc sur la fonction transfiguratrice de l’art. Non pas seulement au sens que l’art figuratif ou narratif idéaliserait de manière esthétique le sensible qu’il représenterait, mais au sens aussi que cet art nous détournerait des désirs brutaux (sexuels, politiques, pragmatiques) en causant un “ raffinement ” spirituel de nos affects. La transfiguration opérée par l’art serait alors double : d’une part elle donnerait au sensible une dimension intelligible, de l’autre elle produirait une sorte de transsubstantiation de nos passions, par quoi celles-ci seraient alors amenées à une jouissance éthérée et purifiée. Hegel a écrit que “ l’art a la capacité et la vocation d’adoucir la barbarie du désir ”. Pour Hegel, l’art n’abolit pas le désir, il l’adoucit, au sens que d’une certaine façon il inhibe notre action et notre passion désirantes. Tandis que l’action est “ barbare ”.
Cela semble contredit par d’autres affirmations ; par exemple, par celles d’Alfred Hitchcock, quand il disait que le cinéma représente la vie telle quelle est, mais en effaçant tout ce qui dans la vie nous ennuie. Pourtant, même si nous concevons un film qui soit un choix à partir de la vie réelle de tout ce qui peut nous amuser, même cette sélection finit par idéaliser la vie même : celle-ci, grâce au cinéma, nous apparaît intensément vécue. Une vie sans temps morts, la vie seule et entièrement vie est une vie idéale, comme celles qu’on voit au cinéma ou qu’on lit dans les romans. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de spectateurs voudraient imiter la vie des héros cinématographiques, même quand ceux-ci endurent des peines et de dures épreuves : nous voudrions vivre pleinement leur vie. C’est ainsi que la nature (à savoir l’humanité) imite l’art.
En effet, ce que nous appelons aujourd’hui l’art classique se voulait une idéalisation esthétique du sensible. L’art classique n’a jamais été simplement représentatif, il n’a pas été quelque chose comme l’hyperréalisme contemporain, par exemple : il visait toujours une transfiguration de l’objet, qu’il soit réel ou imaginaire, bref une transfiguration non pas seulement de l’objet, mais aussi du type d’affect que celui-ci provoque en nous : d’une émotion sensible à un plaisir intelligible.
Prenons le portrait de la Fornarina de Raphaël. Ce n’est pas un hasard si nous choisissons ici une œuvre érotique, et une œuvre de Raphaël. Nous ne prenons pas l’image d’une Madone, par exemple, car le fait de la placer dans un musée la priverait de toute possibilité de “ consommation ” religieuse de la part des catholiques, tandis que l’impact érotique d’un tableau peut se produire même dans un musée. De plus, Raphaël est exemplaire car il était platonisant : comme il l’a dit lui-même, chacune de ses figures tendait à donner forme visible à un eidos, à une figure essentielle, à se poser comme le paradigme du sensible[14]. A l’encontre des specula mundi que ses illustres contemporains tendaient à créer, il misait sur des représentations idéalisées.
Mais il faut regarder la Fornarina avec attention. Elle nous regarde d’un regard ambigu : elle est douce mais elle ne sourit pas, elle nous regarde avec une tendre indulgence et pourtant elle n’est pas non-vitante. Elle paraît un peu gênée qu’on lui fasse son portrait en déshabillé, et ses yeux globuleux dans un “ mouvement ” plein de retenue évoquent quand même un peu de tristesse. Cependant, on est soudain surpris de découvrir que sur ses cheveux aplatis et ordonnés est posé un foulard à fond jaune avec des raies brunes. Il s’agit d’un fichu humble, grossier, “populaire” -- on ne le verrait pas dans les images des Aphrodites grecques ou romaines. Alors nous sommes “piqués”, émus, par ce détail. Car jusqu’à maintenant nous n’avions vu que le poios – l’idéal féminin – et tout d’un coup, à nos yeux, un voile tombe : il ne s’agit que de la fille d’un boulanger de Sienne! (Fornarina signifie en effet Petite Boulangère.) Après l’incitamentum érotique, un punctum nous suspend et nous émeut. La timidité effrontée de la Fornarina finit par nous désarmer. Il faut alors regarder à nouveau toute la figure à partir de ce chiffon sur la tête.
Du punctum – la piqûre --, Roland Barthes (1980) a parlé à propos de la photographie. Il distinguait le studium du punctum. Le studium est l’intérêt cultivé, courtois, détaché pour une image photographique, ce qui nous porte à apprécier de manière sereine ses significations. Le punctum par contre est “piqûre, petit trou, petite tache, petite coupure”[15], mais aussi coup de dés, coup de poigne, ponctuation et tache. Cela se produit lorsque un détail ou un trait de la photo ébranle et trouble le spectateur. Si le studium est “cela je l’aime bien”, le punctum est “cela je l’aime”. Le punctum est en somme le détail souvent incohérent qui produit en nous de la pitié pour l’étant représenté. Cela arrive car la photographie est la trace chimique d’étants réels, non pas une représentation qui les transfigure. Mais aussi, l’image figurative non photographique nous pousse à nous apercevoir de l’étant; cette image aussi peut être perçue avec du studium ou bien – dans certains cas – elle peut “nous piquer” vraiment.
Or, ce fichu rayé nous pique car il nous montre l’humilité de la Fornarina, et ce n’est pas un hasard si nous l’appelons ainsi. D’une part le tableau de Raphaël se propose en tant que paradigme typo-graphique (idéalisant) d’une Vénus dans le goût de la Renaissance, en inaugurant ainsi l’intellectualisme maniériste. D’autre part, le même tableau par contre nous convoque à une pitié et à une angoisse -- eleos et fobos – pour la créature représentée : elle est touchante car elle apparaît bien inadéquate si on la confronte à l’eidos qu’elle devrait représenter. Tout d’un coup, l’étant dans toute sa scandaleuse contingence nous est révélé. La grâce du tableau est l’effet de cette optique double (à la fois idéalisation et compassion piquante), d’une sorte de bon tour ironique que le sensible joue à l’intelligible, en humanisant et en historicisant ce dernier.
Et cela devient possible parce que toute œuvre d’art nous offre un événement ou une chose, et elle nous fait nous intéresser à l’un ou à l’autre, tout en mettant en suspens nos rapports pragmatiques avec l’événement ou la chose. Elle nous offre une image sacrée non pas juste pour pouvoir lui vouer un culte religieux, elle nous offre une image érotique non pas juste pour l’employer à des buts sexuels. Cette dimension de “ désintérêt ” kantien (en dépit de toutes les dérisions dionysiaques) ne peut pas être ignorée: l’œuvre d’art nous fait nous intéresser à l’événement ou à la chose qu’elle représente ou présente – car l’œuvre elle-même est événement ou bien chose – justement dans la mesure où elle nous fait suspendre les intérêts égoïstes qui peuvent réduire cet événement ou cette chose à un de nos objets. Même la boulangère, à la fois comme modèle réel et comme portrait, est un événement. Elle nous émeut pour autant qu’elle cesse d’être notre objet d’admiration érotique ou fétichiste: elle est quelque chose qui ne peut pas nous appartenir.
6.
Aristote pensait aux étants à travers deux catégories fondamentales: praxis et pathos, agir et pâtir. On devrait reconsidérer ces catégories, aujourd’hui. Nul doute que les œuvres d’art nous invitent au mouvement, qu’elles sont un incitamentum à agir (praxis) en nous poussant à en venir aux mains surtout. Tout art “engagé” – dans le culte religieux, dans la propagande, dans la moralisation, dans l’attrait sexuel, dans la provocation d’avant-garde, dans l’épouvante horror, etc. – nous pousse à agir, à attaquer ou à nous enfuir, et à frapper avec nos mains. Parfois l’art se fait propagande de lui-même, et donc il incite au combat, à la bagarre – comme cela arrivait dans les provocations publiques futuristes ou surréalistes – , étant donné qu’au XXème siècle l’art lui-même est devenu une cause, et qu’il fallait “ prendre parti ”, en venir aux mains.
Et pourtant, tout compte fait, le genre d’art que nous considérons supérieur finit par bloquer ce mouvement – il nous lie les mains. “Noli me tangere”, nous dit l’œuvre. L’incitamentum est suspendu par le punctum: nous restons un pathos pur, passionnément passifs. L’art par un même mouvement nous trouble et nous pacifie, nous ébranle et nous inhibe, nous pousse à agir mais ce n’est que pour pâtir. Une oscillation paradoxale qu’Aristote aussi, comme on l’a vu, avait compris à propos de la tragédie.
Je me souviens que dans une Biennale de Venise à la fin des années 60, un artiste avait “ agi ” en délivrant de leurs cages des milliers de papillons. Il s’agissait d’un geste praxique, politico-écologique, qui visait à repeupler la lagune d’espèces de papillons rares ou disparues. L’happening poiétique se résolvait en praxis, le produit artistique était une action. De toute façon l’acte avait une conséquence contemplative: le spectacle pathétique de tant de papillons polychromes qui se combinaient avec les couleurs de Venise, papillons destinés en réalité à une mort rapide. L’acte artistique est un acte qui, comme pour celui d’Hamlet, nous pousse aussi à une certaine lâcheté réflexive: même lorsque l’œuvre pousse à agir, où elle-même est une action, elle inhibe l’acte par l’admiration esthétique, extatique, de l’acte. Ce n’est pas un hasard si nous considérons la musique que nous utilisons pour danser comme un art utilitaire, donc inférieur. Schopenhauer disait que l’art nous délivre – bien que pendant un bref délai – de la tyrannie de la Volonté: pour autant que nous devenons les spectateurs des passions, nous nous détachons de celles-ci. Mais en quoi ce détachement consiste-t-il?
Rappelons la troisième définition kantienne du beau (selon la relation): “le beau est la forme de la finalité d’un objet, pour autant que cette finalité y est perçue sans la représentation d’un but”[16]. Voilà une autre affirmation bien bizarre : comment peut-il y avoir une forme de la finalité de quelque chose, sans qu’un but ne puisse être représenté ? En effet, par ce paradoxe, Kant fait remarquer comment dans le beau l’étant – sous la forme d’un objet (Gegenstand et Objekt), à savoir d’étant-face-à-moi, d’étant-pour-moi – a soi-même pour but et comment il réussit à se dégager de sa relation avec mes propres buts, avec mes appétits. On pourrait objecter à Kant qu’il y a mon besoin de voir ou d’écouter de belles choses, et que donc le bel objet correspond à un but que j’ai, c’est-à-dire à mon désir de jouir du beau. Bref, nous allons à la chasse d’émotions esthétiques pour échapper à l’ennui, ce trou où la jouissance plonge. Mais la distinction de Kant est dialectique car, justement, le but humain de jouir du beau est le but de jouir non pas d’un étant, mais du fait qu’un étant soit fin à soi-même. C’est l’indifférence de la chose belle à notre faim de beauté qui la rend un objet d’art, et qui nous fait tomber les bras dans la stupéfaction[17]. C’est cette sorte d’auto-suffisante retrouvée des étants qui nous séduit dans l’art ; c’est ce que Freud, par exemple, voyait à la source de notre plaisir de cajoler des chats (Freud 1914)[18]. Le chat narcissique nous attire justement pour autant que sa beauté à la vue et sa douceur au toucher ne sont pas faites pour nous (on peut dire plutôt que nous nous en emparons). Il est évident que le chat ne vise pas à nous séduire, il ne s’occupe que de ses affaires à lui, et c’est justement son indifférence à nous séduire qui nous séduit. C’est pour cela que Kant ose dire qu’assurément l’art et le beau nous donnent du plaisir, mais qu’il s’agit d’un plaisir qui ne dépend pas de notre faculté de désirer! Peut-on avoir un plaisir sans désir correspondant, un plaisir qui nous surprenne chaque fois comme un au-delà de tout désir, bref, comme un intérêt désintéressé?[19] Or, Kant veut nous dire cela: que l’art nous donne du plaisir pour autant que nous redécouvrons derrière nos objets – qu’ils soient beaux, ou laids, ou sublimes – les choses elles-mêmes; qu’il nous donne un plaisir non planifié par le désir, un plaisir qui nous surprend.
Ainsi l’art, bien que nous proposant des objets désirables, nous convainc de respecter l’étant ; ainsi nous tendons à sauvegarder cet étant dans son indépendance par rapport à nous. Cette tutelle est la réverbération de cette passion à laquelle l’art nous contraint, pour autant qu’il nous détourne de l’action.
Bien sûr, nous ne pouvons plus sauver la belle boulangère, morte il y a des siècles, mais nous pouvons en sauvegarder le portrait. Nous avons pitié des œuvres en tant qu’elles sont des choses, si on leur porte atteinte cela nous angoisse, et donc nous nous engageons à les conserver et à les protéger en tant qu’elles constituent notre patrimoine. Disons-le franchement, beaucoup ont souffert davantage de la déprédation subie par les chefs-d’œuvre du musée de Bagdad après la chute de Saddam Hussein en 2003 que de la peine de tant d’irakiens dans cette guerre. Cette pietas pour les œuvres d’art – laquelle parfois déborde, et de beaucoup, la compassion pour les êtres humains – a été dénoncée par Tolstoï, par exemple, dans un pamphlet célèbre. Et pourtant, cette pietas qui défend les œuvres – ces étants qu’il faut protéger comme s’ils étaient des sujets – est une crux où le respect éthique et l’affection esthétique se recoupent et apparaissent étrangement imbriqués: il s’agit de notre sentiment de devoir sauver ce qui nous séduit en tant que beau ou sublime (à savoir, comme une chose qui commémore et nous remémore : un monument), afin que ce sauvetage de pitié permette à la chose de séduire encore.
Le spectateur moderne, en somme, jouit de cette responsabilité face à ce qu’aujourd’hui on est habitué à appeler le patrimoine artistique – un héritage de nos ancêtres que nous ne devons pas gaspiller, ni solder, mais bien sauvegarder.
Tout esthétisme, théorique ou pratique qu’il soit, ne réussira jamais à effacer cette implication éthique de toute expérience esthétique. Evidemment non pas au sens que l'art nous donnerait des leçons éthiques directes, comme c’est le cas avec les œuvres édifiantes qui prêchent le bien, mais plutôt au sens que l’accès à la jouissance artistique véritable exige une option fondamentale pour le respect de la chose, ce qui est le noyau essentiel de toute éthique. L'esthétique est comme le rêve joyeux de l’éthique. Ce qui dans l’expérience éthique se montre par sa face de renonciation, de sacrifice et de douleur, dans l’expérience esthétique apparaît au contraire dans cette joie et cette commotion que la renonciation à consommer justement comporte. Hegel a dit que l’art est “le dimanche de la vie”, une sorte d’activité fériée. Dans ce sillage, Gadamer (1977) parlera de l’art comme jeu, symbole et fête. Ce caractère de joie féstoyante de l’art dérive du fait que dans l’art nous laissons reposer certaines de nos pulsions (politiques, érotiques, religieuses), nous renonçons à manipuler comme nous le faisons lors des jours ouvrables, et cela non pas seulement pour nous amuser et nous détendre. La cérémonie de l’art est aussi le fait d’accueillir de nouveaux étants, c’est le fait de faire la fête à un nouvel hôte qui entre dans notre monde.
Le désir suscité par tout art figuratif passe, et se surpasse, en jouissance, dès que nous renonçons à satisfaire ce désir. Toute jouissance artistique est chaste, bien qu’elle soit rarement innocente. Le désir intéressé rend certes l’œuvre intéressante, mais l’art le snobe, le transcende dans la jouissance du dimanche de l’œuvre. La force purement potentielle de l’art suscite donc la puissance de la non-consommation. Alors on peut aussi interpréter la sublimation comme le fait de “ laisser tomber ”, comme le fait de faire lâcher la prise à la puissance. En d’autres termes, l'objet d’art est “ sublimant ” au fur et à mesure qu’il nous fait nous départir de cette pulsion qui toutefois engendre notre recherche d’objets d’art. Dans un musée, par exemple, nous cherchons des images qui puissent satisfaire notre envie de regarder. Mais lorsque nous rencontrons une œuvre, notre désir de regarder est satisfait de manière bien ironique: dans ce cas, nous permettons bien au contraire à l’œuvre de nous maîtriser- - et nous savourons le plaisir inattendu de notre déposition de la croix du désir.
A l’inverse, nous appelons “produits de consommation” justement des œuvres auxquelles nous refusons la qualité d’œuvre d’art: ce sont des produits esthétiques qui satisfont bien trop certaines de nos pulsions, qui nous réjouissent trop dirais-je – et qui donc ne sont pas sublimants.
7.
Il est certain que les tableaux de femmes à la chair “ rose ”, plantureuses et désirables, peintes par Renoir, par exemple, célèbrent une sorte de débordement de la vie au-delà de ces formes-mêmes, ils nous donnent envie de vivre. Mais comment peut-on penser aussi au fait que les belles filles de Renoir sont mortes depuis longtemps? Et même si nous étions des contemporains de Renoir, comment ne pas penser que ses modèles ne nous étaient pas véritablement présentes? Bref, même l’art le plus sensuel se réduit à n’être que des traces de quelque chose qui n’est plus ou n’est pas encore. L’art, en nous offrant quelque chose de précieux, en même temps nous rappelle le prix de la perte de ce qui est réel. Mais cette trace de quelque chose qui n’est plus ne s’épuise pas dans la référence à la chose perdue à jamais, à l’événement que nous ne vivrons pas: comme nous l’avons dit auparavant, la trace devient elle-même une chose précieuse, un étant fragile qu’il nous faut protéger dans notre espace environnant. C’est-à-dire que nous casons l’œuvre, nous lui donnons une maison, privée ou publique (dans un musée). Ou bien, comme dans le cas de l’architecture, nous en faisons notre maison même, ou la maison du dieu.
D’autre part, da manière paradoxale, l'art nous aide à renoncer à atteindre la satisfaction par des images et à nous contenter de celles-ci. D’une part, certes, l’art nous fournit des suppléants, des fétiches, dont nous pourrions nous contenter pour jouir – c’est sa dimension illusoire (perverse?). Il s’agit de cette dimension que Winnicott a appelé transitionnelle. D’autre part, l’art s’affranchit du Kitsch juste au moment où il réussit, par d’autres côtés, à nous persuader du fait que nous devons adresser notre Eros au-delà des artifices. En ce sens, tout art tend, dans le fond, à nous réconcilier avec le réel. C’est la "critique du jugement" que toute œuvre artistique réussie suscite en nous. Il est vrai que la barrière entre réalité d’un côté et image ou son de l’autre persiste, et que pour les créatures irréelles de l’art il ne reste que notre pietas -- à la fois, pitié et piété. Celle-ci surgit car nous laissons tomber le désir, qui se dépose aux pieds du réel. Ainsi l’art nous invite toujours, de manière paradoxale, à nous détacher de l’imaginaire et à ne réserver notre compassion, notre passion, qu’à ce qui vit. Peut-être que la différence entre les arts figuratifs et classiques d’une part et les arts “ modernistes ” de l’autre consiste justement en cela: que dans les œuvres classiques nous éprouvons de la pitié (eleos chez Aristote) envers des personnages représentés, tandis que dans les œuvres modernes nous l’éprouvons de la pitié pour les œuvres elles-mêmes. Ce n’est pas un hasard si un grand moderne tel que Brancusi disait : "Pensez à toutes ces statues nues qui sont en ce moment aux Tuileries, ou au jardin du Luxembourg, et qui tremblent dans le froid, dégoulinant de pluie et des glaciers!"[20]
C’est dans cette dimension de l’expérience esthétique comme souci (Sorge) de l’étant qu’il nous faudrait situer la théorie freudienne de la sublimation.
“Le sublime”, dit Freud, n’est pas seulement art et littérature, mais l’enquête intellectuelle aussi, c’est-à-dire la pratique des sciences et de la philosophie. Nous pourrions montrer, si nous avions la place ici, comment les sciences et la philosophie elles-mêmes nous attirent pour autant qu’elles nous ouvrent à un souci (Sorge) pour l’étant. Les sciences et la philosophie nous incitent à accueillir l’étant comme un membre de notre domus. (En bref, les sciences, même si elles rendent le chaos ordonné et prévisible, le thématisent cependant ; pour autant qu’elles marquent l’horizon du prévisible, elles indiquent l’au-delà de cet horizon, à savoir le réel comme chaos. La philosophie, comme Aristote le disait déjà, naît à partir de l’émerveillement pour les étants; mais, à la différence d’Aristote, non pas pour le surmonter aujourd’hui: bien au contraire, la philosophie voudrait maintenant nous ramener à l’émerveillement à cause du fait qu’il y a de l’étant plutôt que rien.) Ce qui rend sublimes certains objets et certains buts, donc, n’est pas la qualité non sexuelle de ces objets et de ces buts: je me demande si Freud ne désigne pas plutôt, de cette manière, quelque chose qui ne s’épuise pas dans la consommation privée, qui ne conduit pas à la satisfaction ponctuelle d’une pulsion, qui est partielle par sa nature même. C’est justement par cette renonciation à la consommation privée et partielle qu’on affirme la valeur sociale et globale de l’art et de la littérature (comme de la science et de la philosophie): le fait qu’il s’agisse d’événements publics.
Or, Freud relie la sublimation à Eros (en tant qu’opposé à Thanatos): l’énergie est sublimée “parce que, pour autant qu’elle sert à instituer l’unité ou le fait d’aspirer à celle-ci qui est caractéristique du Moi, elle se maintient toujours fidèle à l’intention fondamentale d’Eros, qui est celle d’unir et de lier” (Freud 1922)[21]. Des énonciations de cette teneur peuvent être interprétées de différentes manières. L’Ego Psychology les a interprétées au sens de devoir renforcer le Moi en tant que fonction de synthèse et de composition. Mais une autre interprétation est possible: que la sublimation est Eros dans la mesure où elle porte les pulsions à l’intérieur des rapports sociaux. Comme nous l’avons vu, la socio-syntonie est un élément fondamental de la sublimation: cette dernière réal-ise Eros pour autant qu’elle tend à créer des œuvres qui lient aux autres sinon le créateur, du moins son œuvre. Et dans notre optique même, qui tient compte des émotions du public, l’expérience est sublimée dans la mesure où notre délectation face aux œuvres (artistiques, littéraires, scientifiques, philosophiques) nous socialise. Même lorsque nous avons un accès privé à une œuvre – par exemple, lorsque nous lisons un livre – nous ne nous sentons pas seuls: la lecture ou la contemplation des œuvres nous introduit dans un circuit plus vaste, dans un lien social. Mais le lien social “sublime”, à la différence d’autres liens – par exemple, de ceux qui visent l’action politique ou guerrière ou sportive –, a cette particularité qu’il nous met en contact avec une lacune, avec un “ cela a été ” ou avec un “ cela peut-être sera ”, et il nous pousse à devenir les tuteurs des traces de cette lacune. Cette production “ sublimante ” produit non pas des choses dont nous pouvons jouir, mais plutôt des traces aimables de choses dont nous ne pouvons pas jouir, et elle met à disposition ces traces pour qu’on puisse les partager en société avec autrui[22].
En ce qui concerne le créateur, celui-ci, en produisant une œuvre, vise à introduire dans le monde un étant qui puisse être accueilli. Souvent, aujourd’hui, même des non analystes parlent de leurs œuvres comme si elles étaient leurs enfants: le fait d’écrire ou de publier un livre, par exemple, signifie en être le parent. Est-ce le désir d’enfanter le degré zéro de la sublimation? En effet, les rapports que les auteurs ont avec leur œuvres rappellent les rapports divers que les parents ont avec leurs rejetons: certains d’entre eux les suivent de façon anxieuse et étouffante, d’autres au contraire les laissent s’en aller seuls se promener dans le monde et ne s’en occupent plus. De toute façon, à la différence de ceux qui produisent quelque chose “usa e getta” [“utilise le et ensuite jette le”], le créateur “ sublimant” vise à imposer de manière stable son produit dans le monde ; et si cet accueil ne se produit pas, il a le sentiment de n’avoir produit que de l’excrément. L’important c’est que l’œuvre se détache de son auteur, que celui-ci en soit comme exproprié, que l’œuvre lui survive, qu’elle poursuive son chemin dans le monde – ainsi, le désir du créateur est le désir paradoxal de produire quelque chose d’autre par rapport à son propre désir. Quelque chose qui déborde son plaisir, pour qu’il puisse tirer du plaisir, tant qu’il sera vivant, de ce débordement.
8.
Freud, par son concept de sublimation, semble retrouver l’image célèbre de l’âme ainsi que Platon l’avait proposée dans le Phèdre[23]. Sa figuration de l’âme est reliée à un débat sur l’essence d’éros.
Ici Platon décrit l’âme comme un chariot comprenant un aurige et deux chevaux, l’un noir, intempérant et impudique, l’autre blanc, tempérant et pudique. Dans ce dialogue, Platon se réfère surtout à l’éros pédérastique. Or, lorsque la psyché se trouve face à la belle image séduisante – le beau garçon – le cheval noir tend à se précipiter vers l’objet, pour le consommer, dans le coït et dans la possession; tandis que le cheval blanc s’arrête devant la belle image, freiné par aidos. D’habitude on traduit aidos par pudeur, mais en grec cela signifiait en général respect, sujétion timorée, une sorte de timidité. En conclusion, l’homme tempérant respecte l’objet désirable, il ne le consomme pas. Il est évident qu’aujourd’hui, dans une culture qui prescrit la satisfaction systématique de toutes nos pulsions, l’idéal platonicien de pudeur et de respect risque même de nous faire rire. Et pourtant, la divergence platonicienne entre la précipitation possessive et la réticence respectueuse face à l’objet artistique ou littéraire forcément se propose à nouveau. Car soit la production de l’art, soit l’admiration pour l’art impliquent qu’on s’abstienne de l’action consommatrice[24].
Or, tout de même, l’allégorie platonicienne de l’âme est reliée à ce qui pour Platon importe plus que tout: le rapport de nos âmes à l’ousia, à savoir à la “réalité réelle”. Ousia, “le patrimoine”, fut traduit par les latins par substantia. Or, c’est justement dans la mesure où l’âme ne permet pas que le corps de l’autre soit possédé (qu’elle ne permet pas que la pulsion se satisfasse dans l’acting), que l’âme peut accéder à la vision de l’ousia – c’est-à-dire du réel. L’aidos, en nous retenant de la consommation finale de l’objet, dispose l’âme pour qu’elle apprécie le réel.
Je me demande si cette hygiène platonicienne, à la fois pragmatique et ontologique, ne décrit pas, au fond, ce que, bien de siècles après, Freud a essayé de désigner comme sublimation. Celle-ci serait alors l’impulsion qui nous pousse à aller au-delà de n’importe quel objet, à savoir, à ne pas réduire l’autre et le monde à nos objets. A ne pas nous emparer des choses pour en jouir, en en faisant l’objet de nos satisfactions, mais à les respecter dans leur être en elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans leur altérité absolue (c’est-à-dire absoluta, déliée, dénouée par rapport à nous). L’art nous “pique” donc non pas parce qu’il nous offrirait la chance de consommer des objets éthérés et immatériels plutôt que charnels et matériaux, mais parce que il nous initie à la jouissance d’une non-consommation. Le fait de consommer des idéaux, dans le fond, est une activité non moins “ inférieure ” que le fait de consommer de la nourriture ou des corps ; une grande partie de la production culturelle de masse n’est dans le fond qu’une consommation vorace d’idéaux. Le sublime, alors, n’est pas constitué par les objets qui nous bouleversent: c’est ce qui au-delà de l’objet nous mène vers quelque chose qui n’est pas et ne sera jamais pour nous, vers une nature inhumaine que nous ne posséderons jamais, même pas de manière esthétique. De là vient ce sens, cette dimension, de peine que Kant attribuait au sentiment du sublime, une peine due à notre impuissance face à la grandeur et puissance des choses – cette peine est la condition spécifique pour qu’il y ait un plaisir esthétique.
Ainsi, l’art nous rend respectueux, à moins que nous ne passions à l’acte de vandalisme. Une certaine hybris pousse certains hommes ou artistes exceptionnels à effacer, à rayer des œuvres, et cela dès l’Antiquité. Alcibiade fut accusé d’avoir mutilé les Hermes d’Athènes. Plus récemment, le dadaïsme choqua en mettant des moustaches à la Joconde. Marinetti proposait de détruire Venise et de la reconstruire comme un ensemble d’usines. Ce n’est pas un hasard si le dadaïsme se proposait comme anti-art, à savoir comme un appel à ne pas respecter les œuvres, à un dépassement de l’art en tant qu’expérience en soi toujours platonicienne[25]. Il ne fait aucun doute que certaines avant-gardes veulent être tout à fait anti-sublimantes: en particulier, elles visent non pas à sublimer l’agressivité, mais bien au contraire à l’exprimer comme une œuvre elle-même. Je me demande pourtant si cette destructivité iconoclaste, cette rage artistique contre l’art, n’est pas une polarité sans laquelle il ne pourrait pas y avoir de sublimation (car on sublime l’agressivité aussi). L’art peut mettre en acte de la violence, mais il l’infléchit vers l’ironie. L’iconoclastie dadaïste elle-même n’était pas du tout du vandalisme privé, mais se proposait bien comme un acte social ; elle faisait appel à un consensus et à une complicité: certains happenings artistiques destructifs travaillent toujours pour la sublimation dans la mesure où, comme Freud l’avait bien vu, ils socialisent la destructivité, ils érotisent thanatos.
Prenons deux œuvres dadaïstes très connues: l’exposition d’un urinoir par Duchamp, en 1913, avec le titre Fontaine; et l’œuvre de Man Ray Pain peint. Duchamp n’a en rien modifié l’objet américain—la vasque à uriner-- qu’il a exposé; Ray par contre a peint en bleu une baguette de pain typique. Il est possible que ces œuvres soient vraiment de l’anti-art, mais il est certain qu’il y a de la sublimation à travers elles. En effet, même si Duchamp avait pris un vrai urinoir, une chose est certaine: depuis, on ne peut plus y uriner! En ce qui concerne le pain de Ray, ce n’est pas un hasard qu’il l’ait peint en bleu: le bleu est la couleur la plus lointaine qu’il y soit du comestible (aucune nourriture n’est bleu, nourriture pourrie à part). En tout cas, on ne peut plus manger ce pain-là. Et donc, même le ready made dadaïste détourne l’objet de sa consommation, et l’élève au statut de trace. L’agressivité dadaïste se brise, se dissipe par conséquent toujours dans l’humour et l’ironie. Et en fait ce n’est pas un hasard si l’art des derniers temps – basé sur les installations et sur des constructions qui utilisent tous les instruments possibles – est en fait essentiellement dadaïste. L’art est sublimant même à travers l’anti-art.
9.
Peut-être sommes-nous à présent en mesure de comprendre mieux pourquoi la théorie de la sublimation, comme Laplanche et Pontalis l’écrivent, est une des lacunes de la psychanalyse. La sublimation est une lacune dans un double sens. D’une part c’est une lacune dans la théorie: le pivot de cette dernière est l’analyse – c’est-à-dire la déconstruction – des nœuds des désirs et des jouissances; mais quand elle doit dire quelque chose au-delà de ces processus, elle ne peut affirmer cet au-delà que de manière apodictique, non pas analytique. En effet, la psychanalyse nous charme lorsqu’elle parle du refoulement, de la division et de la forclusion, et de leurs sous-produits, bref, quand elle nous parle de ce qui n’est pas sublimé. Quand elle se met à parler de sublimations, elle devient d’habitude ennuyeuse et plate, elle sent le bien pensant (d’où cette sensation de lacune). Justement parce que la sublimation est l’Idéal de la psychanalyse – Freud lui- même fut un champion de la sublimation – la psychanalyse elle-même a bien de mal à l’analyser. L'analyste analyse le désir à partir de la sublimation, le même désir d’analyser est un désir sublimé. Donc, la psychanalyse toute entière semble accrochée à la sublimation, mais justement pour cette raison il est difficile pour la psychanalyse d’accrocher à son tour la sublimation à soi-même, à savoir, de déterminer précisément quelque chose dont elle dépend. Ce serait faire comme le baron de Münchausen, quand il s’échappa hors du fossé en se tirant par ses cheveux.
Mais la sublimation évoque la lacune aussi dans la mesure où la sublimation n’est possible qu’à partir d’une perte, peut-être semblable aux pertes névrotiques, psychotiques ou perverses. A la différence du philanthrope, qui se soucie des autres dans leur présence physique et vivante, le sublimant, par contre, qu’il soit auteur ou spectateur, se soucie de traces: il jouit d’objets qui, bien qu’ils constituent des nouveaux liens sociaux, renvoient à quelque chose qui manque ou qui est perdu à jamais. La sublimation tourne autour d’une kenosis (κ?νωσις), d’un vide, d’un évidement, c’est-à-dire d’une perte de la présence de la vie. Comme le deuil, la sublimation constitue des reliques et des lieutenants; mais tandis que le deuil produit le détachement vis-à-vis d’un objet qui était présent autrefois, la sublimation rend présent -- comme l’est une trace – ce qui n’est plus ou qui ne sera jamais. Ainsi, à la différence du deuil, qui est une expérience de douleur, la sublimation porte à des expériences de jouissance. Et pour autant que l’analyse est elle-même une expérience de sublimation (et en tant que telle elle rend possible une sublimation plus systématique) elle est supportable: après tout, les analysants reviennent chez l’analyste, pendant des années, parce qu’ils y trouvent de la jouissance. En tant que sublimation, l’analyse est une initiation au souci – et dirai-je à la cura comme Sorge – , dans le souhait qu’un jour il y aura une cure-souci et non seulement des traces, mais aussi des êtres présents et vivants. L’effet de la cure (Behandlung, Kur) analytique est de rendre possible la Cura (Sorge) des étants.
Agamben, G. (2004) Le temps qui reste. Un commentaire à l’“ Epître aux Romains ”, Rivages, Paris.
Atwater, A. L. (1930) New York Herald Tribune Magazine, 12 Jan. 1930, p. 12.
Barthes, R. (1980) La chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, Paris .
Benvenuto, S.:
- (1988-89) "Réfléxions de la modernité", Ligeia, nn. 3?4, pp. 89?105.
- (1993), "Erotismo platonico e sublimazione freudiana", Psicoterapia e scienze umane, 1993, anno XXVII, n.3, pp. 67-86.
Freud, S.:
- (1895) „Studien über Hysterie, GW, I.
- (1910) „Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci“, GW, VIII.
- (1914) „Zur Einführung des Narzissmus“, GW, X.
- (1922) „Das Ich und das Es“, GW, XIII.
- (1929) "Das Unbehagen in der Kultur", GW, XIV.
- (1932) “Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse”, GW, XV.
Gadamer, H. G. (1977) Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest, Reclam, Stuttgart.
Hegel, G. W. F. (1832-1845) Vorlesungen über die Aesthetik III. Hegels Werken, Bd 15, Suhrkamp, Frankfurt.
Kant, E. (1790) Kritik der Urteilskraft.
Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1967) Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, Paris.
Panofsky, E. (1924) Idea. A Concept in Art Theory, Icon, New York, 1974.
H. Segal, H. (1952) “A Psychoanalytic Approach to Aesthetics” (1952) in The Works of Hanna Segal (London: Free Asssociation Books, 1986), pp. 185-205.
Shanes, E. (1989) Brancusi, Abbeville Press, New York.
[1] Paru dans Gradiva. Revue Européenne d’Anthropologie Littéraire, vol. 11, 2, automne 2008, pp. 153-175. Paru en allemand, “Sublimierung und Mitleid”, RISS. Zeitschrift für Psychoanalyse, Heft 69-70, II-III 2008, pp. 67-90.
[2] Laplanche & Pontalis (1967).
[3] Freud (1932) GW, XV, p. 103. Cf. aussi Freud (1929), GW, XIV, p. 438.
[4] Freud examine la sublimation surtout à propos de Léonard de Vinci (Freud 1910): sa curiosité sexuelle infantile aurait débouché sur sa curiosité scientifique illimitée, qui en a fait un héros culturel.
[5] Certes, Freud porte comme exemple de pulsions comme celle scopique, qui est reliée à un organe qui n’est pas une muqueuse, l’œil. Mais il est à noter qu’il n’isole pas dans l’histoire libidinale une phase scopique, et que la pulsion soit reliée au fait de regarder “les parties sexuelles” de l’autre, ainsi que dans le voyeurisme et dans l’exhibitionnisme. Après Freud, la théorie psychanalytique cherchera de s’émanciper de ces connotations par trop anatomiques: mais toujours avec de la difficulté. Pensons seulement à la résistance à accepter la notion de Lacan d’une phase du miroir, c’est-à-dire d’un stade libidinal axé sur le regard et sur l’image du corps dans son ensemble. Pour des raisons différentes, la tradition kleinienne exaltera au maximum l’hégémonie de la métaphore corporelle, en attribuant les processus mentaux même les plus impalpables à des fantasmes concernant le sein maternel, donc un corps primordial précédant toute structuration optique. Quant au modèle de Bion, il est tout à fait calqué sur le processus de la digestion, donc sur quelque chose de massivement corporel.
[6] Il faut noter que le thème de “ la nuda vita”, la vie nue (développé par Agamben, Esposito, Perniola, etc.) aujourd’hui polarise une partie significative de la philosophie européenne. En revenant au Freud originaire, la réflexion aujourd’hui paraît fascinée de plus en plus par des figures biologiques – par la vie en tant que zoé, et non plus en tant que bios.
[7] “….Beaucoup serait gagné si nous pouvions transformer la misère hystérique [du patient] en l’expérience ordinaire d’être malheureux” (Freud 1895, GW I, p. 310).
[8] Probablement, Freud a pensé la primauté du corps à partir de l’évidence par laquelle les désirs et les plaisirs liés au corps paraissent “ naturels ”, au sens qu’ils n’ont pas besoin d’apprentissage culturel. Ils sont notre animalité. Dans les troupeaux d’animaux, il y a souvent des don juans – des mâles qui se consacrent surtout à séduire les femelles--mais non des librettistes d’opéras. Par contre, les désirs et plaisir sublimés exigent une initiation culturelle, une médiation par la Kultur. La distinction entre originaire et sublimé se superposerait alors à la distinction classique entre nature et culture, entre nature et nurture. Pourtant, cette distinction chez l’être humain est relative: nous ne savons jamais jusqu’à quel point nos désirs sont tout à fait “naturels” ou bien culturellement conditionnés. Jusqu’à quel point notre sexualité est quelque chose que nous sommes ou quelque chose que nous devenons à travers nos rapports sociaux ?
[9] Il faut préciser que pour la plupart des biologistes contemporains l’égoïsme de l’individu n’est qu’une conséquence de l’“ égoïsme du gène ”: les actes altruistes des individus sont ramenés à l’égoïsme des gènes qui commandent le phénotype altruiste (à savoir, à la probabilité réplicative de chaque gène).
[10] Kant (1790, Partie I, Sect. 1, livre 1, par. 5 [les italiques sont de Kant]).
[11] Pour Kant le plaisant naît de l’attraction que les choses exercent sur les sens, tandis que le plaisant esthétique naît de la forme ou image de la chose que nous trouvons belle. Dans le premier cas nous avons un jugement esthétique empirique, dans le second un jugement esthétique pur. Mais le plaisir érotique lui aussi naît de la forme ou image. Evidemment le plaisant esthétique et le plaisant érotique ne sont pas si distincts que Kant tendrait à nous le faire penser.
[12] Je me réfère ici au concept hégélien d’Aufhebung: il est à la fois annulation et conservation, élévation et soulèvement (au sens où l’on dit que quelqu’un a été “soulagé de sa propre charge”). La synthèse hégélienne d’une contradiction est une Aufhebung au sens où celle-ci est dépassée, mais en quelques sortes aussi conservée et “élevée”.
[13] Cette conclusion semble se limiter aux arts figuratifs. L’architecture et la musique, par exemple, ne paraissent pas évoquer cette absence. Ailleurs (Benvenuto 1988-89), j’ai montré que même dans les arts non figuratifs transpire une absence de la chose. La musique nous suscite des images, des sensations, des souvenirs qui n’appartiennent pas à la séquence musicale elle-même. L’architecture renvoie toujours à l’habitabilité, au fait de vivre dans un bâtiment que la forme architectonique rend possible, mais que la forme n’épuise jamais: toute œuvre architectonique renvoie à l’habitation concrète qui transcende toujours l’œuvre elle-même, et qui reste en elle silencieuse (ce n’est pas un hasard si, lorsque nous considérons des constructions énormes – comme par exemple la statue de la Liberté à New York – mais non pas particulièrement habitables, alors nous ne parlons plus d’architecture mais bien de sculpture géante, et donc de sculpture tout de même).
[14] Sur le platonisme de Raphaël, cf. Panofsky (1924).
[15] Barthes (1980, p. 49).
[16] Kant, Critique de la faculté de juger, par. 17. Rappelons les autres définitions kantiennes. Selon la qualité: le beau est l’objet d’un plaisir sans aucun intérêt. Selon la quantité: le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Selon la modalité: le beau est ce qui d’un concept est reconnu comme objet d’un plaisir nécessaire. Notons qu’il n’y a que la troisième définition qui n’évoque pas la dimension du plaisir, tandis que les autres trois l’évoquent.
[17] Hegel (1832-1845, ch. III de l’Einleitung) : “Le jugement esthétique fait subsister librement pour soi ce qui existe à l’extérieur et il naît d’un plaisir avec lequel l’objet consent de par soi-même, car le plaisir permet à l’objet d’avoir sa fin propre en lui-même”.
[18] GW, 10, p. 156. Le charme des chats, comme celui des grands animaux prédateurs, des enfants et de certaines belles femmes narcissiques, repose justement sur leur auto-suffisance et sur leur inaccessibilité, sur le fait qu’ils ou elles ne se soucient pas du tout de nous.
[19] Dans le vocabulaire des différentes langues la signification des termes qui signifient “plaisir” est toujours reliée, d’une certaine façon, à un désir.
[20]Cité par Atwater (1930, p. 12). Cf. Shanes (1989, pp. 105-6).
[21] GW, XIII, p. 274; SE, 19, p. 45.
[22] Les modernes se distinguent par rapport à la définition kantienne du beau selon la quantité (cf. n. 15), car cette dernière fait intervenir un critère universaliste que nous les modernes ne pouvons plus accepter : le plaisir n’a jamais un portée universelle. Mais l’universalité du sentiment esthétique, chez Kant, ne consiste pas en une quelconque validité objective que tous devraient reconnaître, mais bien dans la communicabilité, à savoir dans la possibilité que le sentiment soit partagé par les autres êtres humains. L’universalité du jugement esthétique est purement idéale, toujours pour les lendemains. Ce qui compte c’est que le jugement esthétique ait toujours une face sociale: le fait que certaines œuvres plaisent à beaucoup de monde crée un lien social entre les gens.
[23] 246-7. Sur le caractère “platonicien” de la sublimation freudienne, cf. Benvenuto (1993).
[24] Cela s’applique aussi aux œuvres interactives, si répandues aujourd’hui dans l’art contemporain. En ce cas-là, les œuvres ont la forme d’un jeu, mais ce n’est pas un hasard qu’il ne s’agisse jamais de jeux de compétition. En d’autres termes, ces œuvres sont artistiques pour autant qu’elles, en poussant le public à intervenir, ne lui font pas consommer des jeux.
[25] Cela doit être dit, même si Platon, on le sait, excluait l’art de sa République. Le fait paradoxal, pourtant, est que toute réflexion soignée sur l’art nous ramène à des thèmes platoniciens. Aujourd’hui nous pensons, en effet, que l’art n’est pas une “ imitation de l’imitation ” -- comme le disait Platon – mais qu’il est par contre une forme d’accès privilégié à l’ousia. Et soit l’artiste soit son public sont plutôt semblables à ceux que Platon lui-même dans le Phèdre (248, d) appelait les musikoi, les amants des Muses; ceux-ci étaient des âmes au sommet de la hiérarchie spirituelle, autant que les philosophoi.
Flussi © 2016 • Privacy Policy
 IT
IT EN
EN